guerre
-

Anarchistes de début de siècle
Avant-garde avant-guerreL’époque étouffante était au calme saturé d’électricité de l’avant-guerre.
(Victor Serge)Renan était fort surpris de constater que les socialistes sont au-dessus du découragement : « Après chaque expérience manquée ils recommencent ; on n’a pas trouvé la solution, on la trouvera. L’idée ne leur vient jamais que la solution n’existe pas, et là est leur force »
(Georges Sorel)Pourquoi en revenir à eux, anarchistes individualistes, toujours défaits ? D’abord le contexte. Le mouvement individualiste français – en tout cas la frange qui s’est « organisée », passés donc les prémices artistiques ou communautaires – naît dans une période de reflux qui annonce un écrasement : le « calme saturé d’électricité de l’avant-guerre ». Il émerge en opposition au milieu révolutionnaire, et anarchiste en particulier, qui agite encore l’espoir de la grève générale, mais surtout la menace de la Réaction (autour de Dreyfus). Finalement, il meurt sous le double coup d’abord de la mobilisation militaire, ensuite de la Révolution russe (à coup de « masses », en somme). On pourrait dire qu’il succombe à l’Histoire, lui qui pensait s’en être émancipé. Ou plutôt il meurt de ne pas avoir dépassé la contradiction qu’il a introduit lui-même dans le mouvement révolutionnaire : la culture du Moi.
Ensuite parce que nous sommes, en grande partie, les héritiers de cet existentialisme anarchiste – nous et ceux qui ont lutté hors/contre des partis et syndicats, tout le mouvement post-situ, squat, anti-carcéral, anti-industriel, illégaliste voire alternatif du dernier quart de siècle, ou encore ceux que la police appela « anarcho-autonome »1. On s’épargnera une généalogie2 – ce qui suit devrait suffire. Ce n’est donc sûrement pas sans raison, que dans les contextes similaires de reflux, on entende résonner les mots d’ordre de cette petite troupe : vivre (« vouloir se vivre et avoir l’orgueil de vouloir se vivre »), sans attendre et sans but (« l’illusion mauvaise, c’est attendre la révolte des foules »), se méfier et des foules et des échecs de la camaraderie, y opposer l’amitié d’individualités solides et choisies.
Est-on donc pourtant condamné à faire les cent pas, au gré des oscillations historiques, sur le chemin emprunté par Victor Serge entre 1907 et 1917 : lui qui passa de l’individualisme le plus affirmé, méprisant des foules ataviques et imitatrices (citant Le Bon, Le Dantec), à celui qui se plait à n’être que l’« accomplisseur de ce qui doit être accompli », « goutte d’eau dans le torrent, parmi les hommes en marche, en masses ». Avec dans les deux cas la même fascination pour la force : celle du Moi – génie ou dictateur, enfin celle de l’esprit russe et des masses en mouvement. On pourrait toujours dire que ce sont les cheminements qui sont intéressants chez Victor Serge et non ses points de départs (l’Unique) ou d’arrivée (l’En-dehors ou le Parti bolchévique). On prendrai le risque de réhabiliter le romantisme de la défaite – échouer encore –, l’amour situ pour les révolutions manquées, dont profitent les régulières résurgences léninistes.
On préfèrera poser ici le groupe anarchiste constitué autour de Libertad puis Serge, plutôt comme question, ou miroir. Regarder ce qu’il y a en lui de précurseur. Mais aussi ce qui le condamnait (et nous condamne à notre tour ?) à l’échec.
Ce texte est fait de trois parties de natures très différentes : d’abord le contexte historique et l’histoire plus particulière du groupe de la rue de la Barre ; ensuite un ensemble de citations tirées du journal l’anarchie ; enfin quelques textes de Victor Serge qui, à partir de 1917, s’éloigne de la position individualiste et fini par la critiquer frontalement.
l’anarchie
Contexte : structuration de l’anarchisme ; alliances avec la gauche; l’en-dehors ; dépression et répression
L’affaire Dreyfus et la lutte armée pour la défense de la République
À mesure que la répression ayant suivi l’assassinat de Carnot en 1894 se calme, le mouvement anarchiste opère sa mue autour du renoncement à la propagande par le fait. Cela passe par un investissement dans la lutte collective (antimilitarisme, premiers syndicats, caisses d’entraide) et la prise en charge de la vie ouvrière (coopératives, pédagogie, néo-malthusianisme, régimes alimentaires). L’organisation des différents groupes reste souple ; la liaison est effectuée par les journaux, mais aussi les événements, concerts, promenades, repas familiaux, écriture de tract. Ainsi que par des anarchistes errants, « gyrovagues », qui provoquent le long de leur chemin la « floraison » de nouveaux collectifs. On ne parle plus de groupes secrets, comme dans la décennie précédente, mais d’espaces de sociabilité et d’éducation. En résumé la « Bibliothèque d’éducation libertaire » remplace les « Dynamiteurs de Clichy ». Certains entreprennent de se structurer (local, caisse commune, cotisations, rôles, commissions, voire hiérarchie) voire de se coordonner à travers des ligues ou des campagnes. Cette transformation du milieu renouvelle les désaccords – qui vont encore jusqu’à la bagarre, ou à la dénonciation à la police – sans pour autant dessiner de lignes de partages claires3.
L’affaire Dreyfus va radicaliser les divergences. Le journal le Libertaire de Sébastien Faure, qui lancera aussi Le Journal du peuple dédié à l’affaire, prétextant une menace monarchiste et cléricale, lance des passerelles entre le mouvement anarchiste et la gauche en gestation4. Il appelle finalement à une « coalition révolutionnaire », fédérant « Républicains, Démocrates, Penseurs libres, Socialistes, Révolutionnaires ». Il entend mettre l’activisme des anarchistes au service de la République ou de sa défense tout du moins, la « lutte armée » devant « briser le mouvement nationaliste ». Il est soutenu en partie par Pouget (qui abandonnera le Père Peinard pour Le Journal du peuple) qui appelle aussi à sauver la « putainerie » qui les persécutait encore deux ans auparavant, plutôt que de culbuter dans « la mouscaille réactionnaire ». De manière générale, que ce soit parce que le sujet est d’actualité, ou par réelle peur du péril réactionnaire, ou encore parce que c’est une occasion de prendre la rue, l’Affaire va absorber toute l’agitation anarchiste durant l’année 1898.
À la suite de la mort de Félix Faure, Sébastien réitère sa défense de la démocratie française et appelle à participer aux funérailles présidentielles, afin de déjouer les tentatives de conspirations monarcho-cléricales. Suivra un appel à l’action directe anarchiste contre le « complot des muscadins » et en défense de Loubet (dont les dreyfusards libertaires se félicitent de l’accès à la Présidence). Ou encore un banquet de la Coalition en mars 99, puis un appel à manifester pour soutenir la République le 11 juin. Enfin le soutien à l’arrestation de Déroulède.
Ces « compromissions » sont de plus en plus dénoncées comme telles : la police observe « un mouvement de réaction intense », surtout à Paris où les trois-quart des groupes deviennent anti- fauristes. On accuse les « anarchistes de gouvernement » ou « anarchistes d’affaire ». On refuse d’être la cinquième roue du carrosse. On appelle ici et là à recentrer l’action anarchiste dans la lutte contre le capital (parmi les premiers critiques on trouve d’anciens du Libertaire et des naturiens ; le journal les Temps nouveaux s’était quant à lui déjà peu engagé dans l’Affaire). La police citant un anarchiste : « on vient de traverser une période calme, et n’étant plus grisés par la lutte on peut juger les résultats obtenus et ils sont déplorables […] la situation du parti est plus mauvaise qu’il y a dix ans […] tout est à recommencer […] il n’y a plus de groupes, plus de réunions, et plus de journaux positivement anarchistes. »
Naissance de l’anarchie
En amplifiant les dissensions pré-existantes, l’affaire Dreyfus finit de scissionner le parti anarchiste en deux tendances. L’une est désormais prête à négocier des alliances5 autour, outre des syndicats et des ligues antimilitaristes, du mouvement coopératif, ainsi qu’à des fins « défensives » (caisses de solidarité, collectifs de locataires, comités contre la police, ou contre la conscription). Quand l’autre tendance veut éviter tout point de contact entre socialisme et anarchisme. C’est de cette seconde frange que va émerger la « nouvelle génération individualiste »6. Celle-ci entend tirer les conclusions de l’incapacité des anarchistes à faire déboucher l’Affaire Dreyfus sur le terrain insurrectionnel. Et va ajouter à la critique classique du parlementarisme et du syndicalisme, la critique de l’agitation de rue voire de l’action collective politique ou syndicale, et même de la révolution (comme horizon), et des révolutionnaires (comme individus aliénés). De là découle un nouveau mot d’ordre : ne plus attendre mais « vivre » maintenant, tout en cherchant à s’élever individuellement. « Nous les passionnés du vrai, du solide, les dépositaires de vérités nouvelles, travaillons à faire un prolétariat régénéré, conscient, haineux ».
Ce crédo sera avant tout porté par l’anarchie, journal fondé en 1905 par Libertad et qui paraîtra jusqu’en 1914 :
Pour éviter toute duperie, nous appuyons sur la forme sectaire de cette publication : On y luttera contre le socialisme et le christianisme, le syndicalisme et le militarisme, le capitalisme et le coopératisme. Seuls donc, les camarades qui trouvent cette campagne utile à entreprendre nous aiderons : nous n’avons pas besoin des autres
(Libertad)Albert Libertad a un parcours d’anarchiste français « classique ». « Pupille des enfants assistés de la Gironde, il exerça divers métiers, dont celui de comptable. Un mois après son arrivée à Paris, en août 1897, il se signale en apostrophant le prêtre du Sacré-Cœur en plein prêche ». Il est arrêté pour avoir fait l’éloge de Ravachol et Henry. Il travaille pour le Libertaire de Sébastien Faure, il est dreyfusard (il participera aussi au Journal du Peuple d’Émile Pouget et Faure), candidat abstentionniste, il participe à la fondation de la Ligue Antimilitariste (avec des socialistes) – qu’il abandonne dès le lendemain.
Infirme des deux jambes, marchant sur des béquilles dont il se servait vigoureusement dans les bagarres, grand bagarreur du reste, il portait sur un torse puissant une tête barbue au front harmonieux. […] Violent et magnétique, il devint l’âme d’un mouvement d’un dynamisme extraordinaire. Lui-même aimait la rue, la foule, les chahuts, les idées, les femmes.
(Victor Serge)Après avoir lancé les Causeries populaires (avec Paraf Javal son compère « éducationniste », qui deviendra l’un de ses ennemis)7 c’est dans son journal, l’anarchie, que va prendre corps la critique interne au mouvement et un individualisme en rupture avec ses prédécesseurs artistes ou milieu-libristes. On y oppose au tournant organisationnel8 de l’anarchisme « la cellule anarchiste », « débarrassée de tout rouage inepte »9, ainsi que le communisme immédiat.
Si le journal, tiré tous les jeudis à 6 000 exemplaires est un moyen de liaison (« le point de contact entre ceux qui, à travers le monde, vivent en anarchistes »), son lieu d’élaboration est lui-même un lieu de vie et d’organisation. D’abord à Montmartre10, dans une grande maison à deux étages, avec l’imprimerie au sous-sol, les pièces communes et de réunion au rez-de-chaussée (où ont lieu des Causeries), et à l’étage des chambres permettant d’accueillir une dizaine de personnes, dont certaines qui vivent là à l’année, « dans une grande liberté de mœurs » selon les indicateurs policiers. Un autre rapport de police qualifie Libertad de « roi de Montmartre » et baptise le local le « nid rouge ».
Au [22, rue du Chevalier de la Barre] les réunions étaient sinon tumultueuses, du moins fort passionnées ; on discutait Stirner, Nietzsche, Le Dantec ; parfois on tenait conférence sur le trottoir ; chaises et bancs encombraient la chaussée. Un jour la police intervint et ce fut la bagarre.
(Maitron)Dans le même temps, une « colonie de vacances pour adultes et enfants » est fondée à Châtelaillon (Charente-Maritime) par Libertad, Anna Mahé et Pierre Brunia, anarchiste et éleveur d’huîtres : Les camarades peuvent s’y reposer en anarchistes et profiter de « Libertaire-Plage ». Des brouilles mettent un terme à l’expérience provinciale en 1908.
(Beaudet)À la suite d’une bagarre, l’ayant très certainement opposé à ses propres camarades, Libertad reste étendu sur le pavé de la rue de la Barre. Un mois plus tard, le 12 novembre 1908, il décèdera à seulement 33 ans à Lariboisière.
Illégalismes
A partir de juin 1910 et sous la direction désormais de Lorulot, le journal déménage à Romainville. L’équipe y vit toujours « en camaraderie », consommant les fruits et légumes cultivés dans le grand jardin (et aussi de divers larcins et de fausse-monnaie). C’est là-bas que Victor Serge11 rejoint le groupe, en 1911. Victor est né dans la misère à Bruxelles (son frère meurt de faim à 9 ans) où il connait depuis ses 12 ans Raymond Caillemin dit « la Science », futur membre de la bande à Bonnot. Encore adolescents ils ont rejoint la Colonie libertaire de Stockeld, puis à Boisfort le journal Le Communiste qui deviendra Le Révolté. Ils y rencontrent Edouard Carouy (autre futur membre de la bande à Bonnot) et Octave Garnier (idem). Victor monte à Paris en 1908 rejoindre Mauricius et Rirette qu’il a rencontrés à Lille – et écrire dans leur journal, l’anarchie. Il fonde en parallèle un « cercle d’études » dans le Quartier Latin. Lui et sa bande perturbent les meetings de l’Action française ou du Sillon. Il a retrouvé un autre Belge, René Valet (idem) avec lequel il participe aux émeutes contre l’exécution de Francisco Ferrer Guardia et de Jean-Jacques Liabeuf (affrontements devant la prison de la Santé) :
Les racines de notre pensée plongeaient dans le désespoir. Rien à faire. Ce monde est inacceptable ; inacceptable le sort qu’il nous fait. L’homme est vaincu, perdu. Nous sommes écrasés d’avance, quoi que nous fassions. Une jeune accoucheuse anarchiste renonça à son métier « parce que c’est un crime que d’infliger la vie à un être humain. » […] Nous avions erré [avec René] ensemble autour d’une guillotine, par un soir d’émeute, ravagés de tristesse, écoeurés de faiblesse, enragés en somme, mûrissant pour des actes de désespoir. « On est devant le mur », disions-nous, – et quel mur ! « Ah les salauds ! » murmurait sourdement le rouquin et il m’avoua le lendemain que sa main, pendant toute cette nuit, s’était serrée sur la fraîcheur noire d’un browning. Se battre, se battre, que faire d’autre ? Se battre et périr, peu importe. Rappelez-vous ce vers de Verhaeren : « Ouvrir ou se casser les poings contre la porte ».
(Victor Serge)Après l’expérience de Rambouillet, Victor prend, avec Rirette devenue sa compagne, la direction de l’anarchie (mi-1911, jusque début 1912) et le déménage à Paris (rue Fessart), pour s’éloigner à la fois des tentations hygiénistes de certains membres de la bande, et de la « dérive » illégaliste de ses amis (qu’il soutient pourtant dans le journal : « qu’en plein jour l’on fusille un misérable garçon de banque, cela prouve que des hommes ont enfin compris les vertus de l’audace »). C’est trop tard pour empêcher ses proches d’en mourir.
René s’est jeté dans une mortelle aventure par esprit de solidarité – pour aider des copains, – par besoin de combat, par désespoir au fond. Ces égoïstes conscients se firent massacrer par amitié. [Avec Raymond, ils] se battirent donc toute une nuit contre la troupe, la gendarmerie, la police, les honnêtes gens qu’ils traitaient d’assassins, car ils se sentaient des victimes. La révolte aussi est une impasse, rien à faire. Alors rechargeons vite les chargeurs…
(Victor Serge)Caillemin sera condamné à la peine de mort, Carouy se suicidera en prison.
ils « ont follement gaspillé et perdu leurs vies dans une lutte sans issue […] Peut être si j’avais été plus ferme Valet serait-il vivant et ce pauvre Joudy libre. J’ai seulement manqué de combativité
(Victor Serge)Victor Serge sera condamné en 1912 à 5 ans de prison. Après sa sortie de prison il rejoindra Barcelone puis la Révolution russe.
La guerre, la mort
À la veille de la guerre la police compte une quinzaine de groupes individualistes à Paris, qui se coordonnent et surtout participent à des causeries populaires, sur le format créé dix ans plus tôt par Libertad. Le groupe autour de l’anarchie, qui est resté, après le Libertaire et les Temps nouveaux, le troisième principal journal anarchiste, a donc dans ces années là un rôle central12.
La question de la guerre, et de la future mobilisation générale, reste l’une des rares convergence de vue des différentes tendances anarchistes avec d’un côté la propagande et l’agitation, de l’autre des plans d’actions insurrectionnels en cas de mobilisation générale (« À l’ordre de mobilisation vous répondrez par la grève immédiate et par l’insurrection », de Gustave Hervé) : projets de sabotage des voies, des casernes, d’assassinats d’officiers, et de convergence vers Paris. Les journaux le Libertaire (anarchiste) et La Guerre sociale (de l’alliance antimilitariste menée par Hervé) collaboreront par exemple pour maquiller et diffuser un manuel de l’armée de sabotage des chemins de fer.
Autant l’insoumission que l’insurrection : rien ne se passera comme prévu en 1914. Les militants sont mobilisés et désertent peu. La mobilisation est par ailleurs soutenue par certains intellectuels anarchistes pour qui défendre la France agressée c’est défendre l’idéal révolutionnaire qui s’y incarne. La Guerre sociale, journal antimilitariste le plus influent, rallie l’Union sacrée (tout comme la CGT et la SFIO)13. À Paris, le groupe de Jean Grave (autour des Temps nouveaux) sera l’un des derniers à continuer ses activités malgré la mobilisation, avant de se rallier aussi à l’Union Sacrée. Grave co-écrira avec Kropotkine le Manifeste des Seize soutenant les Alliés. Son raisonnement : maintenant que la guerre est déclarée, autant en finir avec l’impérialisme allemand. Malato (Le Journal du peuple, et La Guerre sociale) signe le manifeste. À l’inverse, Sébastien Faure et Mauricius (l’un des fondateurs de l’anarchie) publient Ce qu’il faut dire (CQFD) pour s’opposer à cette ligne belliciste. Le journal est censuré mais tout de même diffusé (« Mauricius a 50 000 hommes derrière lui » dit à l’époque Louis Malvy14).
Entretemps l’anarchie a tout simplement cessé de paraître (en juillet 1914). En effet, l’affaire Bonnot, jugée en 1913, a mis de côté André Lorulot, Rirette Maîtrejean et Victor Serge qui ont confié le journal à E. Armand. Ce dernier est un antimilitariste qui a glissé progressivement de l’anarchisme chrétien (il publie au début du siècle dans le Libertaire, sous les pseudos Frank ou Junius) vers l’individualisme (il publie Petit Manuel anarchiste individualiste en 1911). En 1915 il s’oppose à l’Union sacrée et fait paraître, en remplacement de l’anarchie, le journal Par-delà la mêlée. Il restera en contact avec Victor Serge, qui refusera cependant à sa sortie de prison de contribuer à ses nouveaux projets éditoriaux. Lui qui a passé la guerre enfermé commence alors à former une critique de l’anarchisme individualisme et la façon dont ce dernier se continue avec Armand. Une critique de ceux qui sont « revenus de tout », de leurs échecs et leur déni :
Leur admiration prétentieuse du Moi aboutit à une rage de se faire imprimer – mais ne leur apprend à penser ni à écrire. C’est un pharisaïsme grossier – et non un Individualisme. Tous les articulets peuvent se résumer par la prière du pharisien : « Soyez remercié, Seigneur, de ne pas m’avoir fait pareil à tout le monde ». Dire que personne n’a songé à réimprimer les beaux articles de Levieux15 sur la Morale – ou sur la vie immédiate « Vivre d’abord ». […] Quelle indigence d’art dans toutes ces proses qui voudraient être poétiques – écrites en petit nègre pédantesque. […] Le résultat de cette propagande d’Individualisme amoindri, c’est la production d’une espèce de camarades qui ne s’intéressent à rien… La guerre ? – Mon vieux, je suis inactuel. – La révolution russe ? – Tu sais, les révolutions, la foule, moi… – La propagande ? – Oh moi, j’en suis revenu..Et de tout. « Je me débrouille, je suis végétarien », c’est tout.
(Victor Serge, 1917)La bande n’a pas résisté à la répression puis à la Guerre. Aux inimités aussi (entre Lorulot et Serge notamment). « Ce qui manquait le plus à la bande, ce fut l’organisation » ajoutera Rirette Maîtrejean.

Doctrine
L’anarchisme nous prenait tout entiers parce qu’il nous demandait tout, nous offrait tout. Pas un recoin de la vie qu’il n’éclairât, du moins nous semblait-il. [Nous] allâmes à la tendance extrême (à ce moment), celle qui par une dialectique rigoureuse en arrivait, à force de révolutionnarisme, à n’avoir plus besoin de révolution.
(Victor Serge)Il est mal-aisé de définir une doctrine commune à tous ces individus, quand bien même ils écrivent dans le même journal et pour certains vivent dans la même maison. Ces divergences (entre personnes ou entre périodes) sont flagrantes concernant les rapports au communisme, à l’illégalisme, à la révolution. À la lecture des plus de 400 numéros de l’anarchie, on peut pourtant dessiner à gros traits la trame de cet individualisme d’avant-guerre.
La confrontation avec le reste du milieu anarchiste se fait notamment autour de la question du militantisme et des alliances avec le mouvement ouvrier. L’affaire Dreyfus a été la dernière occasion pour les individualistes de constater que le siècle des révolutions était clos, et d’en faire le bilan suivant : une révolution d’idiots ne peut mener à rien de bon et il faut sortir de l’attente, héritage chrétien. Il en découle que l’individualiste doive, plutôt qu’attendre le Grand Soir, « être tout de suite » (Victor Serge), vivre maintenant et vivre mieux. Cela passe par s’élever soi-même, « seule besogne vraiment libératrice, vraiment révolutionnaire ». L’individualisme ouvre à « des rapports meilleurs » et à la solidarité véritable, « que nous appelonsla Camaraderie anarchiste ». L’individualiste s’associe librement à des camarades soigneusement sélectionnés, « minorités d’élite composée d’individus sains aux cervelles décrassées » (VS). En retour cette « camaraderie » finit d’offrir « de développer intégralement sa personnalité ». La multiplication de ces cellules anarchistes, enfin, peut (elle seule) ouvrir au « communisme pratique ».
Contre la Révolution
Les « innombrables brochures, monceaux de journaux, quantités d’affiches » clamant « l’imminence de la Révolution », ont usé la patience de nos individualistes.
On attend, on attend, on se prépare. Trois fois on démolit deux réverbères ; on discute les menus détails de l’inévitable bouleversement, et des pince-sans-rire racontent qu’ils feront la Révolution comme ceci et comme cela.
(Victor Serge)Certains ont même découvert, ô horreur, que nous étions anti-révolutionnaires ! Cela ne justifie-t-il pas toutes les colères, toutes les animosités ? […] il y a encore des romantiques. Les vieilles barbes de 48 nous ont légué des successeurs
(Lorulot)L’attente du Grand Soir est vue comme une croix, que l’on traîne…
Laissons de côté cette mentalité révolutionnaire si profondément religieuse et fataliste encore. Ne nous grisons plus de mots et ne comptons plus sur les Messies ou sur les Miracles.
(Lorulot)Des siècles, ils n’ont vécu qu’avec devant les prunelles le grand rêve Chrétien. Maintenant qu’ils l’ont vu s’effondrer, il leur en faut un autre. Ils n’attendent plus ceux-là, ni le Messie, ni le céleste royaume […] — Mais eux, ils attendent Demain !
(Victor Serge)A l’espoir tendu vers demain ils opposent la certitude de l’effort immédiat:
Il n’est pas de se suggestionner par la magnificence ou la proximité du but à atteindre, mais bien plutôt de se convaincre par une critique constante que l’on procède de la bonne manière, que l’on ne s’égare pas dans les à-côtés. […] Nous n’avons pas la foi en tel but, l’illusion en tel paradis, mais la certitude d’employer notre effort dans le sens le meilleur.
(Libertad)Contre l’ouvrier et sa classe, l’esclave et son genre humain
Contre la Révolution, héritage chrétien, l’individualiste « fustige les esclaves » (Lorulot) : « Ce sont les inconscients, les dégénérés et les faibles qui font la belle société où ils nous forcent de croupir avec eux ! ». Mais le bon citoyen, « triste abruti, à la silhouette avachie, alcoolique, tabagique, tuberculeux » (Victor Serge) est plus méprisable encore quand il se concentre en « masse, le groupe, le tas » (Lorulot).
Les gens bêtes et routiniers, race innombrable, ont préféré clore obstinément leurs paupières et se boucher les oreilles en répétant les litanies de sottises que la morale chrétienne a su graver si profondément dans les cervelles. Pitié pour les faibles! Charité pour les souffrants, pour les petits, les infirmes ! […] Humanitarisme ! […] Démocratie – souveraineté du nombre. Et le nombre c’est la médiocrité, l’incohérence, l’inintelligence. Les majorités sont toujours et inévitablement constituées par des éléments de deuxième ordre.
(Victor Serge)Aussi, s’imaginer que [ces] foules impulsives, tarées, ignorantes, en finiront avec l’illogisme morbide de la société capitaliste, est une illusion grossière.
(Victor Serge)Il s’agit d’en finir, avec le « bétail syndicaliste » (« parce que le destin du bétail sera toujours d’être tondu », Levieux), avec la « classe » voire avec l’Homme :
Non je ne suis pas votre frère. Chaque jour vous me faites souffrir. Vous me tuez lentement […] Eh bien maintenant je veux vivre sans vous, pour moi-même. Je m’assois sur […] votre conscience de classe, votre solidarité entre loups et agneaux. […] Communistes parce qu’individualistes […] nous refusons de joindre notre voix au choeur des tartuffes qui entonnent la complainte de l’amour universel.
(Lorulot)Lutter, pour vivre, maintenant,
Renoncement à la Révolution, et maintenant à l’organisation de la classe ouvrière… En quoi consiste finalement l’action anarchiste ? « Il peut sembler aux esprits superficiels que cette nouvelle forme délaisse la lutte », confesse Libertad « alors qu’elle s’engage, sûre d’elle-même, sur tous les points ». Ce n’est certes pas une lutte contre le gouvernement (« c’est puéril »), mais plutôt contre « les formes subjectives de l’autorité », contre les idées que l’on devra arracher « une à une des cerveaux ». C’est une lutte « contre les individus » qu’il faut « purifier, les rendre forts, leur faire aimer et désirer ardemment la vie ». Une lutte « pour la conquête de la vie ». Quoique cette « vie anarchiste » s’avère présentement impossible. Il s’agit alors de « lutter pour arracher […] quelques bribes de la grande vie entrevue». Voire, de lutter… pour la lutte elle-même, « simple et amère jouissance », joie « âpre et puissante », « dont les formes et les phases diverses – variant de la propagande éducative au terrorisme – permettent à tous les tempéraments de se manifester utilement.» (VS). Ainsi, « telle sera notre vie. Combattre tout ce qui nous entrave […] Ne pas connaître le repos. Ne jamais pactiser, ne jamais céder» (VS). Lutte qui correspond aussi à la fin d’une attente. Résoudre d’abord les contraintes existentielles, « s’acharner à être » (VS) :
Comment faire pour manger sans se prostituer, sans gâcher son existence à quelque absurde besogne légale ou illégale? […] Comment en un mot respirer dans le marécage où nous sommes ?
(Victor Serge)Il ne s’agit pas seulement de survivre :
Il s’agit de vivre d’abord, de bien vivre. Tout de suite, dans le présent, sans se laisser[??] par les mirages du futur, ni effrayer par les obstacles du présent.
(Levieux)Vouloir se vivre et avoir l’orgueil de vouloir se vivre
(Libertad)Et donc pour l’Ego
Cette « révolte immédiate » est assimilée en premier lieu à la « réalisation de la personnalité » « forte, consciente, nette et fière ». C’est une « rédemption », par le « développement » de l’individualité, entendue comme ce qui permet d’« exercer ses facultés avec le plus d’intensité possible ».
Pour l’Anarchiste, la liberté n’est pas une entité, une qualité, un bloc qu’il a ou qu’il n’a pas, mais un résultat qu’il acquiert au fur et à mesure qu’il acquiert de la puissance. […] Plus il renverse d’obstacles […] plus il permet d’extension à son individualité, plus il devient libre d’évoluer
(Libertad)Cette volonté de puissance (entravée par « les forces extérieures et […] intérieures »), se convertit vite en culte de la force :
[Se] forger un « moi », propre, original et beau ; pour résister au milieu physique et au milieu humain ; pour défendre pied à pied ton individualité contre les gnomes qui t’environnent – tu devras être fort. Fort de corps, c’est à dire sain ; fort d’esprit c’est à dire intelligence lucide et volonté inflexible.
(Victor Serge)J’irai par la route qui me plait, m’acharnant à être « moi » un homme libre parmi ces esclaves, fort parmi ces faibles, brave parmi ces lâches…[Cela] exige de la force, une volonté puissante, une intelligence nette. Autrement la défaite est certaine.
(Victor Serge)Une pratique élitiste, et même d’avant-garde :
Seules des minorités d’élite composée d’individus sains aux cervelles décrassées et aux énergies ardentes peuvent en vivant mieux, acheminer les hommes vers plus de bonheur… [Et] des minorités en qui subsiste encore de la force, viennent à nous
(Victor Serge)Position qui attire les jalousies, et entraîne la solitude :
Quelles luttes et quels déchirements il lui faudra affronter […] Tous s’écarteront de lui, les masques d’hypocrisie tomberont, il restera seul – ou presque.
(Lorulot)Contre [tel] audacieux, se forme aussi une coalition anonyme et redoutable. Le réfractaire doit chèrement disputer la plus petite parcelle de sa vie […] Autour de lui de vieilles affections s’effondrent, des amitiés se muent en haines.
(Victor Serge)La camaraderie, le communisme
Les rédacteurs de l’Anarchie réfutent pour autant être des « partisans d’une couarde résignation ». Ils ont suffisamment de haine pour « descendre dans la rue » (ils sont d’ailleurs au premier rang à Draveil, en juillet 1908, pour en découdre et Rirette Maîtrejean y est blessée). Mais, « il y a mieux à faire », l’urgence étant celle d’un travail de profondeur. Il s’agit à la fois de former des « agisseurs plus efficaces » et « d’instaurer entre nous des rapports meilleurs. » (Lorulot). Ce qui ne veut pas dire « milieux libres » ou colonies libertaires, ces dernières étant tournées en ridicule :
Un homme, deux chats, un rat blanc ont décidé de former un milieu libre, en dehors de toutes les entraves [.]… Ils pensent que tous les camarades voudront bien leur indiquer un petit coin de quatre ou cinq cent hectares de terrain où ils se chargeront de vivre en donnant le meilleur exemple.
La camaraderie se vit maintenant et donc ici
La pratique du communisme expérimental ne sous-entend pas forcément la formation de milieux libres, colonies agricoles ou autres. Il serait à désirer que, dès aujourd’hui, les anarchistes pratiquent entre eux cette camaraderie qui fait l’objet de toutes leurs théories.
(Lorulot)Et sans nier qu’elle puisse être source de déceptions :
Il est bien rare de tenir conversation avec un anarchiste sans qu’au bout d’un quart d’heure on ne l’entende se lamenter sur les désillusions que lui a causé la pratique de la camaraderie. (E. Armand)
Certains, donc, comme E. Armand, décident de se replier sur la solitude (« le meilleur camarade c’est soi-même », il y ajoute tout de même le conjoint et deux ou trois amis). D’autres persistent. L’élévation individuelle n’est qu’un préalable à l’association (qui est tout de même le « but »). Ne serait-ce que parce que « la camaraderie » est nécessaire pour « permettre à tout homme de développer intégralement sa personnalité ». Il s’agit donc de trouver les moyens de cette saine camaraderie :
Beaucoup de camarades ont cru que la réalisation de ce grand mot Camaraderie était facile, que l’on pouvait de suite, sans préparation, sans sélection, pratiquer la fraternité la plus intégrale; ceux-là se sont trompés ils s’en aperçoivent et protestent ! Désabusés, sceptiques, ils viennent ensuite proclamer, avec dégout et rancoeur la faillite de toute camaraderie…. Ces amis exagèrent et montrent qu’ils n’ont jamais rien compris aux choses qu’ils prétendent pratiquer. […] Les désillusions rencontrées sont compréhensibles lorsqu’on considère notre médiocrité personnelle et la corruption générale. Mais la camaraderie n’est pas un mythe, c’est au contraire le but essentiel vers lequel doivent tendre nos efforts
(Haël – Lorulot)Qui seul amène au communisme
Ainsi l’élévation de soi est préalable à l’association, et la camaraderie permet le plein développement de sa personnalité. C’est ainsi qu’est dépassé l’antagonisme entre individu et société, l’anarchisme devenant la « fusion » de l’individualisme et du communisme. D’un côté le communisme est le seul moyen de la réalisation pleine de l’individualité :
Vers quoi tendons-nous tous, anarchistes, si ce n’est vers cette terre communiste où nos individualismes pourraient s’affirmer ?
(Libertad)[la] libération totale de l’individu dans la société capitaliste était impossible et [..] la réalisation de sa personnalité ne pourrait se faire que dans […] le communisme libertaire
(Mauricius)De l’autre l’individualisme (comme refus de l’humanisme) est le préalable au communisme : “Communistes parce qu’individualistes […] nous refusons de joindre notre voix au choeur des tartuffes qui entonnent la complainte de l’amour universel. […] Je ne suis pas solidaire de n’importe qui
(Lorulot)Seul l’individualiste est vraiment communiste (Lorulot)
La sélection
Mais alors quelle conséquence tirer des échecs de la camaraderie, du communisme pratique ? Tout ne vient tout de même pas de la médiocrité des individus.… La méthode, aussi est en cause :
Il apparait que la réalisation de la camaraderie est étroitement liée aux deux facteurs suivants : 1. Élévation de la conscience individuelle. 2. Sélection des camarades. La première condition est indispensable. “Comment être camarade envers autrui, si on n’est pas susceptible de l’être d’abord envers soi-même ? […] Lorsqu’ils agiront plus raisonnablement et mèneront une vie plus logique, ils seront capables d’apporter à autrui une camaraderie moins suspecte, un tempérament moins vaniteux et moins orgueilleux, des manières de faire vraiment fraternelles et affectueuses. […] je pense pour ma part, que nous pourrions par venir [à la camaraderie] en travaillant à nous améliorer nous mêmes, et en comprenant ensuite que la fraternité n’est pas une panacée et que son exercice ne saurait se passer d’une intelligente sélection parmi les hommes qui nous entourent.
(Haël – Lorulot)Une idée de la sélection que développe aussi Victor Serge :
Au temps où [ces anarchistes] étaient jeunes […] ils eurent le désir puissant de n’être pas que des numéros-matricules passifs, de s’affirmer en individualité catégoriques et volontaires. Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts… Aujourd’hui, [ils] ont disparus obscurément dans le moutonnement des troupeaux variés. […] Quoique dans le sens bourgeois, ils aient parfois merveilleusement réussi, ceux-là qui furent des nôtres, en leur heures d’enthousiasme et de vigueur et qui se sont rangés depuis, sont bien des épaves, des épaves pitoyables… […] Comme tous les déchets humains qui fleurissent ou agonisent sur le fumier social, les déchets de l’anarchisme appellent tout au plus du mépris. Mais ils sont inévitables ainsique les tares inhérentes à l’universelle pourriture où nous nous efforçons de réaliser un peu de vie belle. Le premier venu n’est pas capable de devenir un camarade : c’est ce dont il faudra se souvenir dans nos groupes d’éducation et de combat. Une sélection est à faire. Autant que possible, choisissons les personnes. Et surtout, que toute notre attention se concentre sur ce point, il faut faire des individus qui soient « eux-mêmes » et dont l’affirmation anarchiste, point provoquée par un sentimentalisme excessif, ou par des sympathies momentanées, sera l’expression formelle d’une conscience. Lorsque nous nous inspirerons de ces pensées, il est permis de croire, que moins nombreux seront les déchets, plus rares les épaves.
(Victor Serge)
Victor Serge
On comprend dans quelles eaux l’anarchie de Libertad et Victor Serge tenta de naviguer. D’un côté ils vécurent le pessimisme, la haine de la société, la solitude, l’amour de la lutte, l’amitié indéfectible (qui entraîna tout un pan derrière Bonnot – « René s’est jeté dans une mortelle aventure par esprit de solidarité – pour aider des copains […] Ces égoïstes conscients se firent massacrer par amitié.»). La révolte comme mouvement de la vie, comme « saut non-historique dans l’avenir » (G. Palante) vers « d’imprévus lendemains ». De l’autre, ils n’arrivaient pas à s’affranchir de l’image, projetée dans l’avenir, d’une humanité rédimée.
Ainsi se [révéla] dans l’anarchisme un antagonisme de principes et de tendances qui constitue pour la doctrine un germe fatal de désagrégation
le sociologue nietzschéen G. Palante1917 – rupture avec le nietzschéisme
Cet « antagonisme de principes », on le retrouve chez Victor Serge, au moment où, sorti de prison, il s’apprête à partir pour la Russie, et à balancer par dessus bord l’anarchisme individualiste. Alors qu’il est à Barcelone en 1917, il écrit une étude sur Nietzsche. Comme pour affronter le nietzschéisme qu’il livrait dix ans plus tôt dans L’anarchie :
Toute la différence entre eux – les foules – et nous est là : ils ne peuvent vivre sans maître, nous n’en avons pas besoin. Et nous ne voulons pas que leur inconscience, leur faiblesse et leur peur, nous en imposent
(Victor Serge)Cependant que la démocratie, de chute en chute et de scandale en scandale, ne cesse de se pourrir, les élites se reforment à l’arrière plan et l’on ne peut espérer qu’en elles […] Dans le présent, pour ceux qui en dehors des démocraties veulent ériger haut au- dessus des fanges des vies nouvelles, la force est l’unique talisman.
(Victor Serge)Dans cette étude barcelonaise, il reconnaît qu’« en bon impérialiste allemand » Nietzsche « trouva en France de nombreux disciples », mais plus généralement dans les milieux libertaires, où « la tendance individualiste a ressenti cette influence », « très profondément. » Il cite le journal Nihil, édité à San Francisco en 1909 par Michele Centrone et Adolfo Antonelli, « la revue El Unico éditée au Panama », Libero Tancredi (pseudonyme de Massimo Rocca, qui fera partie du Faisceau d’action révolutionnaire interventionniste, avec Mussolini), le journal d’E. Armand (qui sera son dernier ami individualiste) Par-delà la mêlée et évidemment L’anarchie. Mais pour Victor Serge (ou le nouveau Victor Serge), Nietzsche est au fond un ennemi, un bon ennemi :
Il a été notre ennemi. Soit. Lui-même nous a dit: […] «Vous ne devez pas avoir autre chose que des ennemis dignes de haine, et non pas dignes de mépris: il est nécessaire que vous soyez orgueilleux de vos ennemis.
(Victor Serge)Qui ne mérite que d’être détourné. Ainsi le surhomme, chez Victor Serge, devient cet « esprit clair, un cœur capable d’émotion, une énergie virile » qui ne commettra plus « ni le crime d’obéir ni celui de commander ». L’égoïste devient ainsi le généreux, qui à défaut de dominer, donne. Et qui atteint sa pleine puissance quand tous sont à même comme lui de donner :
Certainement, un tel égoïsme n’a rien de vil et est si ample et sain que ses fruits seront nécessairement la haute bonté, l’instinct fraternel, l’amour profond qui sait aller jusqu’au sacrifice… […] Le Christ se laissa crucifier car la plus haute satisfaction de son âme était dans le sacrifice absolu… Un tel désir de dominer ne peut-être confondu avec celui des misérables qui, ne se dominant pas eux-mêmes, croient régner par le fouet. Une telle volonté exige la pleine liberté pour tous. Une telle générosité ne peut admettre de servitudes.
(Victor Serge)C’est un retournement16, qui s’accompagne d’un retour à l’anarchisme classique17 et à son optimisme, dernière raison de rompre avec Nietzsche : « Rien ne pourra arrêter cette évolution qui est liée au même processus que la vie cosmique. C’est en tout cas ce que conclurent certains grands esprits que Nietzsche détesta profondément. » (VS) Mais un retournement nécessaire, pour lui du moins, car il sait la conséquence de son élitisme passé : la camaraderie élitiste, sélective et méprisante, qui se voulait le dépassement de la tentative initiale de Libertad (par la critique de la Camaraderie) a donné la Bande à Bonnot. Sa pirouette ne convaincra donc pas grand monde chez les individualistes18. Pas même lui-même, au fond, qui fera ses bagages direction le PCUS. Il écrit finalement à E. Armand :
Nous sommes, entre nous, désespérément les mêmes que les autres – que les gens du vieux monde. Eh bien, j’ai un tel désir de fuir cela (…)
(Victor Serge)1918 – de la foule au peuple
Proche de rejoindre la Révolution, Victor Serge tentera une dernière fois de mettre le pied à l’étrier à ses indécrottables (et désormais rares) amis individualistes. D’abord en tentant de réhabiliter le peuple, qu’il distingue de la foule des idiots :
Mais qu’est-ce donc que ce « peuple » méprisable ? Où le rencontre-t-on ? N’est-ce pas vous et moi aussi ? En quelques années de prison […] j’ai conservé […] le mépris des foules […] moutonnières et bornées[…] définies selon Le Bon ou Palante[…] Mais je vois dans les peuples diverses foules – et des individus. Quelle plus riche variété de types individuels ou collectifs que le peuple français ? […] Un peuple c’est l’ensemble des hommes qui en un lieu du globe, en un temps donné, peinent pour vivre, cherchent leur voie et quelquefois ont le bonheur de la trouver.
(Victor Serge)Un peuple qui aujourd’hui en Russie se réveille, et en améliorant le sort commun, promet d’améliorer celui des anarchistes :
On a [déjà] vu des misérables monter de la fange très haut parmi les élites. […] Les peuples pareillement sortent de l’ombre. […] [Le régime en Russie] s’est effondré sous les coups d’une élite très idéaliste et très individualiste aussi, qui aura bien vécu son temps. Il me semble que c’est déjà un résultat individuel et social assez sérieux. On tente de bâtir autre chose. […] Tous ces individus, toutes ces masses […] vivent et travaillent pour la vie. S’ils échouent leur sol restera défriché. S’ils réussissent […] un pas seulement aura été fait en avant. Il y aura tout de même, là-bas, un peu moins d’erreurs […] On ne [peut pas se retirer] de la vie sociale. Bon gré, mal gré, nous sommes des animaux sociables. Et nous ne pouvons, lorsque nous voulons améliorer notre sort personnel, faire autrement que de travailler à l’amélioration du sort commun.
(Victor Serge, 1918)Quelques semaines plus tard, il insiste. Il tient à rappeler à ses camarades que le « refuge » (hors de la société ou à l’intérieur de soi), réflexe de survie lors des « époques d’oppression », n’est pas un but en soi. Ce n’est pas sans noblesse que les individualistes se sont faits inactuels, « hors du présent qui asservit les foules et les faibles », esquissant une philosophie distante et désabusée (il prend à nouveau Palante pour exemple) – mais cela doit prendre fin. « Si la pensée ne s’épanouit pas en action elle avorte ». En conséquence :
Toute la réalité nous appelle. L’heureactuelle est passionnément intéressante. Y demeurer inactuels ce serait renoncer à la moitié de ce qu’elle peut nous donner et de ce que nous pouvons faire. Je voudraisau contraire qu’à la premièrepossibilité, nous nous « réveillons d’entre les morts », animés d’une vigueur nouvelle. Dans les transformations qui s’accomplissent d’un bout à l’autre du monde, que de naissances, que de promesses ! Efforçons-nous de les comprendre, parlons-en, étudions-les. Il nous appartiendra bientôt de dire notre mot et de faire notre tâche dans les grandes tâches communes qu’il serait fou de dédaigner.
Deux semaines avant la confirmation de son départ il revient sur l’expérience de l’anarchie :
Les événements, tous les événements depuis des années, ont confirmé d’une façon trop évidente, hélas ! nos opinions et nos déductions théoriques. Le plus rigoureux déterminisme les enchaîne les uns aux autres. Catastrophes immenses, malheurs, sacrifices immenses, luttes désastreuses et ruines, tout était inévitable et tout s’est accompli selon les lois que nous connaissions. Rappelez-vous ! N’avions nous pas prévu jusqu’aux reniements, jusqu’aux faiblesses les plus tristes? Nous savions bien que certaines paroles sonnaient creux. – Maintenant cette satisfaction nous reste d’avoir pensé juste et compris. Elle est grande. Elle nous confirme dans notre vérité et nous impose de ne rien céder de nous-mêmes à l’ambiance hostile. Mais nous avons à tenir compte aussi de notre passé particulier. Là il semble que nous nous soyons trompés. Que d’échecs, d’insuccès, et quel marasme pour finir ! Je ne puis oublier les années de vie que j’ai perdues par suite de circonstances tragiques et lamentables. Je ne puis oublier ni les jeunes énergies qui se sont tristement gaspillées, ni la somme de souffrances stériles qu’il a fallu subir. Et c’est d’hier. Si tant de force s’était orientée en de meilleurs chemins que n’aurions-nous pu réaliser ?
La critique est en grande partie destinée à l’illégalisme. Aussi y oppose-il « un haut idéalisme » car « sans cela point de vigueur morale, point de persévérance, point de victoire » :
Il faut, pour marcher allègrement par les routes difficiles, nous assigner un but qui soit très clair, très beau, situé très haut – afin que nous soyons sûrs de monter toujours. Il y a pour chacun de nous un idéal individuel à réaliser, de nouvelles formes de vie à susciter, un idéal social à poursuivre.
On comprend que c’est ce « but » qui fait sortir du refuge, de l’isolement. Ici pour rejoindre la Révolution. Mais quelle sera dans celle-ci la tâche de l’individualiste ?
La conscience individuelle a été, pendant ces années terribles, comme abolie. Elle est pourtant la seule valeur humaine supérieure à toutes contingences. Il faut affirmer sa souveraineté et c’est l’individualisme. […] Ne pas oublier que la vie tout entière est en Moi, pour Moi – en Vous, pour Vous. D’énormes forces sociales tendent à niveler les foules. C’est l’heure de défendre l’homme seul avec intransigeance. Et de le réaliser. Sans pour cela cesser d’être fraternels envers les rencontres le long du chemin. […] Tâcher de vivre en plein air, sur la hauteur, avec simplicité. Etre soi-même, mais prêt à collaborer avec toutes les bonnes volontés, – à soutenir librement tout effort émancipateur. – Pas inactuels donc, car la vie est action dans le présent et car jamais moment historique ne fut plus intéressant.
Il reprend pour finir les principes de l’individualisme : se former, s’affirmer, agir en conformité avec sa pensée, s’associer « selon nos conceptions nouvelles de l’association », et finalement :
Pratiquer la plus large camaraderie et nous intéresser de tout notre pouvoir à la vie sociale qui nous environne et va nous permettre enfin de nous réaliser plus largement, plus humainement. Car, selon une claire parole de poète (Verhaeren) : « Vivre c’est prendre et donner avec liesse ».
En paix avec son passé il peut partir :
Je suis appelé à partir dans les premiers jours de janvier,avec un convoi destiné à être remis aux Soviets. […] Ma joie est inexprimable d’aller prendre ma part des peines et des labeurs de tous ceux qui en Russie, continuent l’immense entreprise de transformation sociale. […] Je vais pour ma part, vers l’incertain et l’inconnu avec une confiance absolue. Les plus dures épreuves n’ont fait que confirmer et assurer ma pensée – ma conception de la vie.
1937/38 – contre l’individualisme
20 ans plus tard il livrera deux retours sur ces années anarchistes, l’un (dans Esprit) subjectif, l’autre (dans le Crapouillot) politique.
Le texte du Crapouillot est un exercice de mauvaise foi :
par l’erreur individualiste, la pensée anarchiste se rattache le mieux à la philosophie bourgeoise […] On en voit bien la connexion avec le “laisser-faire, laisser-passer”, l’antiétatisme, l’individualisme des économistes libéraux, la philosophie positiviste d’un Herbert Spencer (l’Individu contre l’État).
(Victor Serge)Victor Serge prend garde d’ailleurs de sauver sa trajectoire personnelle. L’individualisme qu’il décrit c’est celui qu’a poursuivi E. Armand, lui qui est « en retard de plus d’un quart de siècle », qui n’a pas vu que l’industrialisation a produit la masse comme sujet :
La notion même de l’individu ou, mieux, de la personne, s’est modifiée; l’homme nous apparaît plus social que jamais, modelé, enrichi ou appauvri, diminué ou grandi par sa condition; instable, complexe, contradictoire même, car ce que l’on appelait son Moi est surtout le point d’intersection d’une multitude de lignes d’influences. Notre notion de la personne n’en est pas affaiblie, mais rénovée, replacée en quelque sorte dans l’ambiance.
Passons. Son récit de 37 est plus touchant. Son renoncement à sa jeunesse anarchiste apparaît comme un renoncement à s’aventurer dans la mer profonde de Nietzsche :
ce domaine immense, presque neuf, des connaissances dangereuses […] Et, en fait, il y a cent bonnes raisons pour que chacun en reste éloigné quand il le peut ! D’autre part, quand on y a échoué avec sa barque, eh bien, en avant ! serrons les dents ! ouvrons l’œil !
(Nietzsche)La « grande capacité de consentement » dont il parle se lit ainsi comme un échec :
La révolution n’apparaissait possible à personne, dans le grand calme d’avant-guerre. Ceux qui en parlaient, en parlaient si pauvrement que tout se réduisait à un commerce de brochures. […] L’anarchisme nous prit tout entiers parce qu’il nous demandait tout, nous offrait tout. Pas un recoin de la vie qu’il n’éclairât, du moins nous semblait-il. […] L’anarchisme exigeait avant tout l’accord des actes et des paroles, un changement total dans la manière d’être. C’est pourquoi nous allâmes à la tendance extrême (à ce moment), celle qui, par une dialectique rigoureuse, en arrivait, à force de révolutionnarisme, à n’avoir plus besoin de la révolution… […] L’individualisme venait d’être affirmé par Albert Libertad… Sa doctrine, qui devint la nôtre, était celle-ci : ’Ne pas attendre de révolution. Les prometteurs de révolutions sont des farceurs comme les autres. Faire sa révolution soi-même. Etre des hommes libres, vivre en camaraderie…’. Je simplifie évidemment, mais c’était aussi d’une belle simplicité : Commandement absolu, règle et ’que crève le vieux monde !’. De là partirent naturellement bien des déviations. […] On vit de jeunes végétariens engager des luttes sans issue contre la société entière. D’autres conclurent : ’Soyons des en-dehors, il n’y a de place pour nous qu’en marge de la société’, sans se douter que la société n’a pas de marge, qu’on y est toujours, y fût-on au fond des geôles, et que leur “égoïsme conscient” rejoignait, parmi les vaincus, l’individualisme bourgeois le plus féroce. Des troisièmes enfin, dont j’étais, tentèrent de mener de pair la transformation individuelle et l’action révolutionnaire […] L’individualisme anarchiste nous donnait prise sur la plus poignante réalité, sur nous-mêmes. Sois toi-même. Seulement, il se développait dans une autre ville-sans-évasion-possible, Paris, immense jungle, où un individualisme primordial, autrement dangereux, celui de la lutte pour la vie la plus darwinienne, réglait tous les rapports. Partis des servitudes de la pauvreté, nous nous retrouvions devant elles. Être soi-même eût été un précieux commandement et peut-être un haut accomplissement, si seulement c’eût été possible […] La nourriture, le gîte, le vêtement nous étaient à conquérir de haute lutte. […] Plusieurs camarades devaient glisser bientôt à ce qu’on appela l’illégalisme, la vie non plus en marge de la société, mais en marge du code. ’Nous ne voulons être ni exploiteurs ni exploités’, affirmaient-ils sans s’apercevoir qu’ils devenaient, tout en restant l’un et l’autre, des hommes traqués. Quand ils se sentirent perdus, ils décidèrent de se faire tuer, n’acceptant pas la prison. ’La vie ne vaut pas ça !’ me disait l’un, qui ne sortait plus sans son browning. ’Six balles pour les chiens de garde, la septième pour moi. Tu sais, j’ai le cœur léger’ C’est lourd, un cœur léger. La doctrine du salut qui est en nous aboutissait, dans la jungle sociale, à la bataille de l’Un contre tous. […] Le grand malheur de ces anarchistes fut que la révolution demeurât pour eux un mot utopique à peu près vide de sens. L’Occident d’avant-guerre en était trop loin. Plus qu’à mi-chemin de leur suicide, je restais attaché à d’autres arrières-pensées. De ma formation russe, je tenais le sentiment de la révolution, réalité concrète. Pour les Russes c’était la vie même ; et dès lors la vie avait un sens plein. […] L’anarchisme est centré en théorie sur un Homme (majuscule, n’est-ce pas ?), tantôt abstrait, tantôt contingent, le Moi (majuscule), le Moi, borné à lui-même, presque aveuglé dès lors sur l’univers et les hommes réels. Tu n’as que ta vie, toi-même, pas de meilleur exemple de la petite vérité – si évidente en apparence – fausse, parce que ses limites, d’ailleurs imaginaires (essayez de délimiterle Moi), la réduisent à rien. Combien plus vraie la pensée qui me replace, goutte d’eau dans le torrent, parmi les hommes en marche, en masses. Les masses importent plus que toi. On est remis à sa place, guéri de l’hypertrophie du moi, vilaine maladie. – Parce que tu as consenti à te perdre, tu te retrouveras et fortifié d’avoir touché la terre ferme. Ceci implique une grande capacité de consentement, car il faut d’abord comprendre, discerner les lignes de forces des événements pour peser dans le bon sens, s’intégrer à la nécessité, se faire un accomplisseur de ce qui doit être accompli.
Un retournement de l’individu à la masse, du Moi au Nous, auquel il met un point final dans ses Mémoires :
Le « je » me répugne comme une vaine affirmation de soi-même, contenant une grande part d’illusion et une autre de vanité ou d’injuste orgueil. Toutes les fois qu’il est possible, c’est-à-dire que je puis ne pas me sentir isolé, que mon expérience éclaire par quelque côté celle d’hommes avec lesquels je me sens lié, je préfère employer le « nous », plus général et plus vrai. On ne vit jamais que de soi, on ne vit jamais que pour soi, il faut savoir que notre pensée la plus intime, la plus nôtre, se rattache par mille liens à celle du monde.
(Victor Serge, dans ses Mémoires)
Conclusion
Il ne s’agissait ici ni de faire l’éloge de cette expérience historique, bien qu’on puisse en apprécier la justesse (l’absence de compromission, le pas de côté vis-à-vis du mouvement, avoir senti venir la guerre). Ni non plus de la jeter aux orties, ce qui serait trop facile – leur élitisme est forcé, leur destinée pathétique. On veut plutôt l’identifier à un penchant qui nous traverse, surtout dans cette nouvelle époque d’avant-guerre. Les citations que l’on a relevées ici, sont de ce point de vue éloquentes.
Alors que retenir ? On croit souvent que ces anarchistes sont morts de leur individualisme. Qu’ils sont tombés dans le piège tendu par Stirner : ensevelis sous les décombres même de ce qu’ils détruisaient. Morts seuls, en somme. Au contraire, ils ont tenté de tenir ensemble le moi-clos et le moi-qui-a-des-fenêtres, l’individu et sa camaraderie – qui reste le seul but. Vouloir vivre maintenant, tout en sachant que ce n’est que vivre-en-lutte. Tout en sachant que de la « grande vie » on n’arrachera que des fragments.
Ce qui les a perdus c’est moins leur individualisme, que de ne pas avoir surmonté l’échec de la camaraderie – la première période de la bande, à Montmartre autour de Libertad, quand ils étaient encore capables de rameuter autour d’eux quelques centaines d’agités. Les survivants ont affirmé, face notamment aux trahisons, la nécessité d’un plus grand élitisme (c’est la seconde période à Rambouillet autour de Serge), qui va conduire soit à l’inoffensive solitude (Armand), soit au suicide armé (Bonnot). Et qui poussera finalement Victor Serge à un violent demi-tour, après avoir échoué à marier Nietzsche à un universalisme anarchiste.
Les questions qui comptent sont malgré tout celles qui le travaillent à Barcelone en 1917-18 : « tous les événements depuis des années, ont confirmé […] nos déductions théoriques. […] Mais nous avons à tenir compte aussi de notre passé particulier. […] Que d’échecs… ». Il cherche alors à renouveler la tâche de l’individualiste, celui qui accepte de sortir de son refuge une fois les mauvais temps passés. Il constate que ses anciens camarades, pour certains ont été conséquents et en sont morts, pour d’autres sont « revenus de tout » et ont déserté l’Histoire. Il continue de suspecter au sein de la Révolution russe l’arasement des individualités, et pense encore que c’est à cet endroit même que doit se mener la lutte.
Ses questions restent d’actualité. 1. Comment, malgré l’inévitable critique des groupes et l’élitisme nécessaire à la survie, évite-t-on de s’enfoncer dans l’en-dehors (de l’en-dehors de l’en-dehors, etc.) dont on ne ressort plus le moment venu ? 2. Quelle est aujourd’hui la tâche révolutionnaire-individualiste, non plus face à la masse, mais face à l’hypertrophie de l’égo ?
Notes
-
Et que dire de l’Amérique ? C’est ce que note Murray Bookchin quand il déplore « un changement parmi les anarchistes euro-américains, les éloignant de l’anarchisme social vers l’anarchisme individualiste ou de style de vie. Cet anarchisme de style de vie trouve aujourd’hui son expression principale dans le nihilisme post-moderne, l’anti-rationalisme, le néoprimitivisme, l’anti-technologisme, le « terrorisme culturel » néo- situationniste, le mysticisme et une « pratique » de mise en scène des « insurrections personnelles » foucaldiennes ». ⤴️
-
Le premier recueil de textes de Libertad – que Vaneigem évoquait déjà dans son Traité de savoir-vivre – a été formé en 1976 par Roger Langlais, fondateur de l’Assommoir avec Jaime Semprun. Il en disait : « son existence même était intolérable : elle était la négation de l’hébétude, de l’instinct grégaire et de l’attachement à l’état de mort-dans-la-vie que perpétuent, d’une génération à l’autre, ceux-là mêmes que leur adhésion formelle à telle ou telle théorie révolutionnaire serait censée immuniser contre les repoussantes séductions du vieux monde. » Le même exercice sera fait pour Victor Serge par Yves Pagès en 1989. ⤴️
-
L’individualisme, pas encore stirnerien, commence à faire entendre sa voix. Parmi ces précurseurs, il y a évidemment Zo d’Axa : « Nous allons — individuels, sans la Foi qui sauve et qui aveugle. […] Nous nous battons pour la joie des batailles et sans rêve d’avenir meilleur. […] C’est en dehors de toutes les lois, de toutes les règles, de toutes les théories — même anarchistes — c’est dès l’instant, dès tout de suite que nous voulons nous laisser aller à nos pitiés, à nos emportements, à nos douceurs, à nos instincts — avec l’orgueil d’être nous-mêmes. » Dans l’En dehors (91-93) il publie à la fois des militants (de Jean Grave à Émile Henry) et des écrivains : Fénéon (qui éditera plus tard Gide, Proust, Apollinaire), Mirbeau (« Je ne crois qu’à une organisation purement individualiste »), Verhaeren. Les autres revues individualistes des années 90 ont d’ailleurs souvent un pied dans le milieu littéraire ou artiste : L’Escarmouche (93) de Georges Darien, illustré par Toulouse-Lautrec (l’écrivain est aussi membre du groupe illégaliste La Panthère des Batignolles : « Entrez dans les boulangeries, les magasins, entrez partout. Tout vous appartient ») ; Demain (96) de Han Ryner (qui est autant l’auteur de L’homme-fourmi que du Petit Manuel individualiste) ; Sur le Trimard, de Mecislas Golberg (l’ami d’Apollinaire, de Gide, de Matisse et Rodin). Les premières mentions de Max Stirner (avant l’édition française en 1900 de L’Unique) apparaissent dans des revues littéraires : La Revue blanche de Fénéon, ou Le Mercure de France de Remy de Gourmont. ⤴️
-
La scission nette avec les socialistes date en France de 1880, juste après l’échec de l’AIT. Jean Grave (qui collaborait peu de temps avant à un journal guesdiste) se fait le relai de Kropotkine et affirme préférer « la dynamite au bulletin de vote ». Jules Guesde lui répond que la bourgeoisie peut dormir tranquille face à ce demi-quarteron d’anarchistes. Un rapprochement (non avec les guesdistes mais avec les allemanistes) est pourtant déjà tenté en 1894-96 par Pelloutier, Malatesta, Pouget, Hamon. Jaurès fait alors le constat que l’anarchisme : « est en pleine transformation. Il est visible qu’[il] regrette les éléments individualistes, et il est bien près de changer même de nom : il s’appelle de plus en plus communisme anarchiste […] Un pas de plus et il acceptera la représentation dans les Parlements […] il ne sera plus qu’une protestation dans le socialisme même ». Mecislas Golberg, dans le journal individualiste de Pierre Martinet, s’en prendra publiquement à cette tentative de rapprochement. Première tentative qui de toute façon échouera. ⤴️
-
Ces alliances ne participent pas nécessairement à une pacification du mouvement. On peut prendre l’exemple de la participation d’anarchistes au journal antimilitariste la Guerre sociale (et ses Comités de défense sociale) fondé par un socialiste, Gustave Hervé, qui deviendra d’ailleurs fasciste (« Peu de temps avant sa mort, il se décrivait comme le premier bolcheviste, le premier fasciste, le premier pétainiste, le premier membre de la Résistance et le premier gaulliste »). Il semble que les membres de la rédaction animaient aussi un réseau clandestin de saboteurs (l’Organisation de Combat puis les Jeunes gardes révolutionnaires), principalement composé de libertaires qui prônaient l’action révolutionnaire « sans étiquette », qui s’en prit notamment, au niveau national et de manière coordonnée, aux voies de chemin de fer ou au réseau télégraphique et ambitionnait des attentats contre la police avant 1914. ⤴️
-
Il faut noter l’existence d’un premier groupe d’individualistes dès 1890 autour de Pierre Martinet (la revue Renaissance, 1895). Jean Grave estime que c’est lui qui a introduit le premier les idées « ultra- individualistes » dans le mouvement. Quant à la police : « Voyez toutes les bagarres qui se sont produites dans les réunions depuis deux ans […]. C’est toujours Martinet qui propose, et son troupeau qui le suit ». Sa doctrine est assez pauvrement utilitariste : « Ce n’est pas de la recherche du bien-être général que peut découler le bien-être particulier. C’est de la recherche du contentement individuel que s’augmente la richesse dont peut profiter la collectivité. ». Son disciple Eugène Renard, fameux émeutier, fut tout de même l’un des premiers à faire la promotion de Stirner dans le milieu anarchiste. On le retrouvera auteur d’un article dans l’anarchie en 1905 (« Qu’est-ce que l’individualisme ? »). Il était en fait depuis longtemps indicateur de police, signant ses rapports sous le pseudonyme de « Finot ». Enfin il peut être utile de préciser que ces groupes n’ont alors pas le monopole de “l’individualisme”. Comme le dit Malatesta : « Tous les anarchistes, à quelque tendance qu’ils appartiennent, sont d’une certaine façon individualistes ». Par exemple, ma « culture du Moi » est aussi un mot d’ordre de Pelloutier. Et on ajoutera même que la politisation du « culte du Moi », n’est pas propre, dans ces années-là, aux anarchistes. On pense par exemple à Barrès : ici, l’ascèse morale, amène à redécouvrir la tradition. ⤴️
-
Les Causeries s’articulent autour de deux réunions hebdomadaires, l’une à thème, préparée par un intervenant, l’autre sans sujet fixé à l’avance, qualifiée de « discussion entre camarades ». ⤴️
-
Le Libertaire de Faure s’est convertit à l’approche de la guerre au modèle fédératif, au syndicalisme, au 1er mai, à la grève réformiste. Il lance en 1910 un appel à « L’alliance communiste anarchiste ». Les Temps nouveaux de Grave soutient de son côté les congrès comme moyen de se rencontrer, mais s’oppose toujours au parti révolutionnaire. Grave prône encore en 1913 l’organisation cellulaire (« la véritable organisation anarchiste ») et l’Internationale anarchiste. ⤴️
-
Lorulot (co-créateur de l’anarchie et directeur de 1909 à 1911). Organisation décrite dans l’Organisation cellulaire qu’il fait publier dans Le Libertaire en 1906. ⤴️
-
Le groupe des Causeries est un genre d’opposant interne au « style » de Montmartre, quartier alors à la mode. Libertad tient à une certaine façon de « danser et faire les fous ». Charles d’Avray, chansonnier des cabarets de la Butte est l’un des membres des Causeries (sa chanson Le triomphe de l’anarchie a traversé le siècle : « Dès aujourd’hui, vivons le communisme, Ne nous groupons que par affinités », etc.). ⤴️
-
Viktor Lvovitch Kibaltchitch. Il signera d’abord ses textes “Le Rétif”, puis Victor Serge à partir de 1917. ⤴️
-
Sophia Zaïkowska, en 1912, raconte à propos du journal : « Il a à tel point influencé certains lecteurs, que lorsque je rencontre certains individualistes, je sens que ce sont des gens qui me sont proches, qui se distinguent par leur genre de vie du reste de l’humanité. […] C’est une philosophie qui a passé dans la vie. » ⤴️
-
Son fondateur, Gustave Hervé, s’est alors converti au nationalisme et renommera le journal La Victoire. ⤴️
-
Ministre de l’Intérieur, dont la stratégie était de tenir les pacifistes sous contrôle. En l’occurence il « tient » Sébastien Faure du fait de son arrestation, restée secrète, aux Buttes Chaumont pour attentat à la pudeur. ⤴️
-
« Lejeune s’habillait de drap anglais, portait du linge de soie et des feutres Mitchell noir ou gris selon le temps. L’allure d’un homme d’affaires posé, habitué des bons restaurants […] Il préférait les établissements à deux issues et, là, certains angles où on pouvait disparaître à peu près, adossé, derrière un journal déplié. Son nom insignifiant n’était connu que d’un petit nombre d’entre nous. Son passé n’était connu de personne. Des camarades se souvenaient de l’avoir appelé Levieux à Paris et à Londres une quinzaine d’années auparavant. » (VS) ⤴️
-
Quand VS disait encore dans l’anarchie : « On peut se révolter pour soi et pour les siens – anarchiste pour les anarchistes – sans se préoccuper de la souffrance des seigneurs et des serfs » (VS) ⤴️
-
« Au point de vue social, liberté et solidarité sont termes identiques : la liberté de chacun rencontrant dans la liberté d’autrui, non plus une limite, comme dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793, mais un auxiliaire, l’homme le plus libre est celui qui a le plus de relations avec ses semblables » (Proudhon) « Je ne deviens libre vraiment que par la liberté d’autres, de sorte que plus nombreux sont les hommes libres qui m’entourent et plus profonde et plus large est leur liberté, et plus étendue, plus profonde et plus large devient ma liberté.» (Bakounine) ⤴️
-
Sauf Yves Pagès, qui dans une réédition des textes de Victor Serge parus dans L’Anarchie, titrera sa préface « La pièce manquante d’un nietzschéisme de gauche » – pièce manquante parce que VS s’oppose dans son texte « aux errements de l’aristocratisme libertaire » d’un Palante, d’un défunt situationnisme et à la rhétorique hautaine d’une « politique du mépris » qui lui a survécu. ⤴️
-
-

Le néolibéralisme est mort
Vive le néolibéralismeSe poser la question d’un retour aujourd’hui du fascisme implique d’une part de se demander si l’on n’a pas affaire à quelque chose de tout autre (le technofédoalisme) mais aussi de considérer ce qu’il est advenu du régime “précédent”, qui s’est justement constitué officiellement à la fois contre le fascisme et contre le socialisme, non sans assumer un noyau autoritaire : le néolibéralisme. Dans un premier article (celui-ci) on se demandera ce qui permet de parler de mort du néolibéralisme ou de sa perpétuation sous une forme “zombie”. Dans un second article on verra comment, épuisé et soumis à des tensions internes et externes, il pourrait avoir fini par muter. Enfin, dans un troisième article conclusif on se demandera si ces mutations ne sont pas autant de portes ouvertes vers d’autres régimes et d’autres imaginaires politiques. Et comment ceux-ci peuvent s’articuler.
Le néolibéralisme est mort, vive le néolibéralisme
À Seattle en 1999 ou à Gènes en 2001, la lutte contre le néolibéralisme prenait la forme d’un siège. Celui d’une citadelle inexpugnable, défendue par des miliers de policiers et militaires, abritant les instances internationales décidant de l’avenir du monde. Le néolibéralisme semblait solide, arrogant, indéboulonnable et ne reculant devant rien pour se maintenir.
Il était peut-être en réalité plus fragile qu’il n’y paraissait. La crise de 2008, l’élection de Trump, l’helicopter money ou le “quoi qu’il en en coûte” du Covid, des fissures seraient une à une apparue le long de l’édifice, semblant s’approfondir jusqu’à le mettre en péril. Le point de bascule n’est pas à chercher du côté de l’intervention publique en soutien aux marchés - on le sait, le néolibéralisme (et c’est cela qui le distingue du libéralisme classique) accepte ou plutôt requiert l’intervention politique. C’est ce qu’affirmait Walter Lippmann il y a un siècle dans The Good Society : les marchés ne sont pas des émanations naturelles, mais construits par l’homme, sous-tendus par des lois humaines, maintenus par des institutions. La question n’est pas plus celle de l’autoritarisme - on sait que le néolibéralisme veut protéger l’économie de la démocratie. Les penseurs néolibéraux ont toujours cru en un Etat fort, certes guidé par des normes et des limites strictes.
Acte de décès
Mis bout à bout, que dessinent les interventions des banques centrales, les rachats de dettes, le quantitative easing, le contrôle du spread des taux, 1000 milliards de dette rachetées dans la zone euro, la banque centrale du Japon qui détient 8% de la capitalisation boursière du pays ? Et si on ajoute à cela une pincée de plans de relance (6 billions de dollars juste pour les USAs), une once de too big to fail, la transformation des banques centrales en nouvelles assurances anti-faillites garantissant les revenus futurs ? C’est le sacro-saint principe du marché qui se trouve désavoué. Ajoutons la guerre commerciale entre la Chine et les US, la fragilisation des chaînes d’approvisionnement, l’économie de guerre, les prix planchers et le protectionnisme tous azimuts, c’est l’utopie globaliste d’un monde sans frontière où les États seraient réduits à peau de chagrin, qui est écornée. Et le rêve d’une société dépolitisée, peuplée d’homo oeconomicus pacifiés et rationnels, piétiné (populisme, Trump, Bolsonaro, le Capitole, gilets-jaunes et gros-biceps). Il paraitrait même que finalement, “there really is such a thing as society”. Pour ceux qui doutent encore, ajoutons que les “Move Fast and Break Things” et “Competition is for loosers” qui ont fait le succès des Thiel et Zuckerberg ont effectivement participé à ébranler l’édifice. Enfin, la multiplication et l’intensification des guerres couplées à la crise écologique finira par rendre flagrant l’évidence : le néolibéralisme n’est plus. Même son principal soutien politique, le parti démocrate américain, qui en fit la promotion idéologique sous Clinton comme sous Obama, semble l’avoir abandonné. Désormais, soutenu en cela par quelques bailleurs privés qui ont senti le vent tourner, il veut faire croire à un “nouveau consensus de Washington” (selon le discours de Jake Sullivan en 2023). Nous serions donc entrés dans cette nouvelle ère “post-néolibérale”, d’un nouveau dirigisme économique et politique - d’aucuns voyant là le terreau d’un “néo-fascisme”, d’un “néo-fordisme”, d’une “néo-réaction”, voire d’un nouveau néolibéralisme (selon sa niche universitaire).
Le plastique c’est fantastique
Mais n’est-ce pas aller un peu vite en besogne ? Idéologiquement, le néolibéralisme est plastique et hétérogène. Ce n’est pas une doctrine figée, encore moins une vulgate, mais plutôt un espace organisé selon différents pôles.
La tension global-national
Quinn Slobodian a montré qu’au cours des années 90 un clivage s’est affirmé en son sein, scission entre globalistes et nationalistes, les premiers continuant de soutenir que le projet néolibéral doit être réalisé par l’intermédiaire de traités, institutions et législations supranationales, tandis que les seconds veulent faire primer l’échelle nationale et les traités bilatéraux. L’un des points de cristallisation de la controverse est la question de la construction européenne, projet évidemment soutenu par les uns et contesté par les autres. Déjà, dès les années 50, Wilhelm Röpke, chef de file des ordolibéraux, voyait dans le projet globaliste une menace pour les libertés individuelles et pour la diversité culturelle, l’incarnation de la modernité technocratique et le risque d’un futur État-providence supranational. Bref, une (auto)route vers la servitude.
La suite de l’histoire est connue : la multiplication des traités de libre-échange, la construction européenne ou encore la fondation de l’OMC témoignent du succès des globalistes pendant les années 90 et 2000. Or, c’est ce succès qu’ont remis en question le Brexit et l’élection de Trump, plus que le néolibéralisme lui-même. Le Brexit n’est pas juste une réaction des laissés pour compte de la mondialisation, avides de retrouver leur souveraineté, ou un rêve de vieux conservateurs aux accents réactionnaires. Il s’agit aussi d’un projet politique néolibéral et nationaliste dont on trouvait déjà la trace dans le discours de Thatcher à Bruges en 1988 : “Nous n’avons pas réussi à faire reculer les frontières de l’Etat en Grande-Bretagne pour les voir réimposer au niveau européen avec un super Etat européen exerçant sa nouvelle domination depuis Bruxelles.” (“We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them re-imposed at a European level with a European super-state exercising a new dominance from Brussels”). Dans cette lignée, l’Europe est perçue comme un poids et une entrave pour le libre fonctionnement de l’économie britannique, le Brexit devant permettre au Royaume-Uni de se libérer et d’approfondir la dérégulation. Comme le dit fièrement le think-thank néolibéral Institute of Economic Affairs : “Hayek would have been a Brexiteer” !
Un conservatisme historique
L’espace du néolibéralisme se structure également dans une tension entre des pôles conservateurs et progressistes, le positionnement variant d’une période à l’autre. La phase de destruction de l’État-social, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, s’est fait dans le cadre d’un projet conservateur, incarné par Thatcher et Reagan. Avec d’un côté, There’s No Such Thing as Society et la destruction des obstacles entravant l’économie, et de l’autre, un appel constant à la famille, à la chrétienté, à l’homophobie, au militarisme. Ces projets politiques restaient cohérents avec les sources théoriques dominantes du néolibéralisme. Chez Hayek et Röpke on retrouve une même admiration pour Burke, une même haine de la démocratie et des masses, une même volonté de verrouiller la société par l’élitisme et l’aristocratisme. Le premier a rédigé des constitutions alors que le second pensait que la solution se situait surtout dans le social et les valeurs. D’ou une ode à la paysannerie :
qui concilie de manière idéale vie et travail, production et consommation, espace d’habitation et espace de labeur, nature et activité humaine […], développement indépendant de la personnalité et chaleur du contact social. [La paysannerie] oppose à la face industrielle et urbaine de notre civilisation tradition et persévérance […], mesure et sérénité, existence non artificielle […], unité de l’existence et insertion humble dans la chaîne du devenir et de la mort.
Ringard ? C’est le moins qu’on puisse dire, tant le néolibéralisme est aujourd’hui devenu synonyme de la société de consommation, de la marchandisation sans limite (jusqu’au corps : capital humain, sexuel ou biométrique) et des excès des goldenboys et des yuppies.

Mais un penchant progressiste
Le néolibéralisme n’est pourtant pas pure contrainte, pur nihilisme ou pure aliénation. Son succès repose sur sa capacité à capter et canaliser les désirs, même d’émancipation. C’est ainsi qu’un néolibéralisme progressiste, mélange entre des erzats d’idéaux d’émancipation, une financiarisation et une dérégulation sous-stéroïdes, a pu être incarné par Tony Blair au Royaume-Uni, la gauche caviar en France, tous deux précédés Outre-Atlantique par les “New Democrats” :
In place of the New Deal coalition of unionized manufacturing workers, African Americans, and the urban middle classes, he forged a new alliance of entrepreneurs, suburbanites, new social movements, and youth, all proclaiming their modern, progressive bona fides by embracing diversity, multiculturalism, and women’s rights. Even as it endorsed such progressive notions, the Clinton administration courted Wall Street. Turning the economy over to Goldman Sachs, it deregulated the banking system and negotiated the free-trade agreements that accelerated deindustrialization.
(Nancy Fraser)L’époque combative du néolibéralisme [avec pour objet la destruction du socialisme, sous l’impulsion de Thatcher et Reagan] a été suivie d’une période de 20 ans de “néolibéralisme normatif” [sous l’impulsion donc du parti démocrate], qui était une tentative d’imposer le marché comme la mesure ultime et incontestée de la valeur - non seulement par rapport aux sphères dans lesquelles le mécanisme des prix était présent, c’est-à-dire les sphères d’échange économique, mais aussi aux sphères où le mécanisme des prix était absent. [Il] ne s’agit pas simplement d’essayer de défendre le marché sur le terrain de la liberté économique - ce que le libéralisme avait fait pendant 300 ans - mais en fait d’affirmer certains mécanismes d’évaluation et d’évaluation économiques comme les dénominateurs ultimes de l’organisation de la société.
(William Davies)Une gouvernementalité de crise, une subjectivité en crise La capacité du néolibéralisme à se réagencer s’explique par son hétérogénéité, ses tensions internes (nationalisme-globalisme, progressivisme conservatisme), mais aussi parce qu’il a fait des crises un outil de gouvernance :
Le remède n’est plus là pour mettre fin à la crise. La crise est au contraire ouverte en vue d’introduire le remède. (…) [Proclamer la mort du néolibéralisme après 2008] c’est de n’avoir pas compris que la «crise» n’était pas un fait économique, mais une technique politique de gouvernement (…) Nous ne vivons pas une crise du capitalisme, mais au contraire le triomphe du capitalisme de crise.
(À nos amis)Elle a mis un peu de temps à prendre forme, mais il semble qu’une stratégie du choc cohérente est en train d’émerger de la pandémie. [Elle] se dessine à toute vitesse, alors même que les corps continuent de s’entasser, et fait des semaines d’isolement physique que nous avons vécues non pas une douloureuse nécessité destinée à sauver des vies, mais un laboratoire à ciel ouvert, avant-goût d’un avenir sans contact, permanent et hautement profitable.
(Naomi Klein)It’s certainly early days, and I can only speak to the American context, the discussions I’ve been following. You don’t hear about these game plans in the media. But they are talking about specific things — for example, all kinds of successes, from their point of view, with regard to medical developments. […] These are the sorts of projects they’ve long had on the back burner. And now they see, “this is our chance.” Partly as an unintended consequence of the crisis, but also because the neoliberals are poised and ready to give it the final nudge to make these things happen.
(Philip Mirowsky dans How Neoliberalism Will Exploit the Coronavirus Crisis)
Tel le chat, le néolibéralisme retombe toujours sur ses pattes. Mais au-delà de sa capacité à tirer profit des crises, la preuve de la permanence de son règne ne se lit-elle pas dans la permanence de son produit le plus réussi : l’homme néolibéral ?
[Les néolibéraux] ont changé le sens de ce qu’est un marché [non plus comme une allocation de ressources rares, mais] comme un problème épistémique - le marché est le plus grand processeur d’information connu de l’humanité.
(Mirowsky)Le néolibéralisme est une rationalité, le marché devient une (voire la seule) forme d’objectivité et de connaissance. L’État étant réduit à un rôle de garant des règles dun jeu (et soulagé du rôle de garant de la cohésion sociale), c’est le marché qui produit non pas une société mais une diversité d’opinions, de modes de vie, de valeurs, de choix, de goûts. Il en découle une contamination de cette rationalité économique (la concurrence en particulier) à des domaines jusqu’alors non marchands de l’existence humaine. La santé et l’éducation bien sûr, mais jusqu’aux nations, villes et régions entières qui peuvent être considérées comme des acteurs compétitifs. En passant par le “moi”.
Vous faites des investissements en vous-même et vous vous attendez, avec certes une profonde incertitude, à en récolter les fruits à l’avenir. Dans le même temps vous marketez votre apparence. Et tout cette logique d’autogestion s’étend à la recherche d’emploi mais aussi aux relations entièrement non marchandes telles que la recherche d’un date, d’un conjoint ou d’un ami”
(William Davies)La concurrence produit… une sorte de contrainte impersonnelle qui oblige de nombreux individus à adapter leur mode de vie d’une manière qu’aucun ordre ou instruction délibérée ne peut provoquer ».
(Hayek)C’est ce qu’avait très tôt identifié Foucault, en se penchant sur la théorie du capital humain : à la vision néolibérale du marché correspond un nouvel homo oeconomicus, “l’entrepreneur de soi”.
Or, La subjectivité néolibérale n’est pas l’appanage du winner, du jeune cadre dynamique (par ailleurs triathlète, adepte d’un régime no-glu paléo et réalisant ses exercices respiratoires de 5h à 6h du matin pour débloquer le potentiel productif de son cerveau). Elle s’est diffusée à l’ensemble de la société, elle est partout et même là où on l’attend le moins : dans les salles de sports cheaps, sur les applis de rencontre, dans les milieux radicaux ou réactionnaires et même dans les sphères religieuses (islam de marché, développement personnel chrétien, coaching judaïque etc.).

La subjectivité néolibérale s’est même raffinée depuis les années 80. Wendy Brown parle d’un glissement d’une “forme entrepreneuriale de néolibéralisme, vers une autre forme profondément infléchie par la financiarisation”. Il ne s’agit plus d’être sa “petite entreprise” mais de se considérer comme un portefeuille d’actifs “en quête de crédit, c’est-à-dire se compren[dre] comme investissant [soi]-même dans son propre capital humain, et comme espérant des autres qu’ils investissent également dans celui-ci”. Dès lors, la rétribution dépend moins d’une production effective que de la mise en scène d’une capacité potentielle à produire. Logique de l’influenceur1.
Mais n’y a-t-il pas un épuisement de ces subjectivités dont les nombreuses pathologies de l’époque sont les symptômes : TDAH, dépression, burn-out, troubles bipolaires, workaholic, addictions, bigorexie etc. ? C’est ne pas voir que comme les néolibéralismes, les subjectivités qu’il produit sont résilientes. Il faut que ces subjectivités soient fracturées, fêlées, si ce n’est brisées, pour pouvoir se renforcer. L’essor du cross-fit (parmi d’autres pratiques sportives extrêmes) en est un exemple : pratiqué majoritairement par des cadres, il essore le pratiquant, qui doit pousser toujours plus lourd, éxécuter des mouvements toujours plus rapides, pour brûler toujours plus de “cal” sur une bande-son au rythme effréné, pour oublier la douleur, mais aussi le vide. La lenteur de l’apprentissage ? Le pratiquant décline, il s’ennuie, veut souffrir, se donner le sentiment d’être un “survivant”, que ce qui ne tue pas le rend plus fort. No pain, no gain. Trop collectif ? Optez pour l’ultra-trail. Pas assez d’adversité ? Passez au MMA. Pratiquez-les de la même manière, et surtout faites-le savoir.
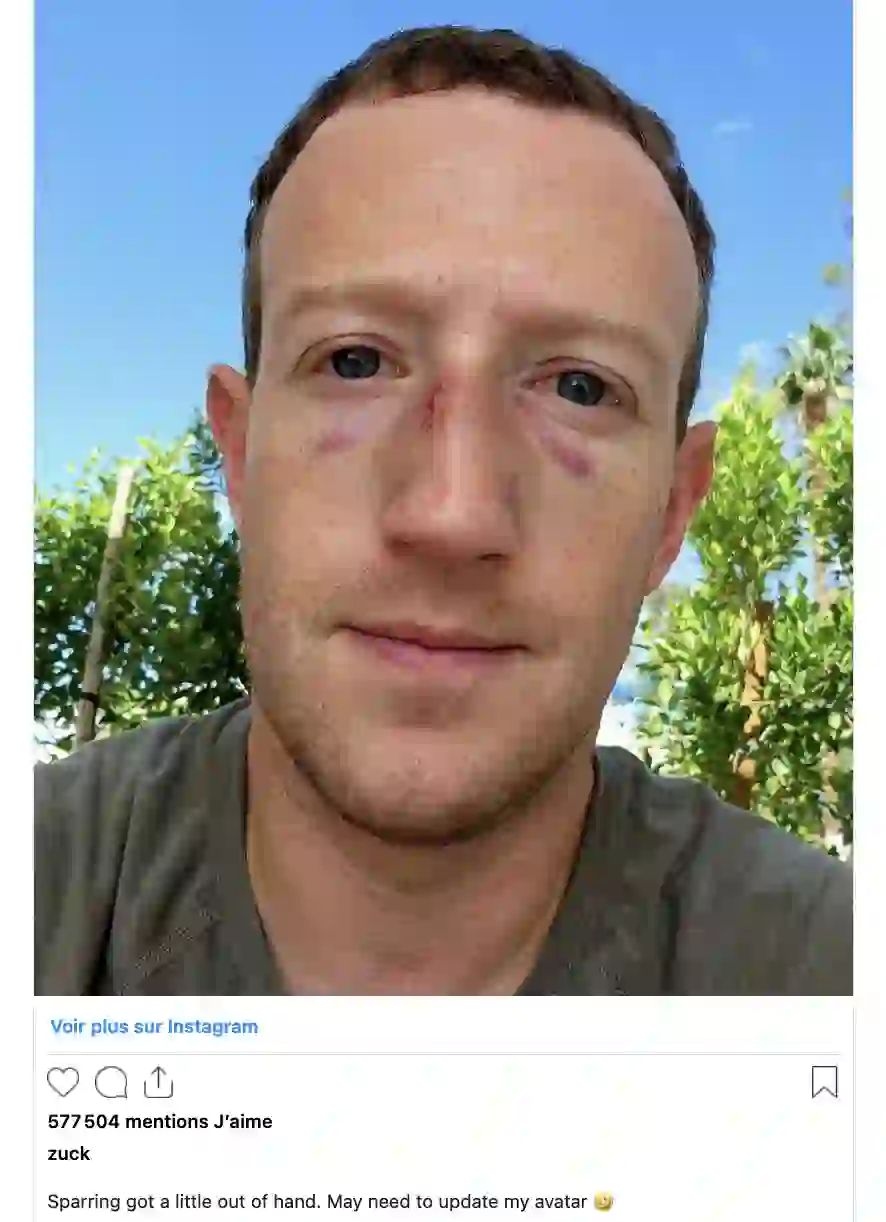
La persistance du néolibéralisme grâce à sa reconfiguration
Croire à la fin du néolibéralisme c’est croire au fait qu’il ait pu exister par le passé dans une version pure et globalisée. Dans laquelle l’ensemble de ses plans (idéologique, économique, politique, subjectif) auraient été parfaitement articulés. Il n’y a pas eu d’âge d’or du néolibéralisme (ou sur un temps court - entre les années 90, de la période de la Troisième Voie, de la mondialisation et des Nouveaux Démocrates jusqu’à l’entrée de la Chine dans l’OMC en 2001 - et dans des endroits particuliers du globe). Est-il vraiment en train de rendre son dernier souffle ? À regarder ses effets on répondra de toute évidence, non. L’ensemble semble si souple qu’il parait incassable. À l’image de ses subjectivités, les “crises” de ces dernières années pourraient l’avoir stimulé et revivifié.
À l’inverse, la tendance qui consiste à repérer dans toute interaction sociale sa permanence (la permanence de la crevardise, qu’importe le régime politique ou les politiques économiques) ne peut mener qu’à la cécité. On finit ainsi par admettre (souvent, il faut le dire, pour garantir la survie de chaires d’études foucaldiennes sur le sujet) l’existence d’un néolibéralisme des plans des plans de relance, d’un néolibéralisme coiffé d’une tête de bison, d’un néolibéralisme anti-libéral. Enfin, en observant le néolibéralisme uniquement depuis ses points d’applications, depuis les micro, bientôt les nano-pouvoirs, on prend le risque de perdre toute profondeur de champ. On prend le risque de parcelliser l’analyse à l’infini. On en vient à accepter de ne plus voir de plan d’ensemble et finalement assumer à la fois de ne plus rien comprendre, et qu’il n’y a pas d’issue.
Comprendre les reconfigurations implique de partir des tensions qui animent le néolibéralisme - pour le maintenir en vie, mais à quel prix pour lui ? Des tensions internes et critiques externes venant d’au-delà de ses pôles : titillé par le paléoconservatisme, titllé par le libertarianisme. Or ces mises en tensions et leurs exacerbations ne sont pas sans conséquence (sinon on n’en parlerait pas). S’il n’y a jamais eu d’articulation parfaite entre ses plans, le plan des politiques publiques, celui de la doctrine, celui du régime économique mondial, et celui des sujets, il faut constater un niveau de désarticulation extrême. Bien qu’il soit résilient, et même s’il résiste, même s’il sait se placer dans l’ombre, même s’il se pare de faux-nez, il finit par être modifié par ses propres efforts de contorsionisme. Il finit par muter. Pour le pire ?
Rendez-vous au prochain épisode…
Notes
-
Pour les plus curieux, notre première livraison analysait, sous un autre angle, ce raffinement de la subjectivité néolibérale. ⤴️
-
-

Fight, fight, fight
Édito - juillet 2025L’atmosphère est chaque jour qui passe plus pesante. On pense moins à la “menace fasciste”, qu’au fait de s’habituer - que l’on nous habitue - à la mort en masse. Et sa sélection sous-jacente : “our only fault was that we were just classified as inferior”, comme dit un médecin palestinien et sûrement beaucoup d’autres. Face à cette pesanteur, qu’on devrait aussi nommer “défaite”, deux réflexes : se tenir chaud, ensemble, tous ensemble, tout à gauche du radeau de la méduse ; ou lâcher du lest pour s’élever dans le ciel des idées, on y trouvera bien quelques réponses et, à défaut, le sentiment d’être au-dessus de la mêlée. Dans les deux cas, cela correspond au funeste oubli d’une tradition qui, dans le reflux aussi, dans la minorité de la minorité, a infantigablement cherché un coin. Non pas un refuge, mais un coin à enfoncer. C’est encore là que l’on veut se situer.
-

La tradition des vaincus – les Nizârites
Quiétisme ou révolution ?A la fin, je ne sais plus quel visage m’apparait : celui des ismaéliens, celui des compagnons aujourd’hui rencontrés ? Hors religion, hors politique, que ce visage transparaisse de lui-même, s’il le peut. Il n’importe qu’il le puisse tout à fait, si la transparition des uns et des autres laisse monter à la surface du sensible quelques contours inaccessibles à la perception soumise et aux savoirs convenus
C. JambetLa tradition des vaincus ne se limite pas aux insurrections prolétariennes du XIXème siècle. Les opprimés n’ont pas attendu qu’un vieux barbu blanc publie le Capital pour se constituer en communauté, et se soulever. En d’autres temps, en d’autres lieux, la révolte s’est exprimée dans un langage religieux et prenait la forme d’hérésies. Nombres d’entre elles, principalement juives et chrétiennes, ont trouvé une place dans la tradition des vaincus : les franciscains, maître Eckart, T. Münzer et la guerre des paysans, Sabbataï Tsevi et les sabbatéens, Jacob Frank, la théologie de la libération… Le retour du théologico-politique nous pousse à nous replonger dans ces traditions, lieu d’un noeud particulièrement important pour Foucault :
Le concept de “l’histoire-insurrection” [opposé à celui de “l’histoire romaine de la souveraineté”] s’inscrit donc dans la perspective de la prophétie biblique, telle qu’elle est reprise et historisée par le discours de la révolution, lorsque celui-ci n’est pas encore, ou n’est plus le discours de la souveraineté, de sa conquête et de sa mutation. Saisir cet instant génératif où la guerre l’emporte sur l’enjeu de la souveraineté (…) tel est l’enjeu de cet effort théorique sans précédent. On le voit, Foucault a affaire à deux types d’oubli qu’il essaie de dissiper : l’oubli du discours prophétique et l’oubli de la guerre, du duel des histoires. L’opposition de la “révolte” et de la “révolution” ne se conçoit qu’à ce prix. D’un côté, comprendre pourquoi, depuis les conflits d’interprétation de l’Ecriture à la Renaissance, jusqu’aux batailles théologiques et mystiques du XVIIème siècle européen, quelque chose s’est noué entre révolte et recours au texte sacré. D’un autre bord, comprendre pourquoi ce nouage s’est soumis peu à peu à la très ancienne problématique de la souveraineté. Sans cet arrière-plan historique, l’intérêt extrême pris soudainement par Michel Foucault à l’insurrection du peuple iranien et à l’inscription eschatologique du shî’isme deviendrait incompréhensible
(Jambet, 2010).Hormis la tentative de Foucault en 78, les hérésies musulmanes sont moins connues. Et pour cause : aux yeux des révolutionnaires occidentaux, l’institutionnalisation de la République islamique d’Iran à la suite de la révolution de 79 a fait définitivement basculer l’islam chiite dans la catégorie d’idéologie du pouvoir. La montée en puissance du djihadisme au début du XXIème siècle a alimenté la perception d’un islam certes résistant à l’Occident, mais réactionnaire et nihiliste. De façon générale, la tendance est moins aux monothéismes qu’aux sorcières, non-humains et indiens pour pallier la crise de spiritualité des radicaux. Comme leurs contemporains, leur conscience est marquée par l’exotisme et la (post)modernité. Baignant dans le régime du doute et le sécularisme, ils sont incapables de prendre au sérieux la religion, de se confronter réellement à l’Un. Les jeunes-vieux-maos ont une perception utilitariste du religieux (« si c’est la croyance des opprimés alors… »), les new age mettent quelques gouttes de Rûmi dans leur bouillie où tout se vaut.
Ce qui suit est une brève histoire d’une tendance marginale de l’islam chiite : le nizarisme. Ce courant est plus connu sous le nom de « secte des assassins », dirigée par le « vieux sur la montagne » depuis son bastion d’Alamût. Un ensemble de légendes noires y sont associées, la plus répandue fait dériver le mot « assassin » du terme arabe « hashish ». Le fanatisme supposé des nizarites s’expliquerait par la consommation de drogues. Ils seraient les précurseurs des djihadistes du XXIème siècle, consommant du captagon avant de tirer aveuglément dans la foule pour atteindre le martyr. Là encore, on retrouve l’impossibilité pour l’Occident d’envisager que la puissance de la foi pousse le croyant à mettre sa vie en jeu. Il y aurait forcément des raisons profanes que la criminologie et la sociologie se chargeront de débusquer. Au contraire, nous avons trouvé dans la pensée nizârite une véritable puissance. Non pas une puissance mortifère mais une puissance destituante qui s’appuie sur une interprétation particulière de la taqiya, de la mystique et de la liberté à même d’alimenter notre « faible force messianique » (Benjamin).

Les premiers chiites entre quiétisme et révolution :
Le chiisme apparaît à la mort du prophète en 632 dans le cadre du conflit autour de sa succession. Si on devait simplifier à l’extrême, les chiites sont les partisans d’Ali, cousin et gendre du prophète. Ils le considèrent comme le successeur légitime en raison de sa relation avec le prophète mais aussi et surtout de son statut d’imam (divinement inspiré). Pour les chiites, l’imam doit révéler le sens ésotérique du Coran, et ce faisant achever la Révélation. L’imamat se transmet par le sang : une fois Ali assassiné, c’est son fils Hasan qui reprend la direction de l’imamat, à sa mort son frère lui succède etc. À l’opposé, les sunnites ne reconnaissent pas ce statut à Ali et pensent que le successeur du prophète, le khalife, le dirigeant de la oumma, doit être choisi par les croyants. À la suite de plusieurs évènements le schisme s’affirme et les sunnites s’imposent. Les trois premiers califes sont sunnites, Ali est le quatrième mais il est assassiné et le pouvoir est pris par les dynasties sunnites Ommeyade et Abbasside.
Le schisme entre sunnites et chiites s’effectuent sur des bases théologiques et politiques :
Le premier siècle de l’expansion islamique connut maintes périodes de tensions, et nombre des rancœurs et des aspirations qu’elles suscitèrent s’exprimèrent par la dissidence et la révolte. La propagation de l’Islam par la conversion fit entrer dans la communauté musulmane une masse de nouveaux fidèles qui apportaient avec leur formation chrétienne, juive ou iranienne, des concepts et des comportements religieux inconnus des premiers musulmans arabes. Ces nouveaux croyants, quoique musulmans, n’étaient pas des Arabes et encore moins des membres de la noblesse ; la position sociale et économique inférieure que l’aristocratie arabe dominante leur accordait a éveillé chez eux un sentiment d’injustice (…) Une fois convertis à l’Islam, ils étaient immédiatement séduits par les revendications légitimistes des descendants du Prophète qui leur paraissaient pouvoir mettre un terme aux iniquités de l’ordre existant et permettre l’accomplissement de la promesse de l’Islam.
(Lewis, 2019, p. 66)Divinement inspiré et ayant accès à la dimension ésotérique du texte sacré, l’ordre instauré par l’imam ne pouvait être que juste et harmonieux. Au contraire, le pouvoir des califes sunnites, considérés par les premiers chiites comme des usurpateurs, était illégitime et tyrannique. L’instauration du millénium passe donc par le soulèvement contre les dirigeants sunnites. Il s’agit d’une lutte entre le Bien et le Mal.
Un évènement majeur de ce conflit est le martyr de Hussein à Kerbala en 680, il est l’acte fondateur du messianisme révolutionnaire chiite. Hussein, fils de Ali et troisième imam, a refusé de prêter allégeance au nouveau calife, Yazid. Il cherche donc à se rendre à Koufa où se rassemblent ses partisans. Sur la route, lui, sa famille et sa troupe sont interceptés par l’armée de Yazid qui les massacre. Selon une certaine perspective, le martyr de Hussein symbolise les velléités révolutionnaires du chiisme : Hussein aurait pu se soumettre et accepter l’injustice de Yazid, il a préféré affronter le Mal et mourir les armes à la main. À de nombreuses reprises, les chiites se sont soulevés, ont mené des insurrections pour reprendre le pouvoir s’inspirant de la conduite de Hussein. Les soulèvements s’articulaient généralement autour de la figure du Mahdi, dont l’avènement mettrait un terme à l’injustice, et celle du da’i (le prédicateur) mobilisant les opprimés. Certains courants extrémistes, les ghulats, accordaient un caractère sacré à l’imam, proclamaient des croyances très hétérodoxes inspirées d’autres traditions (manichéisme, gnosticisme, zoroastrisme) et revendiquaient parfois une doctrine antinomique.

Les soulèvements chiites causaient l’embarras des imams « légitimes » qui avaient opté pour une attitude quiétiste :
À l’exception de Husayn, ces imams s’étaient dans l’ensemble abstenus de toute activité politique. Tandis que d’autres prétendants s’épuisaient en vain à tenter de renverser le califat par la force, les imams légitimes préféraient représenter une sorte d’opposition légale aux califes au pouvoir (…) La tradition chiite a donné à cette attitude des imams légitimes un sens religieux ; leur passivité était l’expression de leur piété et de leur détachement de ce monde.
(Lewis, 2019, p. 69)Davantage, l’expérience de la défaite dans ce monde, dominé par le Mal, était signe d’élection. Dans cette optique, le martyr de Hussein relève moins d’une volonté de lutter contre l’injustice que de l’acceptation de la fatalité. Hussein n’a pas cherché à se soustraire à son destin quand bien même il savait qu’il devait mourir. Pour justifier leur quiétisme, allant parfois jusqu’à la collaboration avec les pouvoirs sunnites, et s’imposer aux extrémistes, les imams ont mobilisé le concept de taqiya :
La taqiyya justifiait donc la dissimulation de croyances susceptibles d’éveiller l’hostilité des autorités ou du peuple ; on la présentait comme une réponse au militantisme suicidaire qui avait conduit tant de personnes à la mort dans des soulèvements absolument désespérés
(Lewis, 2019, p. 70)Le sixième imam Jasfar As-Sadiq joua un rôle important dans ce projet d’encadrement et de pacification du mouvement alide en proposant une conception renforcée de l’imam :
Cette doctrine permit à l’imam Al-Sadiq de consolider le shi’isme, après ses nombreuses défaites précédentes, sur une assise pacifique puisqu’elle n’exigeait plus de l’imam de se soulever contre le régime en place pour faire valoir ses prétentions
(Daftari, 2003)Les imams légitimes imposent progressivement leur pouvoir sur la communauté chiite aux dépends des courants radicaux et révolutionnaires. A la mort du sixième imam un schisme éclate autour de la succession entre ismaéliens et duodécimains. Les seconds ont renforcé le tournant quiétiste avec la doctrine de l’occultation majeure. Selon la tradition duodécimaine, le douzième imam s’est caché au début du Xème siècle (occultation mineure), avant de se retirer du monde sensible (occultation majeure). Depuis, les chiites duodécimains attendent son retour, qui signalera la fin des temps. En attendant, l’activité politique est vouée à la déception :
tout gouvernement jusque- là, fût-il dirigé par des musulmans chiites convaincus, ne pouvait être qu’imparfait
(Rodinson, 2019, p. 27)La politique est délaissée au profit d’un quiétisme que C. Jambet nomme une “politique de la spiritualité” (en opposition à la spiritualité politique de Foucault) visant :
à guider, instruire, libérer, émanciper mais attention pas dans l’ordre d’un messianisme temporel mais dans l’ordre retrouvé de ce que le platonisme avait présenté comme le fait de s’évader d’un monde en lui-même ténébreux. Autrement dit, une évasion spirituelle ou intérieure. Et je prendrais comme image de cette politique spirituelle, les représentations de la cité des âmes pures, c’est-à-dire des disciples de la philosophie, de la métaphysique, qui découvre la seule liberté humaine qui leur reste (…) qui est faite à la fois de purification et d’illumination de l’esprit. Donc une sorte de retour à un programme platonicien.
(Jambet, 2018)Pratiquement, cela s’est traduit par la formation d’un clergé chiite dont les dignitaires se sont longtemps concentrés sur des questions théologiques, juridiques et éducatives. Le processus de politisation du clergé chiite se déroula sur plusieurs siècles au cours desquels les oulémas chiites s’opposèrent quant à l’attitude à avoir vis-à-vis du pouvoir politique (Luizard, 2014). Khomeiny est l’apothéose de ce processus mais sa doctrine de l’islam révolutionnaire et du gouvernement islamique doit bien davantage aux idéologies du XXe siècle qu’à la tradition chiite duodécimaine qu’il a “retourné comme un gant” (Jambet, 2018).
La première prédication ismaélienne : de la ferveur messianique à la déception eschatologique
Bien que minoritaires, les ismaéliens ne renoncèrent pas à l’option révolutionnaire et à la ferveur messianique.
Ils attendaient le jour de la Résurrection comme un évènement à la fois tout proche et donateur de sens à la religion musulmane tout entière.
(Jambet, 1990)A la fin du VIIIème siècle, les ismaéliens doivent faire face à la répression du nouveau califat Abbasside sunnite et à celle des chiites modérés. Pour s’en prémunir, ils entrèrent dans la clandestinité, en créant une organisation verticale et en adoptant une culture du secret. Pour les Ismaéliens, l’occultation ne signifiait pas que l’imam s’était retiré du monde sensible mais plus simplement que la lignée des imams se perpétuait dans le secret. Les imams étaient cachés, vivaient sous de fausses identités et communiquaient avec les fidèles via des intermédiaires. La Mission ismaélienne se composait donc d’un réseau de prédicateurs hiérarchisé qui s’étendait du Maghreb à l’Asie Mineure en passant par la péninsule arabique. Le réseau était divisé en “îles”, chacune dirigée par un responsable auquel répondaient des initiés divisés en plusieurs grades. L’ismaélisme était un courant élitiste, il ne cherchait pas à convertir les masses mais distinguait les croyants des initiés. Les prédicateurs sélectionnaient soigneusement les initiés, par exemple en introduisant progressivement des éléments de la doctrine ismaélienne dans des leçons et en jaugeant les réactions. Avant d’intégrer la Prédication, le “répondant” (celui qui répond à l’appel de la Mission) devait prêter serment. Même lorsque les Ismaéliens contrôlaient un territoire, ils ne prêchaient pas publiquement.
En milieu hostile, les Ismaéliens pratiquaient comme les autres minorités la taqiya. Mais, et c’est là la première grande différence, ils pratiquaient également la taqiya à l’intérieur de la communauté. Les Ismaéliens initiés ne devaient pas divulguer la doctrine aux Ismaéliens non-initiés par peur qu’ils ne la diffusent ou plus simplement qu’ils ne la souillent. L’ismaélisme est une gnose, le salut de l’âme passe par la connaissance, cette dernière doit être préservée du profane, de la masse idiote qui n’a pas vocation à la sagesse. Les Ismaéliens s’inspirent des évangiles (Matthieu 7 :6 : « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles devant les porcs : ils pourraient bien les piétiner, puis se retourner contre vous pour vous déchirer »). Ainsi Hamīd al-Dīnal-Kirmānī écrit au XIe siècle : « Ne répandez pas les perles parmi les chiens et ne les jetez pas aux porcs, pour qu’ils les piétinent avec leurs pattes. »
Au-delà de la menace de la souillure, il y avait la crainte que la diffusion de la doctrine ne provoque le scandale. De nombreux éléments de la doctrine ismaélienne, et chiite plus généralement, sont des hérésies aux yeux de l’orthodoxie sunnite : la prééminence de Ali, la falsification du Coran par Othman ou encore la génération du monde sensible par un démiurge subalterne. Ainsi, les ouvrages sont généralement précédés de mises en garde, rappelant au lecteur l’interdiction de divulguer leur contenu. La volonté de dissimulation influence jusqu’au style des ouvrages. Ils ne répondent pas à des impératifs didactiques ou dialectiques, il s’agit souvent d’une exégèse compréhensible uniquement pour un lectorat qui en maîtrise les références et les codes. Le chiisme est la “religion du secret” (De Smet, 2022), « la forteresse de l’ésotérisme » (Corbin), le dévoilement de la doctrine nécessite donc un effort de la part de celui qui souhaite y accéder : “le sens apparent (zâhir) du texte révélé masque une signification profonde (bâtin), qui est cachée sous l’écorce de la lettre, de sorte qu’il faut l’extraire par une exégèse ésotérique (appelée ta’wîl)” (De Smet, 2022). Le sixième imam aurait déclaré : ”« Notre cause est un secret, voilé dans un secret ; le secret de quelque chose qui reste voilé ; un secret que seul un autre secret peut enseigner ; c’est un secret sur un secret qui reste voilé par un secret ». Le ta’wîl est une “opération infinie (…) après chaque temps de ta’wîl, on trouve un espace recomposé, une loi nouvelle qui contient son propre sens caché” (Echghi, 1990, p. 30).
Au début du Xe siècle, une branche de la Prédication ismaélienne concentre ses efforts au Maghreb et conquiert une partie importante de la région. Progressivement, les Ismaéliens étendent leur territoire jusqu’à la Syrie et à la péninsule arabique. À la fin du Xe siècle ils fondent le Caire, d’où le califat Fatimide est administré par une dynastie de califes-imams. L’institutionnalisation du pouvoir se fait aux dépends de la ferveur messianique du début :
Après [l]a mort [du premier calife-imam], son fils et successeur portait encore un titre messianique — celui de « Résurrecteur », al-Qâ’im — mais lui succéda une lignée de califes-imams, qui n’avaient plus de prétentions messianiques immédiates (…) Cette ascension politique et militaire allait de pair avec un profond remaniement de la doctrine ismaélienne. On en gomma les éléments les plus radicaux : le caractère divin des imams, le messianisme militant, l’antinomisme, allant même jusqu’à élaborer un « droit fatimide » proche des écoles juridiques sunnites et chiites duodécimaines.
(De Smet, 2021)Ce succès politique confronte l’ismaélisme, doctrine eschatologique, à la problématique de sa réalisation dans l’Histoire :
Est-il possible à une sodalité ésotérique de s’emparer à un moment donné de la scène publique officielle de l’histoire [relevant de l’apparent], c’est-à-dire d’une scène qui s’étendait alors depuis les rives de l’Atlantique jusqu’à l’extrême orient du monde islamique ? Le peut-elle sans cesser d’être elle- même ? Lorsqu’une doctrine comporte une eschatologie comme partie intégrante, et qu’un événement de l’histoire visible, physique, vient à être proclamé comme annonçant cette eschatologie, alors il faut ou bien que l’histoire soit consommée ou bien que la doctrine s’efface… Le triomphe politique est l’échec de la doctrine. Et si celle-ci lui survit, ce sera grâce à un échec réparant ce triomphe et qui aura rendu sa liberté à la vision spirituelle. L’histoire ne s’arrête pas.
(H. Corbin)Les fatimides arrivent à rallier la majorité des autres branches de l’ismaélisme à leur projet. Néanmoins, certaines branches continuent d’être fidèles à la ferveur messianique des origines. Au début du Xème siècle, les Qarmates prennent le contrôle du Bahreïn. Ils instaurent « un Etat messianique, en abrogeant la loi musulmane et tous les rites extérieurs de l’islam » (De Smet, 2021), ils prétendent fonder une communauté de croyants égaux qui repose tout de même sur l’esclavage. En 930, ils saccagent La Mecque, pillent la ville, tuent les pèlerins et prennent la Kaaba. Les Fatimides et les Abbassides condamnent à l’unisson cette attaque du lieu saint de l’islam. La modération de l’ismaélisme entraine aussi des contestations internes. Le schisme le plus important est celui effectué par les partisans du calife al-Hakim au début du XIème siècle. Contre ses héritiers, ils proclament son caractère divin, « l’abrogation de la loi musulmane, la fin du cycle de Muhammad et l’ouverture d’une ère messianique » (De Smet, 2021). Bien qu’ils ne réussissent pas à s’emparer du pouvoir au Caire, ils se réfugièrent dans les régions montagneuses de l’actuel Liban et Syrie et élaborèrent la religion Druze.
La secte des Assassins : l’instauration et la défense de la Nouvelle Prédication
Le califat Fatimide entre dans une période de déclin au XIème, les rivalités internes et les schismes ont affaibli le pouvoir, la situation économique se détériore et à l’extérieur les Croisés et les Seldjoukides menacent le califat. La mort du calife Mustansir Billâh en 1090 entraine une scission importante autour de la succession. Une partie de la Mission prend le parti du fils aîné de l’imam, Nizar, et fait sécession. À leur tête Hassan As-Sabah, un prédicateur ismaélien originaire de Perse qui oppose à la Prédication fatimide, accusée d’avoir corrompu l’ismaélisme, une Nouvelle Prédication revendiquant un retour aux sources.
À la suite de l’échec de la rébellion de Nizar, ses partisans fuient l’Égypte. As-Sabah retourne en Perse et s’attache à la mise en place de la Nouvelle Prédication. Il se dote d’une place forte, Alamût, qui doit servir à la fois de refuge et de base arrière. Le choix d’Alamût s’explique par son emplacement, elle se situe dans une zone connue d’As-Sabah dont les habitants manifestent des velléités d’indépendance vis-à-vis du pouvoir Seldjoukide et de la sympathie pour le chiisme. De plus, la forteresse est réputée inexpugnable, elle se situe au fin fond d’une vallée, sur un pic, à 2 100 mètres d’altitude. As-Sabah y vit en ascète et dirige la Nouvelle Prédication. Comme l’Ancienne, elle prend la forme d’un réseau clandestin de prédicateurs situé principalement au Moyen-Orient et qui s’est peu à peu étendu vers l’Est, jusque sur le sous-continent indien. Ce réseau est composé d’un ensemble de citadelles, sur le modèle d’Alamût, et de maisons de la Prédication, parfois officielles, dans les zones urbaines. Là encore, la stratégie de recrutement est élitiste, les prédicateurs sont soigneusement sélectionnés, ils doivent prêter serment, suivre une initiation philosophique et accomplir les missions de la Prédication afin d’évoluer dans sa hiérarchie, et bien sûr appliquer la taqqyia. Détail important, “la sharî’a [est un] fondement légal de la vie quotidienne” du prédicateur (Bomati, 2024, p. 75). As-Sabah vit et dirige l’organisation en ascète - il fera d’ailleurs exécuter un de ses fils pour avoir consommé du vin.

La Nouvelle Prédication se heurte à un contingent varié d’ennemis : l’Ancienne Prédication, les Seldjoukides, les Croisées à partir du XIe siècle et les Mongols à partir du XIIIe siècle. Conscients de leur caractère minoritaire, il semble que les nizarites n’aient pas tenté de grandes campagnes de conquête, préférant rester cantonnés dans les citadelles pour répandre la Nouvelle Prédication via l’organisation clandestine et la saisie de nouvelles forteresses. Afin de répondre aux diverses menaces, ils ont recouru à de nombreuses reprises à l’assassinat politique, au point d’être qualifié d‘“ordre des assassins”. L’assassinat politique n’a pas été inventé au XIe siècle, certes. Mais c’est en vertu de son systématisme et de sa maîtrise par les nizarites que le terme d’assassin s’est imposé. Les dirigeants nizarites sélectionnaient avec soin leurs cibles, en identifiant clairement le maillon faible de la chaîne ennemi. L’assassinat d’un dirigeant croisé ou seldjoukide entraînait irrémédiablement des conflits de succession qui faisait passer les nizarites au second plan. Les ordres Templier et Hospitalier, du fait de leur fonctionnement pré-bureaucratique, étaient moins sensibles à ce mode d’action. La psychose provoquée par les assassinats était d’autant plus grande que les assassins se sacrifiaient pour la Prédication. Il s’agissait souvent d’opérations suicides, menées en connaissance de cause. La légende dit que la mort était désirée - honteux celui qui revenait vivant de sa mission. Les nizarites ont exalté l’assassinat politique “en [le] situant dans le cadre grandiose d’un combat d’essence théologique (…) Si le monde sunnite s’est inquiété de ces audaces, c’est qu’elles traduisaient en un point d’extrême résonance la théologie duelle de l’ismaélisme, qui conçoit, depuis Adam jusqu’au Résurrecteur, un conflit transhistorique entre les Prophètes et leurs Imâms d’une part, leurs Adversaires d’autre part” (Jambet, 2007). Au-delà des justifications philosophiques, “cette méthode reposait sur (…) la hiérarchie et l’obéissance à un seul maître” (Bomati, 2024, p. 86).
La Nouvelle Prédication a survécu à la mort d’As-Sabah, en 1124, et plusieurs dirigeants se sont succédé à Alamût jusqu’en 1256, date de sa prise et de son saccage par les armées mongoles.

Différents auteurs soulignent que la longévité de la Nouvelle Prédication s’expliquerait par sa rationalisation, elle anticiperait la modernité politique. Les nizarites auraient constitué un “parti”, “un mouvement idéologique constitué”, précurseur des partis politiques contemporains (Rodinson, 2019) : ils “réussirent à remodeler les désirs vagues, les croyances déréglées et la rage sans but des mécontents et à les canaliser vers une idéologie et une organisation” (Lewis, 2019, p. 207). Le réseau de la Nouvelle Prédication serait même comparable à un État, Daftari parle de “l’État nizarite” (2003).
La chute d’Alamût et la mort de l’imam font entrer les nizarites dans une période obscure. L’imam entre en occultation, la lignée se perpétue dans le secret et les fidèles retournent à la taqqyia. Les nizarites adoptèrent alors le masque du sunnisme, notamment de ses courants soufis, ou du chiisme duodécimain. Au XIXe siècle, la période de l’occultation prend fin avec la reconnaissance par l’Empire des Indes britanniques de la communauté ismaélienne et de l’Aga Khan à sa tête. Cette longue période d’occultation a eu des effets variés sur la communauté nizarite : de l’assimilation et de la dilution dans les communautés où ils se dissimulaient à la préservation (dans de rares cas) de l’identité et de la doctrine ismaélienne en passant par la formation de syncrétismes comme le Satpanth en Inde.
La Grande Résurrection : « Un pur éclair de liberté »
Ce qui nous intéresse dans le nizarisme ce n’est pas son organisation interne ni sa finesse stratégique. Mais plutôt sa réponse à la question posée par H. Corbin :
Est-il possible à une sodalité ésotérique de s’emparer à un moment donné de la scène publique officielle de l’histoire [relevant de l’apparent], c’est-à-dire d’une scène qui s’étendait alors depuis les rives de l’Atlantique jusqu’à l’extrême orient du monde islamique ? Le peut-elle sans cesser d’être elle- même ?.
Pour C. Jambet, penser la Nouvelle Prédication sur le modèle de l’État revient à oublier l’intention première d’As-Sabah : un retour aux sources en réponse aux errements du califat fatimide.
Il semble bien qu’il existe une profonde convenance entre la doctrine de l’ismaélisme reformé, le projet d’H. As-Sabah et cette mouvante géographie de sa puissance. C’est à tort, à mon sens, que l’on parle d’un État ismaélien en Iran et en Syrie. Les missionnaires et les petits seigneurs locaux, les paysans et les artisans, ne forment pas une masse cohérente et hiérarchisée, soumise à un appareil gouvernemental. Il s’agit plutôt de l’inscription sur les sols, dans les villes et les campagnes, d’une communauté aléatoire, guidée par sa propre attente messianique, structurée par des liens clandestins et initiatiques, soutenue par de purs impératifs de propagande, de combat et de résistance. Elle n’obéit pas à une administration mais à une mission. Hasan As-Sabbah se proclama la “preuve” ultime, le hojjat de celui qui allait venir, le Résurrecteur. Il orienta délibérément l’existence matérielle des siens vers ce pôle spirituel, leur faisant tourner le dos aux divers modes d’obéissance qui conviennent d’ordinaire aux remparts entre les sujets et l’Etat. En effet ces liens d’obéissance venaient de se défaire avec la faillite du pouvoir ancien au Caire. L’annonce du Résurrecteur est bien tout un ensemble, un événement religieux et un bilan politique de l’échec des Fatimides dont l’empire, cette nappe envahissante, qui devait occuper l’univers entier, se réduisait pour finir au proconsulat de quelques généraux convertis. Hassan Sabbah ne veut pas répéter cette expérience. Ce n’est pas en conquérant des territoires, pour les soumettre à l’État, mais en diffusant l’appel, soutenant cet appel de bases d’appui multiples et interchangeables, par des réseaux souples et insaisissables, que l’on préparera le retour du Résurrecteur, dont la venue n’est pas le terme d’un procès historique, mais un événement transhistorique. Seul un tel évènement est apte, selon la nouvelle doctrine, à opérer le renversement radical du désordre du monde.
(Jambet, 1990)
La Nouvelle Prédication s’inscrit dans un schéma dialectique censé répondre à la problématique soulevée par H. Corbin. Le premier moment du chiisme est la révélation et la défense de l’ésotérique contre le sens apparent, l’histoire spirituelle contre l’histoire matérielle. Pour simplifier, les sunnites affirment que la Révélation est achevée avec Mohammed tandis que les chiites considèrent que sa dimension ésotérique doit encore être dévoilée par les imams. Le second est celui du califat Fatimide, la métamorphose de l’ésotérique en exotérique, le sens caché devient le sens apparent en se transformant en une législation dans le cadre d’un “Etat à vocation impériale” (Jambet, 1990). C’est le dévoiement de l’ésotérique. L’institutionnalisation du sens caché en droit par les juristes fatimides alors que l’exégèse (le ta’wil) est une “opération infinie” (Echghi, 1990, p. 30). Le troisième moment est celui d’Alamût plus particulièrement de la grande Résurrection, de l’abolition de la loi, proclamée le 8 août 1164 par Hassan II, 4ème dirigeant de la Nouvelle Prédication :
En Alamut, les Ismaéliens regroupés autour d’As-Sabah réforment la doctrine et purifient l’intention militante de la convocation faite au nom de l’imâm (…) En abolissant la loi, [la Grande Résurrection] dénoue en effet le lien entre l’histoire spirituelle du salut et les œuvres matérielles instruites par les pouvoirs religieux de la communauté musulmane. Le sens intérieur redevient ce qu’il est, une leçon purement ésotérique et vécue dans l’intériorité de l’âme ; il abolit le sens apparent et peut s’y substituer (…) Le sens caché, devenu sens apparent sous les Fatimides se convertit en sens intérieur qui, à nouveau, devient apparition, manifestation, monde et réalité vécue. Mais cette fois-ci, non pas un ensemble d’institutions légales incarnant un sens caché, mais comme apparition illégale du sens caché. La communauté d’Alamut vit dans le monde extérieur comme si celui-ci était le monde intérieur de lumière.
L’originalité de l’expérience nizarite se situe moins dans la proclamation de la Grande Résurrection que dans la volonté de faire durer cet évènement. Autrement dit, que “l’histoire spirituelle” ne soit pas rattrapée par “l’histoire matérielle” comme ce fût le cas avec l’institutionnalisation du califat Fatimide. Ou que l’antinomisme et la volonté de réaliser le millénium ici et maintenant poussés à l’extrême n’affaiblissent pas la communauté, voir ne provoquent son autodestruction, comme dans le cas des Qarmates. Les nizarites tentèrent de soutenir la puissance de l’évènement qu’était la Grande Résurrection, d’une certaine manière de maintenir un processus destituant. Cette tentative passa notamment par la redéfinition du rapport au divin et une redéfinition du couple liberté/contrainte :
Les choses se passent comme si les signes de la loi (les versets du Livre Saint) ou les commandements de la tradition prophétique permettaient aux hommes pieux de se tourner vers Dieu en certains sens seulement, tandis que l’abolition de la loi exigerait de ces mêmes hommes qu’ils consacrent tous leurs actes, tous les sens, au culte et à l’adoration de Dieu. La loi réserverait à certains moments particuliers, aux actes et aux paroles choisis, aux rituels et aux pensées consacrées, isolés de la vie profane. Par là même, les hommes pouvaient espérer entrer en contact avec certains attributs divins, car, pour l’essence de Dieu, elle était à jamais protégée de tout contact spirituel, étant indicible. Mais dans la période de la Résurrection, il en va tout à l’inverse : ce ne sont plus tels ou tels aspects de la divinité révélée par sa loi que le fidèle peut et doit adorer, qu’il implore dans les moments désignés du jour ou de la nuit. C’est l’essence divine elle-même qui se révèle, une et entière, à son amour et à sa contemplation. Tout ce qui se particularise, tout ce qui fragmente et sépare la pratique de Dieu dans la vie humaine doit donc être aboli et, au premier chef, la pluralité des contraintes rituelles. A la contemplation de l’essence divine, à son savoir unifié et entier ne peut convenir qu’une existence qui soit unifiée et toute entière culte et adoration. La perception réelle se substitue donc au culte et à la loi comme l’absolu au relatif, l’universel au particulier, l’intégral au différencié ; l’existence, pour avoir accès à l’Un, doit briser le lien pluriel de la loi.
(Jambet, 1990)C. Jambet pose l’hypothèse intéressante que cette interprétation de la grande résurrection, la “divinisation permanente”, s’insérait dans un dispositif dont le pôle opposé était l’interprétation antinomique, licencieuse : “Peut-être n’y eut-il entre ces deux interprétations, que la différence d’un accent, peut-être furent-elles indispensables l’une à l’autre, comme à Sabbataï Tsevi ses “pratiques paradoxales” qui étonnaient et scandalisaient” (Jambet, 1990, p. 102). Des parallèles et similitudes ont d’ailleurs été établi par H. Corbin et G. Scholem entre l’ismaélisme et les courants messianiques juifs. Les légendes noires sur Alamut, rédigées et diffusées par leurs ennemis musulmans ou chrétiens (libertinage, consommation d’alcool, de porc, de stupéfiants, port de vêtements masculins par les femmes, stupéfiants, orgies etc.) auraient un fond de vérité.
La communauté nizarite, gouvernée selon la shari’a par l’austère As-Sabah, est donc bouleversée par la Grande Résurrection. Le “règne de l’esprit intérieur [s’est] donné pour mode d’ordre éthique d’une communauté” aux dépens de la loi, “l’absence de lien législatif s’est donnée elle-même pour lien social” :
Il existe donc bien, dans une communauté qui ne se soutient plus désormais des liens tissés par les lois positives, une obligation intérieure universelle. Il s’agit bien d’une obligation, dont l’objet est énoncé clairement, dont les manquements sont vérifiables, et c’est l’obligation de renoncer à la loi. Cette obligation, dont le contenu n’est pas tel ou tel objet empirique, n’est identifiable à aucun commandement particulier ; elle n’est pas non plus la forme pure de la loi, un universel “il faut”. Elle est la forme pure du “il ne faut pas”. Elle n’a pas pour schème la conformité universellement valable à la loi, mais l’inconditionnelle suspension d’une telle conformité (…) Selon une telle formule de l’obligation, il ne faut pas dire qu’il est interdit d’interdire, il ne faut pas davantage interdire tout frein au désir, et reconnaître dans ce tout l’universel de la loi, mais il faut suspendre plutôt ce qui pourrait donner une forme à l’impératif, et qui conduirait à ce point où l’impératif se transforme en loi. Il faut une universelle abstention de l’impératif qui aurait la figure de la loi, cette figure serait-elle celle, toute négative, du libertinage : abolir le “il faut obéir”, comme le “il faut transgresser”. Nous découvrons cette forme étrange d’un impératif qui n’est pas la forme universelle et pure de la loi, qui ne sera ni l’interdit, ni la négation de l’interdit, et qui, cependant, demeure un impératif, une obligation durement sanctionnée. L’impératif, débarrassé absolument de toute connexion à la loi, à la forme de la loi, peut être pensé, perçu et théorisé comme résurrection et comme libération. Libéré de la forme de la loi, l’impératif est pure spontanéité. L’obédience absolue à l’imam ne s’impose plus de l’extérieur, mais elle doit être l’expression permanente de l’acte d’exister du fidèle (…) L’obligation dont nous parlons ici est telle qu’aucune loi écrite, extérieure, n’en saurait nommer l’impératif. Nul contrat ne saurait la traduire. Nous voici, pour le coup, éloigné aussi bien de Kant que de la loi sadienne. Il n’y a pas d’écriture licite de l’obligation universelle de la résurrection, elle ne peut être que l’intime du cœur, la singularité des fidèles, leur face-à-face avec l’essence divine.
Si la Grande Résurrection abolit la loi, elle n’abolit pas pour autant les formes, les figures et les pratiques qui leur sont associées. La hiérarchie de la Nouvelle Prédication est simplifiée mais réaffirmée. Les fidèles se positionnent en fonction de leur proximité avec l’imam et de leur niveau de spiritualité. La quête de la connaissance, la gnose, et la figure de l’imam jouent encore un rôle central. L’obligation universelle de grande résurrection n’est donc pas un égoïsme ou un individualisme :
L’état paradisiaque consiste en la découverte de sa liberté créatrice. Mais il n’est de liberté que dans l’assomption de soi-même dans l’unité, par où l’on dévoile que nous ne sommes rien d’autre qu’un pouvoir infini d’innovation et de création. L’élu abandonne son être de créature, pour assumer son être créateur. Le moment décisif de la résurrection est l’émergence en chacun d’une liberté antérieure et supérieure à tout lien de nécessité (…) Il faut veiller en effet à ne pas confondre cette assomption de la liberté de l’impératif au cœur de la figure singulière de l’élu avec la solitude et la distinction trompeuse d’un moi. Il n’y aura unification divinisatrice qu’à condition d’une négation de tout ce qui sépare, oppose, distingue et multiplie. Le souci de soi prend la forme d’un souci exactement contraire : la liberté se conquiert au terme du souci de ne plus se soucier de soi : “lutter contre l’égoïsme”, “s’oublier soi-même”, disparaître et s’effacer pour laisser infuser l’impératif divin.
(Jambet)Il s’agit de s’ouvrir à la sagesse, non d’acquérir une connaissance inerte.
Se rendre sage, c’est laisser agir un impératif dont le sujet se situe au point de l’Autre, et non plus au point de maitrise de sa propre intelligence. C’est pourquoi l’amour y est requis, et, avant tout, l’amour électif et sans raison de Dieu lui-même (…) “s’approcher” de la présence divine, c’est éprouver dans l’intelligible l’insuffisance de l’intelligence. Cet exercice ne se pratique pas comme l’on va vers l’objet de sa demande, mais comme on se laisse approcher par la cause de son désir.
(Jambet, 1990)L’exercice est périlleux, le croyant se met en jeu dans son rapprochement avec l’imam, tel le mystique qui risque de se consumer en Dieu en refusant toute médiation. La gnose s’opère sur le mode de ‘aref (connaissant) pas celui du ‘alem (sachant) :
Le ‘alem s’occupe de la vérité une fois advenue, calmée et rangée dans les lieux du savoir (…) Il se heurte naturellement à tout ce qui pourrait défaire ce[s] lieu[x], tout ce qui pourrait mettre en danger [leur] stabilité. (…) La vérité, telle que le ‘aref peut la rencontrer, surgissant comme un événement et détruisant les lieux anciens, est inacceptable pour le ‘alem. Le ‘aref, lui, court la rencontre de ce qui se dévoilera peut-être à lui et le rapprochera de la profondeur du mystère. Il va au-devant de l’aventure, fût-ce au prix de se détruire lui-même en tant que partie du lieu ancien. Accepter sa propre transformation, partir de soi-même, tel est le courage du ‘aref.
(Echghi, 1992, p. 19-20)Ce n’est qu’à ce prix qu’il devient possible pour le croyant de se conduire en immortel :
Or, pour un shî’ite, l’imâm n’est nul autre que ce sujet où se conjoignent le désir sans limite de la puissance divine et la jouissance de son approche. Si le philosophe peut espérer se conduire en immortel, c’est en imitant cette performance surhumaine de l’amour dont l’imâm donne l’exemple inégalé (…) C’est mortel qu’il faut vivre en immortel, quand la nature invite à se plier à sa fragilité et à sa précarité. Au fond, la philosophie donne ici pour impératif de ne pas écouter le savoir, mais de lui opposer une vérité supérieure, qui n’a aucun fondement dans les choses telles qu’elles sont (…) Ne pas préparer sa mort, mais vivre en immortel, ne pas donner son assentiment à ce qui va trop bien avec les leçons de la nature (…) Le danger, pour le sage, est de ne pas se rendre digne de l’excès que le désir attend de lui.
(Jambet, 1990)Une conception de la liberté qui nous est devenue étrangère :
Que nous dit [la Grande Résurrection] de nous-même ? En un temps où l’on interprète la liberté dans les termes veules d’une philosophie des droits, où l’on refuse aux hommes tout héroïsme, nous devons mettre en lumière ces formes étranges de la liberté : celle que l’homme recherche lorsque, mortel, il refuse l’assentiment à sa propre mortalité et à l’abaissement d’une philosophie de la survie, quand il désire plus que tout “se conduire en immortel”.
(Jambet 1990)Conclusion
A travers l’histoire du chiisme, le conflit entre duodécimains et ismaéliens, c’est l’alternative entre le quiétisme et la révolution, le retrait et l’affrontement, qui a été posée. Ce dilemme est revenu à de nombreuses reprises au cours de l’histoire. Feu Camatte écrivait à propos de Bordiga dans une note de 2009 de Caractères du mouvement ouvrier français :
Le thème de la dernière révolution qui est à venir sera maintes fois repris particulièrement par A. Bordiga qui parlera de la N+1ème révolution pour définir la révolution communiste devant advenir. Il évoque inévitablement celui du dernier prophète, mais aussi celui de l’imam caché, occulté, qui doit parachever l’œuvre du dernier prophète, Mohamet. Le prolétariat qui doit réaliser la dernière révolution se présente lui aussi de façon occultée et les révolutionnaires attendent ardemment qu’il sorte de son occultation. D’une certaine façon les positions des chiites ont anticipé sur celles affirmées par la gauche italienne, surtout par A. Bordiga. Dans les deux cas, à des périodes différentes, il s’est agi de savoir comment se comporter dans une période de recul.
(Camatte, 2009)La question se repose aujourd’hui. Assurément, la tentation du repli est grande. Mais est-il seulement possible dans un monde où le capital s’est immiscé partout ? Toute tentative sécessioniste ne devra-t-elle pas être défendue à un moment ou un autre ? A trop vouloir se dissimuler ne risque-t-on pas d’adopter le masque censé nous cacher ?
L’expérience nizarite médiévale nous pousse à nuancer l’opposition entre les logiques de soustraction et d’affrontement du pouvoir, entre la destitution et la construction de force, l’ascèse austère et le désir. Le souci de soi proposé par le nizarisme rappelle ce que Foucault notait à propos de l’ascétisme, un « excès (…) un trop qui assure précisément son inaccessibilité pour un pouvoir extérieur ». Thème qui a été exploré par la suite par Agamben avec les franciscains. Mais le nizarisme ne propose pas un souci de soi austère, voire mortifère, qui se refuse à la prise d’armes. Au contraire, dans le nizarisme l’abolition de la Loi, la destitution de l’ordre social et la dissolution de l’individu est la conséquence du désir et de la part divine de l’homme. Ainsi, Nasîroddîn écrivait :
Puisqu’il existe en l’homme une substance simple et divine qui ne ressemble à aucune autre nature, il peut jouir d’une sorte de plaisir incomparable à tout autre. L’amour qui requiert ce plaisir est à l’extrême de l’excès et il ressemble à la détresse. On le nomme l’ardent et intégral désir de l’amour divin. Certains qui se divinisent revendiquent un tel amour.
Contrairement aux franciscains, l’ascèse et les formes des nizarites ne les ont pas conduits à (se laisser) mourir d’austérité pour défier le pouvoir. Contrairement à bien des millénarismes, comme les Qarmates, leur antinomisme ne les a pas fait tomber dans le nihilisme et l’anomie. Les nizarites ont pensé des formes qui permettaient de soutenir dans le temps l’abolition de la Loi et de la défendre face à ses ennemis. Sûrement, ce qui poussait les assassins à mourir en martyr n’était pas une passion morbide, l’appel du néant, la drogue ou un calcul rationnel en vue d’obtenir la meilleure place possible au paradis ; mais une certaine conception de la vérité :
Le problème politique le plus général n’est-il pas celui de la vérité ? Comment lier l’une à l’autre la façon de partager le vrai et le faux et la manière de se gouverner soi-même et les autres ? La volonté de fonder entièrement à neuf l’une et l’autre, l’une par l’autre (découvrir un tout autre partage par une autre manière de se gouverner, et se gouverner tout autrement à partir d’un autre partage), c’est cela la “spiritualité politique”.
(Foucault, 1978)C’est à cet endroit que Foucault a entrevu la possibilité d’une politique qui échappe à la souveraineté, qui laisse “de côté l’aspiration au gouvernement, aspiration révolutionnaire et donc étatique, pour entendre la voix des humbles, et l’aspiration inconditionnelle à la Justice. La “spiritualité politique” se situe manifestement dans cette interpénétration du temps et de la fin des temps, et non dans la gouvernance du savant en religion.” Elle est ce que L. Echghi nomme une “politique subjective, qui n’a pas de référent extérieur, comme le parti, l’État, les syndicats”. La subversion dans la subversion.
-

Néolibéralisme : zombies et mutants
Mort, il marche encore sur la terreSe poser la question d’un retour aujourd’hui du fascisme implique d’une part de se demander si l’on n’a pas affaire à quelque chose de tout autre (le technofédoalisme) mais aussi de considérer ce qu’il est advenu du régime “précédent”, qui s’est justement constitué officiellement à la fois contre le fascisme et contre le socialisme, non sans assumer un noyau autoritaire : le néolibéralisme. Dans un premier article on se demandera ce qui permet de parler de mort du néolibéralisme ou de sa perpétuation sous une forme “zombie”. Dans un second article (celui-ci) on verra comment, épuisé et soumis à des tensions internes et externes, il pourrait avoir fini par muter. Enfin, dans un troisième article conclusif on se demandera si ces mutations ne sont pas autant de portes ouvertes vers d’autres régimes et d’autres imaginaires politiques. Et comment ceux-ci peuvent s’articuler.
Néolibéralisme : zombies et mutants
On avait dans un premier article exposé les arguments qui permettent à certains de déclarer la mort et l’enterrement définitif du néolibéralisme, et à d’autres de le voir s’être insinué partout, jusque dans nos gênes. Pour caricaturer, on peut voir aussi bien dans les populismes, les Bidenomics et l’affrontement commercial entre la Chine et les USAs, la péremption du cadre néolibéral, que dans la crevardise des influvoleurs, sa permanence. Si la première posture s’articule notamment avec une énième tentative de réechanter la gauche (et l’État), la seconde revient à forclore toute possibilité de changement… et donc à condamner toute possibilité révolutionnaire. Faute politique évidente autant qu’erreur d’analyse. Regardons une autre hypothèse : que le néolibéralisme survit, se survit, et ce faisant mute, et que ce n’est pas sans risque (pour nous, pour lui).
Vive la crise ?
Croire à l’incessante résilience du néolibéralisme passe souvent par le fait de prendre pour acquis le discours qu’il a sur lui-même. Il provoquerait des crises pour avancer ses pions, et lorsqu’elles surviennent de l’extérieur il s’en saisirait comme des opportunités. Vive la crise ! Bien sûr il y a du vrai dans cette affirmation, Friedman disait ainsi :
Only a crisis - actual or perceived - produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. That, I believe, is our basic function: to develop alternatives to existing policies, to keep them alive and available until the politically impossible becomes the politically inevitable.
Et les plans d’ajustement structurel imposés par le FMI sur les pays du Sud global maintenus dans un état de sous-développement ne sont pas des fantasmes. Il n’y a par ailleurs aucun doute sur le fait que le néolibéralisme s’est présenté comme une solution à l’inflation et à la stagflation de la fin des années 70 en Occident. Mais, il faut savoir faire un pas de côté, prendre un peu de recul.
Profiter de la crise de systèmes concurrents, que ce soient le keynésianisme, le socialisme ou le tiers-mondisme est une chose. Répondre à une crise provoquée par le système en est un autre. La résilience du néolibéralisme ne doit pas uniquement être évaluée à partir du constat de son maintien ou des forçages qu’il impose en période de turbulence, il faut aussi se demander si sa légitimité est toujours intacte. Où en est sa part de rêve ? A ce propos, J. Peck et N. Theoddore affirment que : “The very emptiness of these futures represents an important difference between the current conjuncture of late neoliberal authoritarianism and its predecessors from the 1970s and 1980s, the time when empty promises of a better, freer, and more prosperous future had yet to be historically tested”. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une question secondaire pour les auteurs néolibéraux, ils ne misent pas tout sur la “gouvernance par le milieu” ou l’Etat fort. Röpke écrit que “le succès du communisme est favorisé par une âme vide plutôt que par un estomac vide”. Les néolibéraux sont des intellectuels de combat, ils ne restent pas dans une tour d’ivoire : think-thanks, ouvrages de vulgarisation, conférences, revues, construction de personnages publics et même une série documentaire (Free to Choose) etc. Il s’agit avant tout d’une gouvernance par la liberté.
Le néolibéralisme est mort. Mais survit comme un zombie
Le néolibéralisme est donc bien là, et son hégémonie écornée comme jamais. Les signes de ce qui est au moins une crise de légitimité s’amoncellent. Quiet quitting, big quit, écoanxiété, on attend avec impatience la guerranxiété. Dégagisme dans l’arène politique et multiplication de (non)mouvements en dehors (rien qu’en France : Zads, 2016, GJs, contre le pass sanitaire, manifs nocturnes contre Louis XVI, émeutes pour Nahel ). Le futur se présente comme angoissant et apocalyptique, ce qui n’échappe pas à l’industrie culturelle : “On est trop sur la planète/J’en déduis qu’ils vont tous nous tuer ” (Booba), la Fièvre, la Peste. Concédons aux puristes (révolutionnaires et micropoliticiens professionnels) qu’il ne s’agit guère d’oppositions franches au néolibéralisme. Cette accumulation atteste tout de même de son affaiblissement. Le manque d’adhésion aux régimes néolibéraux est compensé par le recours à la force. C’est pourtant une banalité : qui n’a que la coercition est affaibli. Même dans les régimes dit “autoritaires” le pouvoir recoure aux réseaux de clientélisme, à des idéologies, à des corps intermédiaires, à une instrumentalisation des traditions et valeurs etc.
Comme le dit aujourd’hui l’un des anciens économistes de Clinton (et qui considérait encore en 1999 le néolibéralisme comme la seule utopie encore vivante)
On peut dire que le néolibéralisme est en train de mourir, mais le nouveau monde lutte pour émerger. Comme disait Gramsci, “maintenant c’est l’heure des monstres”. Il me faut encore 6 mois pour déterminer si le néo-fascisme est une vague qui a réellement de l’avenir. Et si les algorithmes vont être sources de progrès et d’égalité ou l’inverse, dans la manière de gérer les affaires sociales. La chose intelligente à dire est que oui le néolibéralisme est mort ou en passe de l’être, mort mais comme un zombie : il marche encore sur la Terre.
Pourquoi continue-t-il à marcher ? Parce qu’il n’y a personne pour le décapiter à coup de machette. Le maintien du néolibéralisme s’explique davantage par la faiblesse de ses adversaires que par sa supposée résilience à toute épreuve. Mais que faut-il comprendre par ses adversaires ? Une force qui lui est radicalement opposée et étrangère ? La pureté révolutionnaire ? Rien n’est moins sûr. Ce qui nous guette c’est un scénario à la X-men, un monde peuplé de mutants.
Logique de la mutation
Dans la succes story du néolibéralisme il y a le rôle principal (le néolibéralisme comme rationalité politique fondée sur une certaine conception du marché) mais aussi les seconds couteaux. Le caractère compositionnel du néolibéralisme, qui participe à sa résilience, l’amène à se colorer différemment, et selon le contexte, au contact du conservatisme ou du progressisme. Cela répond à l’une de ses faiblesses originelles : l’extension du marché et de l’individualisme à l’ensemble de la société entraine une dynamique centrifuge, un risque de dissolution de la société, d’anomie. Et les néolibéraux le savent. Déjà en 1958 W. Röpke, le chef de file des ordolibéraux, écrivait dans Au-delà de l’offre et de la demande :
Les hommes qui s’affrontent sur le marché, et, poursuivant leur profit, comptent l’emporter, doivent être d’autant plus liés moralement et socialement à la communauté, sinon la concurrence dégénère elle aussi des plus dangereusement. En d’autres termes, l’économie de marché n’est pas tout : elle doit s’insérer dans un contexte général plus élevé qui ne peut se fonder sur l’offre et la demande, la liberté des prix et la concurrence. Elle doit être tenue fortement dans le cadre d’un ordre général (…) L’homme, par contre, ne peut trouver le plein épanouissement de sa nature que s’il s’intègre de son propre gré dans une communauté et s’y sent lié solidairement. Sinon il mène une existence misérable. Et il le sait.
C’est l’un des moteurs de la reconfiguration incessante du néolibéralisme : il a besoin de s’appuyer sur d’autres rationnalités politiques. S’appuyer, mais ne pas les absorber, au risque de les réduire à de vulgaires marchandises. Angle mort de la laïcité, le “retour du religieux” n’est plus une béquille pour le néolibéralisme quand il s’affaise dans la marchandisation. Qu’est-ce qui fascine le bloom dans les images du hajj ? La piété ou les hôtels 5 étoiles qui entourent la Ka’ba ? Les précheurs 2.0 n’assèchent-ils pas la parole divine au point de la réduire au développement personnel ? Sans mauvais jeux de mots, cela ne peut qu’approfondir le désert.

Une question importante est donc celle de l’autonomie laissée à ces autres rationnalités politiques. Wendy Brown remarquait déjà que dans la séquence qui a suivi le 11 septembre 2001 néolibéralisme et néoconservatisme n’étaient ainsi pas les deux faces d’une même pièce. Qu’il n’y a pas nécessairement de symbiose entre le néolibéralisme et ses adjuvants. Dans le cas du néolibéralisme et du néoconservatisme, bien que leurs intérets convergaient, il existait des points de tension évidents concernant notamment le puritanisme, l’individualisme, la participation politique ou encore le rôle du gouvernement.
Le néolibéralisme mutant
Trump et Brexit
Le cas de Trump a été longuement commenté. Rupture populiste avec le néolibéralisme pour les uns, symbole de sa reconfiguration pour les autres. La mise en lumière des pôles conservateurs et nationalistes du néolibéralisme va dans le sens de la seconde hypothèse. Si Trump a provoqué le retrait de l’accord de partenariat transpacifique, celui-ci a été suivi par la signature d’accords plus restreints, avec le Canada et le Mexique. Trump soutenait aussi un “hard Brexit” afin de renforcer les liens économiques avec le Royaume-Uni. Il ne s’agissait pas d’en finir avec le libre-échange mais de le reconfigurer. Sur le plan de la politique intérieure, il a poursuivi les politiques néolibérales : privatisations, dérégulation, baisses d’impôts sur les entreprises etc. Quant à la guerre commerciale contre la Chine et la réthorique protectionniste, il ne s’agissait de rien d’autres que de la poudre aux yeux. Il faut que tout change pour que rien ne change.
Considérer le trumpisme comme un populisme ou une variante supplémentaire du néolibéralisme c’est manquer qu’il s’agit d’une synthèse entre différentes tendances - nationaliste, conservatrice, libertarienne, suprémaciste, évangéliste, masculiniste ou encore communautariste - qui entretiennent des rapports ambivalents avec le néolibéralisme. Quinn Slobodian affirme notamment que :
[Les libertariens] viennent à la fois du mouvement néolibéral et sont contre celui-ci. L’une des qualités impressionnantes de la tradition intellectuelle néolibérale est la façon dont elle a plus ou moins maintenu sa cohérence malgré des différences d’opinion internes souvent importantes sur la gestion de l’argent, la migration, l’utilité du populisme et d’autres questions de division. La rébellion ouverte de certaines factions au sein de la grande tente est un retour à la tendance sectaire plus familière des mouvements intellectuels, et elle montre pourquoi il ne suffit pas de considérer le néolibéralisme comme l’idéologie domestique du capitalisme en tant que telle.
Ainsi, si le trumpisme participe au maintien du néolibéralisme, il menace aussi de le faire bifurquer ou éclater. Le trumpisme symbolise l’hybridation du néolibéralisme avec des rationnalités politiques qui lui sont extérieures si ce n’est antinomiques. Wendy Brown voit dans le trumpisme l’influence du “néofascisme” : mobilisation des masses, recours aux affects, virilismes, leader-charismatique, haine des élites, racisme, ressentiment etc. Bref, le cauchemar des néolibéraux :
Ce qui triomphe sous le régime de Trump, c’est bien le raisonnement néolibéral et son préjugé en faveur des affaires et d’un économicisme généralisé. Cela dit, il faut se rappeler que pour les authentiques néolibéraux, ceux de Fribourg, de Vienne ou de Chicago, cet aboutissement serait un cauchemar. En effet, à quoi s’opposaient les néolibéraux ? Ils s’opposaient au fascisme, mais aussi à la mobilisation de masse des affects populaires, à la démocratie émotionnelle. Ils souhaitaient une séparation entre le monde de la compétition et des marchés, et l’État, qui pouvait certes être un État fort, mais qui devait être dirigé par des technocrates, ou à tout le moins comprendre son rôle comme étant de favoriser l’essor des marchés. Leur cauchemar était au contraire cette fusion des grandes entreprises et de la politique incarnée par Trump. Leur cauchemar était l’autoritarisme et l’irrationalité incarnés par Trump. Leur cauchemar était un régime politique réceptif à la mobilisation des affects populistes. Trump est leur Frankenstein.
Frankenstein car Trump est une création, monstrueuse, du néolibéralisme lui-même. Ce dernier est à la fois responsable de la destruction de la démocratie et du resentiment sur lesquels Trump a capitalisé, et dans le même temps s’appuie sur le trumpisme pour perdurer.
Cette logique de mutation est perceptible au-delà du trumpisme. Le Brexit symbolise l’hybridation entre néolibéralisme, libertarianisme et nationalisme. Discours protectionnistes, xénophobes et racistes, “Take back the control”; promotion du modèle de la cité-Etat, des zones franches et ports-francs : fascination pour Dubaï ; volonté de créer un “Singapore-on-Thames” ; projets d’accords de libre-échange bilatéraux ; promesses de dérégularisation ; “Hayek would have been a Brexiteer”. Le Brexit s’accompagne aussi, comme le note encore Slobodian, d’un projet de “sécession douce” : “le choix de la société par le biais de communautés fermées, le déplacement de[s] enfants dans les écoles privées, la création d’environnements médiatiques parallèles et en silo”.
Les partis d’extrême-droite anti-austérité
Les partis d’extrême-droite européens peuvent être vus comme un autre symptôme du même phénomène. Selon Melinda Cooper ces partis hybrident le néolibéralisme avec une réthorique et des politiques nationalistes et racistes, mais aussi avec des politiques économiques anti-austérités. Ces dernières s’intègrent dans le cadre d’un projet économique fasciste, “a heterodox economic formation, distinct from the equally heterodox methods of Keynesianism or socialism, [which is] defined by the attempt to overcome the threat of deflation without substantially threatening the existing distribution of wealth and income.” S’appuyant sur l’intervention de l’Etat, la limitation du marché, le natalisme, la création de monnaies parallèles et opposées à l’austérité, ces politiques économiques sont théoriquement antinomiques avec le néolibéralisme. Dans la pratique, les mouvements anti-austérité d’extrême-droite mélangent néolibéralisme et économie fasciste. D’un côté, en Italie, la coalition entre la Ligua et le M5S remplace la taxe régressive du gouvernement Monti par une flat tax, de l’autre elle instaure un “revenu de citoyenneté” (équivalent du RSA). En France, la trajectoire du Front National puis du Rassemblement National est également emblématique du phénomène. La politique économique du parti est le produit d’une tension entre un pôle néolibéral, incarné par le Club de l’Horloge, et un pôle antilibéral, le GRECE. Henry de Lesquen membre du premier, fait l’éloge du “libéralisme” de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Jacques Rueff, Wilhelm Röpke, Lionel Robbins, Henry Simons, Milton Friedman et George Gilder, tandis qu’Alain de Benoist, figure de proue du second, lui a répondu par un petit texte, Contre Hayek. C’est le rapprochement du RN vers les idées du GRECE et le souverainisme qui explique, selon Cooper, le tournant social du parti. Bref, le néolibéralisme étant nécessairement compositonnel et ce d’autant plus qu’il est affaibli, on pourrait multiplier les études de cas: Hongrie d’Orban, pays du Golfe, République autoritaire de Macron, Inde de Mondi, Argentine de Milei, etc.
L’hybridation entre le néolibéralisme et d’autres rationnalités politiques, on le voit, n’est pas sans conséquences pour lui. Le mélange entre néolibéralisme, conservatisme et nationalisme se fait aux dépens de sa version globaliste et progressiste. L’hybridation avec certaines tendances qui lui sont proches, notamment libertariennes, ouvre une possibilité de bifurcation. Le néolibéralisme, comme ce semble être le cas actuellement, peut réussir à maintenir sa domination sur les rationnalités politiques avec lesquelles il se compose (même avec les plus distantes et divergentes, comme le néoconservatisme et le néofascisme). C’est ce que d’aucuns nomment le “moment néofasciste du néolibéralisme”.
Il faut souligner que les mutants peuvent se stabiliser en tant que tels. C’est par exemple le cas du Hezbollah libanais qui domine le pays du Cèdre depuis plusieurs années. II s’agit d’un côté d’une milice disposant d’importantes capacités militaires, en guerre contre Israël et aux côtés du régime syrien, diffusant un discours islamo-nationaliste teinté d’anti-impérialistes, s’appuyant sur des références religieuses chiites et produisant des subjectivités militaristes. D’un autre, c’est une organisation qui s’est complètement intégrée au système néolibéral libanais (J. Daher) et qui a intégré les pratiques de “bonne gouvernance” préconisées par les institutions internationales néolibérales (A. Daher).
Mais il faut aussi envisager la possibilité que ces tendances profitent de la faiblesse du néolibéralisme pour s’imposer à lui, le cannibaliser et fonder une nouvelle espèce. Il faudrait alors renverser la formule et conclure à un moment néolibéral du néofascisme. Mais laissons l’étude de ces “sorties”, à un dernier article.
-

Introduction
Subversion dans la subversionNotre dernière livraison a montré que s’il serait ridicule de nier les changements en cours (qui vont de la mise en place de frontières même pour les marchandises, jusqu’à la guerre des drones), il l’est tout autant de blablater sur une nouvelle “guerre froide”. Car sous le glacis de cette dernière on retrouve -ho surprise !- le capitalisme as usual. Et, derrière les rodomontades, la convergence des pseudo-blocs vers une gouvernementalité chinoise. La crise environnementale, la COVID, la guerre totale, autant d’occasion pour l’Empire de se reconfigurer. La destruction du New World Order par ses instigateurs, à coups de politiques de puissance mercantiliste, se double d’un raidissement du pouvoir à l’intérieur des sociétés. L’économie de guerre, les discours bellicistes et la rengaine du service militaire n’en sont que des éléments parmi d’autres. Après plusieurs décennies de néolibéralisme, de gouvernance par le milieu et de négation du politique, les pouvoirs retournent brutalement à la verticalité et aux structures écrasantes : civilisation, Dieu, nation, Etat, religion, communauté, nature, famille, essences. L’Empire revendique à présent un affrontement sur ces différents plans. L’Etat Islamique avec son millénarisme, son refus de l’ordre international, sa violence extrême et sa maîtrise de la communication postmoderne n’était pas une anomalie de l’Histoire, un mouvement rétrograde. Certes un mouvement d’un autre temps, mais d’un temps à venir.
Les mouvements révolutionnaires ont de quoi être déboussolés et désemparés. Le XXIe siècle aurait dû enterrer pour de bon le triptyque Idéologie, Parti et Militant au profit des signifiants vides et du populisme, des non-mouvements et de la multitude. Certains allant jusqu’à affirmer que les soulèvements de ce début de siècle étaient des « révolutions sans révolutionnaires », des réfolutions (contraction imprononçable de « réforme » et “révolution”). D’autres, convaincus que le siècle serait deleuzien, pensaient que tout se jouerait dans le moléculaire, voire le microscopique, à coup de déconstructions à l’infini. Le choc est d’autant plus violent :
Je ne sais pas si vous partagez avec moi, depuis quelques mois, un sentiment d’irréalité, la sensation, à la fois paralysante et fébrile d’être à l’intérieur d’un jeu vidéo qui est en train d’être reprogrammé en temps réel et dans lequel, bien que l’on continue à jouer avec le même avatar, les règles du jeu et le monde partagé sont en train d’être brutalement modifiés
(Preciado)Aïeaïeïaïeaïe… On est passés sans transition des Sims à Call of Duty, du smartphone et du cocooning numérique à la tronçonneuse et au B-52. Une époque où il vaut mieux spawn en GI bodybuildé, en grand combattant en cage ou en chevalier croisé. Et de fait, la Réaction étant l’avatar du raidissement du pouvoir, elle capitalise dessus en même temps qu’elle l’alimente. Elle fascine et révulse les révolutionnaires et les radicaux. Chacun de ses “triomphes” les renvoie à leurs échecs, à leur inconséquence post-moderne et à leurs tendances nihilistes. D’aucuns lui envient sa supposée capacité à faire « rêver », à rendre conséquent, à faire communauté, à parler à ceux d’en bas, à être ancré, à s’organiser sur le long temps, à être solide.
Désemparés, les révolutionnaires singent la Réaction et s’empressent d’expier leurs années fluides. C’est le retour des grosses moustaches bien épaisses, des drapeaux rouges poussiéreux et des brochures de Lénine et Mao. Le retour des subjectivités militantes exemplaires, sérieuses et responsables… Il n’est plus question de désir ou de zbeul mais d’avant-gardes, de groupuscules et de sujets révolutionnaires, de composition et d’alliances. Le tout sur un mode éminemment grotesque. Comme leurs alter egos réactionnaires, les subjectivités révolutionnaires sont des mutants du néolibéralisme. Ils reposent sur une tradition fantasmée et figée mais rassurante qui n’atteint pas les profondeurs de l’homoeconomicus. Derrière la moustache, il y a des individus, des smartphones, la valorisation de toutes les sphères de l’existence et un rapport entrepreneurial au monde et aux êtres. Le gauchiste du XXIe siècle est un monstre de plus dans le bestiaire néolibéral au côté des télévangélistes, salafistes 2.0, tradwives, trumpistes et autres sorcières tiktokeuses.
Le retour de la Gauche ne se limite pas à la caricature, certes un peu facile, du jeune-vieux-gauchiste. Le phénomène peut être plus diffus, plus subtil, un peu moins poussiéreux. En témoigne le NFP, une mobilisation réssuscitant un évènement anti-révolutionnaire, alimentée par la culpabilité, la responsabilité et l’exemplarité… et derrière la force du symbole, les petits calculs d’épicier entre politiciens, derrière la propagande participative, des graphistes qui font leur publicité, derrière la campagne horizontale, la constitution de capital militant et des partis verticaux, derrière la radicalité de façade, les ambitions carriéristes.
Se nourrir du passé n’est pas une erreur, mais encore faut-il chercher au bon endroit et de la bonne manière. Face à l’effondrement du monde et des subjectivités, il est certes tentant d’inventer et de figer une tradition à laquelle se référer, de trouver une nouvelle identité à endosser et un passé dans lequel se réfugier. Mais la tradition révolutionnaire n’est pas donnée, il s’agit d’un champ de bataille dont la définition même est conflictuelle. Pour nous, il s’agit de la “tradition des vaincus”. Pas par fétichisme de la défaite mais parce qu’elle regroupe ceux qui ont lutté à la vie à la mort avec ce monde, qui ont refusé que la paix se fasse sur leur dos. A travers son exploration, nous ne cherchons pas des mots et des symboles mais des principes, des attitudes et des gestes à actualiser dans le présent.
Jamais nous ne voulons être ailleurs que chez nous. Même ici notre regard n’est point rétrospectif. Nous nous mêlons nous-mêmes au passé de façon vivante. Et, de la sorte, les autres aussi revivent, métamorphosés ; les morts ressucitent ; avec nous leur geste va derechef s’accomplir.
(Ernst Bloch)En cette période de confusion, un bref regard sur cette histoire permet de rappeler l’importance de la subversion dans la subversion, de l’insurrection contre l’ordre établi mais aussi contre tous ceux qui prétendent s’y opposer.
-

Walking deads
Édito - avril 2024Ce serait l’heure des come-backs : le retour de l’Etat, et avec lui de la guerre et de l’autoritarisme. De ce constat débutent deux analyses dominantes, l’une qui voudrait que l’on assiste en direct à la résurrection du fascisme ; et l’autre à l’inverse que rien n’a changé, et que le pseudo-renouveau était déjà à l’oeuvre, à la périphérie (du regard ou de l’occident). Il faut savoir reconnaître et écarter ce qui relève de la tentation de remplir l’armoire à concepts (néo-fascisme, nouveau néolibéralisme) comme celle de ne voir partout que des agitations superficielles (pendant que l’économie continue de modeler le monde). On essaiera plutôt de repérer des ruptures dans l’organisation du pouvoir - et puis sont-elles synonymes de faiblesses, cachent-elles des plaies (à saler) ou des occasions de fuir (armé) ? Cette livraison est encore en cours d’élaboration.
-

Comeback
Édito - septembre 2024Les années 90 ont beau être à la mode, elles sentent plus que jamais le périmé : le nouvel ordre mondial, son prosélytisme néolibéral progressiste, ses frappes chirurgicales et ses casques bleus - utopie finie. Dans une précédente livraison on se penchait sur les dernières convulsions du néolibéralisme : un peu partout on se fait élire sur sa mort et pourtant le corps bouge encore, quoique de manière désordonnée. On veut se poser la même question pour ce qui est de l’ordre international régi par des règles. On entend beaucoup parler depuis deux ans de retour de la guerre (la Syrie, l’Ethiopie, le Yemen ne comptaient pas). Triple mensonge, bien sûr : elle ne s’est jamais arrêtée, elle prend, malgré les apparences, des formes nouvelles, et surtout ce n’est qu’un début. S’il faut penser la guerre c’est aussi pour anticiper les mobilisations qui viennent - spoiler : pour certains gouvernants, porter un col roulé est le commencement d’une prise d’armes.
-

La guerre ne meurt jamais
De la War on Terror à la Pax AmericanaDébut 2020, la géopolitique a été marquée par le retour de phénomènes réputés d’un autre âge : guerres de haute-intensité, génocide et annexion territoriale par la force. En résumé ce contre quoi l’ONU avait été créée en 1945. On savait le conseil de sécurité paralysé et les États-Unis sur une trajectoire isolationniste, mais les rivalités internationales auraient malgré tout dû, selon l’utopie libérale, se cantonner à la concurrence économique. La violence devait être réservée à ceux qui refusaient les règles du jeu, Rogue states et terroristes. Et l’Amérique ayant rendu son titre de gendarme du monde, d’autres États pouvaient s’investir davantage dans le maintien de l’ordre mondial. Après tout, la puissance américaine avait fait généreusement don au monde de la War on Terror. La France par exemple, nostalgique de son glorieux passé colonial, s’est empressée de s’en ressaisir : opération Harmattan en Libye ; opération Serval puis Barkhane en Afrique ; sécurisation des routes maritimes internationales. Le “cadeau” américain n’était cependant pas réservé à l’Occident : le général al-Sissi en Égypte, le maréchal Haftar en Libye, les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite au Yémen, ont eux aussi contribué à la lutte anti-terroriste. Mais c’était oublier le caractère subjectif et performatif de ce “mode de guerre”, pour reprendre les mots de C. Hass, qui permet son retournement. Loin de prolonger la Pax Americana, l’anti-terrorisme sert aujourd’hui à la contester.
La Pax Americana : guerres propres, guerres zéro mort et opérations de maintien de la paix.
Retour en arrière. Les gravats du rideau de fer tout juste balayés, les États-Unis devaient confirmer leur victoire et imposer leur domination en continuant de mobiliser des moyens militaires. L’opération “Tempête du désert”, celle de la première guerre du Golfe, allait consacrer leur rôle de gendarme du monde. Suivrait la Somalie, puis l’ex-Yougoslavie, à plusieurs reprises, mais aussi des raids et bombardements de moindre envergure tout au long des années 90. La Pax Americana fut une guerre, de celles qui font des milliers de morts et de destructions. D’aucuns parlent d’un million de morts en conséquence de l’intervention et du blocus américain en Irak à partir de 1991. Il fallait beaucoup de naïveté ou d’impudence, pour se demander à la fin de la décennie, le 11.09.01 : “Mais pourquoi ? Que nous veulent ces gens ? Que leur avons nous fait ?”.
Il fallait être naïf… ou plus simplement avoir cru au discours occidental, celui qui dit au fond que les guerres des années 1990 n’étaient pas des guerres.
La première intervention en Irak est sûrement le dernier conflit assumé : les buts de guerre étaient publiquement annoncés, Saddam devait se retirer du Koweït faute de quoi la coalition internationale interviendrait pour “libérer” la monarchie pétrolière. L’Irak est alors encore considéré comme un État souverain et un acteur rationnel qu’il faut respecter et avec lequel il est possible de dialoguer. La guerre est encore conçue comme la “continuation de la politique par d’autres moyens”. Quoiqu’elle s’efface progressivement des discours. Ainsi, conséquence de la Revolution in Military Affairs, la première guerre du Golfe serait la première guerre “propre”. L’écrasante supériorité technologique américaine limite les pertes de la coalition à quelques centaines (contre des dizaines de milliers pour l’armée irakienne). La guerre du Golfe n’a pas eu lieu écrivait d’ailleurs Baudrillard.
Possible après la chute du Mur, le New World Order devient “réalité” après le succès de l’opération “Tempête du désert”. “J’espère que l’histoire retiendra que la crise du Golfe a été le creuset du nouvel ordre mondial” disait Bush père. Conformément au projet néolibéral, le New World Order est un ordre dans lequel l’économie de marché, la “démocratie” (autoritaire) et les droits de l’homme sont garantis. Considérés comme des special interests américains, leur non-respect, sur l’ensemble du globe, vaut casus belli. Les batailles de la décennie 1990 seront menées en leur nom :
Il est de notre conviction profonde que toutes les nations et les peuples cherchent la liberté politique et économique […]. L’effondrement de l’idée communiste a montré que notre vision des droits individuels - une vision ancrée dans la foi de nos pères Fondateurs - parle aux espoirs et aux aspirations durables de l’humanité.
(National Security Strategy, 1991)Dans ce nouveau cadre néolibéral, la guerre se transforme et ses concepts se brouillent : la paix, la guerre, le civil, le militaire, les ennemis, les buts de guerre sont progressivement vidés de leur substance. En 1996, l’Otan constitue la “Force de stabilisation” pour instaurer en Bosnie-Herzégovine “un environnement sûr et sécurisé qui soit propice à la reconstruction sur les plans civil et politique”.
Finalement, le mot même de guerre finit par peu à peu disparaître des discours officiels, au profit de : “opération de maintien de la paix”, “opération de police”, “sécurisation à des fins humanitaires”, “opérations spéciales”. La novlangue n’ayant pas de limite, la “guerre propre” irakienne, devient la “guerre zéro mort” menée par l’Otan en ex-Yougoslavie.
Les militaires auront beau jeu de s’en lamenter, d’accuser les “terroristes” d’avoir ruiné l’édifice conceptuel de la guerre contemporaine, avec leur incarnation du “partisan”, à cheval entre le civil et le militaire. Ils oublient qu’il s’agit d’une conséquence directe du projet néolibéral. La guerre n’a, par définition, pas sa place dans un monde où la concurrence entre les États doit se résumer à la compétition économique. Quand il y a guerre c’est qu’elle est menée contre ceux qui refusent les règles du jeu politique et économique, comme l’Irak en 1991. Or, rares sont ceux qui vont s’y risquer. En 2001, le règne de l’économie semble définitivement établi quand la Chine adhère à l’Organisation Mondiale du Commerce. Côté américain, le brouillage des concepts et des logiques de la guerre est pensée par l’administration pour servir ses intérêts :
[Le National Security Strategy] est fondé sur la conviction que la ligne entre nos politiques intérieure et étrangère est en train de disparaître - que nous devons revitaliser notre économie si nous voulons maintenir nos forces militaires, nos initiatives étrangères et notre influence mondiale. Nous devons nous engager activement à l’étranger si nous voulons ouvrir les marchés étrangers et créer des emplois pour notre peuple.
(National Security Strategy, 1995)On sait que l’ordre néolibéral ne s’est pas imposé en douceur à l’ensemble du globe. Ce qui fut nommé la “stratégie du choc” a un volet militaire : Shock and Awe. Elle vise à « contrôler la volonté, les perceptions et la compréhension de l’adversaire et de le priver de toute capacité à agir et à réagir », en ciblant son environnement. “Cette doctrine militaire se targue de cibler non seulement les forces militaires, mais aussi, comme le soulignent ses auteurs, la société au sens large — la terreur de masse est en fait un des aspects déterminants de la stratégie” (N. Klein, p. 288). Ce n’est pas le “terrorisme”, qui a détruit l’édifice conceptuel de la guerre moderne…
 Ouverture de nouveaux marchés pour l’économie américaine.
Ouverture de nouveaux marchés pour l’économie américaine.La War on Terror, un mode de guerre subjectif
Les guerres menées en Afghanistan et en Irak à la suite du 11 septembre ne sont cette fois pas de simples “opérations de maintien de la paix”. Ces deux invasions marquent un réel tournant pour l’administration américaine. La définition de la guerre devient subjective et performative. Les États-Unis ont le monopole de son énonciation et sa légitimité est tributaire de leur unique volonté. Le gouvernement américain produit un antagonisme entre des valeurs, mène la guerre contre une “menace” et défend une “façon de vivre” :
La liberté elle-même a été attaquée ce matin par des lâches sans visage et la liberté sera défendue.
(Georges W. Bush, 11/09/01)Aujourd’hui notre nation a vu le mal, le pire de la nature humaine.
(GWB, 11/09/01)Les attaques terroristes du 11 septembre […] étaient des actes de guerre contre les États-Unis et ses alliés et contre l’idée même de société civilisée.
(National Strategy for Counterterrorism, 2003)L’Amérique sera leader dans la défense de la liberté et de la justice car ces valeurs sont justes et vraies et immuables pour tous les peuples dans le monde.
(GWB, 29/01/02)Cet ennemi n’est pas une personne. Ce n’est pas un régime politique. Encore moins une religion. Cet ennemi est le terrorisme : une violence préméditée, politiquement motivée et perpétrée contre des cibles non combattantes par des groupes infranationaux ou des clandestins.
(NSCT 2003)Le seul moyen de vaincre le terrorisme comme une menace sur notre façon de vivre est de le stopper, de l’éliminer et de le détruire là où il croît.
(GWB, 20/09/01)C’est un conflit sans champs de bataille et sans têtes de ponts, un conflit avec des opposants qui se croient invisibles.
(GWB, 14/09/01)Pour C. Hass, il ne s’agit pas juste d’un “habillage rhétorique”. Ces valeurs organisent les guerres, en leur nom, les coalitions sont constituées et l’ONU est supplantée. Elles effacent toute “référence aux États, aux politiques, aux souverainetés, aux territoires et participent de la construction de l’ordre subjectiviste. Elles disposent d’une catégorisation du monde selon leurs propres critères, sans altérité politique puisque nul n’objecta, le terrorisme ne constituant pas même une revendication, une politique pour les terroristes eux-mêmes.”
La War on Terror est uniquement le produit du décisionnisme américain. Contrairement aux années 90, les États-Unis n’insèrent plus leur action dans le cadre de l’ordre international et ne tirent plus leur légitimité de ses institutions. En 1991, Bush père agit sur mandat de l’ONU. Et, lorsqu’il a écrasé l’armée de Saddam, il a la possibilité de pousser jusqu’à Bagdad, l’idée lui est suggérée, mais il s’y refuse. Après une décennie de brouillage des concepts régissant la guerre et d’hégémonie américaine, envahir un État souverain sans mandat de l’ONU avec un projet de regime change devient une possibilité. Il ne s’agit pas juste d’une lubie des néoconservateurs ou des grands groupes pétroliers, lubie qu’ils auraient réussi à mettre en œuvre en infiltrant l’administration Bush. Les faucons ne sont pas uniquement des néoconservateurs, ce sont aussi pour partie des démocrates et des néolibéraux. Autrement dit, le regime change est une radicalisation du New World Order des années 90 :
Toutes les traditions qui appelaient à un changement de régime […] considéraient les valeurs américaines comme transportables ; toutes assimilaient les menaces contre les valeurs américaines à des menaces contre la sécurité nationale ; et toutes supposaient que la puissance américaine était bienvenue en Irak car elle matérialisait les valeurs libérales. Bush a mobilisé ces préceptes en 2002-2003 mais les élites politiques les avaient promulguées et assimilées bien avant son arrivée au pouvoir.
(McDonald, p. 257)L’administration américaine et les élites ne pensent pas l’invasion de l’Irak et de l’Afghanistan comme une guerre. Les US Armed Forces agissent dans l’intérêt du peuple irakien, les frappes ne visent pas un territoire ou un peuple, mais un régime “terroriste”. “Nous pouvons viser un régime pas une nation” disait Bush. Il ne s’agit pas d’une guerre mais d’une libération : Iraqi Freedom.
 Les G.I sont de piètres serruriers
Les G.I sont de piètres serruriersSelon C. Hass, l’objectif n’est pas de dissimuler une guerre interétatique mais de détruire le concept même d’État-souverain. L’entreprise de destruction des concepts de guerre, de paix, d’ennemi, de civil, de militaire, démarrée à la chute du Mur aboutie à celle du concept d’État souverain et de l’altérité politique. Le projet de regime change dans ses implications politiques (construction ex nihilo d’un État minimal et autoritaire), économiques (privatisation, libéralisation et ouverture des marchés), sociétales (négation des réalités sociales) et conceptuelles symbolisent la “victoire” du néolibéralisme :
Dans ce mode, l’État se trouve disqualifié en ce que l’ennemi ne s’identifie plus à l’État ennemi. Cette conception est homogène à une volonté de solder le XXe siècle comme siècle politique clivé entre des États différenciés désormais consommés par l’internationalisme libéral étatsunien ; la fin de toute altérité politique et de l’existence d’État séparateurs est explicitement donnée par les États-Unis comme leur victoire, une victoire devant ouvrir à la fin des États-nations en prise avec des “luttes” politiques.
(Hass)De fait, les invasions de l’Afghanistan et de l’Irak sont pensées par l’administration américaine dans le cadre du projet New Middle East qui vise à redessiner en profondeur la région.

Dans le cadre de la War on Terror, la guerre ne connaît donc plus de limites, elle est “sans lieu et sans fin, tant ses objectifs quand ils sont formulés, demeurent sans portée effective”. (Hass) Concrètement, la guerre excède le simple domaine des opérations militaires. L’armée américaine en prend acte, le général Petraeus théorise en Irak et en Afghanistan la doctrine de la counterinsurgency. Sauf que la tâche devient dès lors insurmontable, comme le relève ironiquement W. Brown : “bien que l’armée recrute dans les “couches non éduquées de la population américaine”, qu’elle soit hostile aux savoirs non militaires, [il est demandé aux militaires de] se transformer en anthropologue, économiste, expert en politiques publiques et animateur pour jeunes enfants. Les jarheads doivent au passage déconstruire leurs préjugés racistes, misogynes et orientalistes. Au-delà, c’est tout le logiciel hiérarchique, bureaucratique et centralisateur de l’institution qui doit être transformé. La contre-insurrection nécessite une autonomie des forces sur le terrain. Concrètement ça donne les scènes mythiques de Restrepo : un lieutenant qui tente de vendre l’American Dream à des paysans afghans qui n’ont pas l’air très intéressés.”
 Restrepo
RestrepoAu fond le caractère insoluble de la tâche importe peu. La décision de la guerre était unilatérale et performative, celle de la paix aussi. “It’s Time For Our Troops To Come Back Home” : clap de fin.
De l’universalisation de la War on Terror à son retournement contre la Pax Americana
D’aucuns ont espéré naïvement que la War on Terror prendrait fin avec le départ de l’administration Bush. Obama allait remettre les choses en ordre, se repentir de l’hubris de ses prédécesseurs. En 2009, il reçoit le prix Nobel de la paix et s’empresse de déclarer : “La paix exige de la responsabilité. La paix implique le sacrifice. C’est pourquoi l’Otan continue d’être indispensable.” Oups. Le logiciel américain reste le même bien que les outils changent : les opérations spéciales, les drones et frappes chirurgicales remplacent la “surge”. En 2014, c’est toujours la logique de la War on Terror qui anime la coalition internationale contre l’État Islamique. On peut même y voir une certaine radicalisation. En 2003, il y avait un projet de société pour l’Irak, en 2014 il s’agit d’annihiler et de repartir, pour ne pas prendre le risque de s’enliser. Annihiler qui ? Quoi ? C’est si peu clair qu’il devient possible de raser des villes entières. D’une part on ne discute pas avec le Mal, d’autre part cela a une forme d’efficacité, de Dresde à Alep en passant par Hiroshima. Et cette fois l’ONU a donné sa bénédiction.
 Défense du camp du Bien
Défense du camp du BienLa coalition internationale dirigée par les États-Unis est alors rejointe par de nombreux pays occidentaux. Rien d’étonnant, l’anti-terrorisme y est devenu le mode de gouvernement depuis plusieurs années. Mais il n’est même plus le privilège de l’Occident et de ses alliés. La War on Terror étant subjective et performative, elle est aisément réappropriable. Depuis 2001, elle s’est donc internationalisée sans que la nature des régimes qui y participent ne rentre en compte. Aidés par le retrait américain, les supposés Rogue states et les “terroristes” d’hier se sont empressés de s’en ressaisir. Sur le terrain, l’action de la coalition internationale se couple donc à celle de l’Axe de la Résistance (Syrie, Iran, Russie) et de ses milices (Hezbollah libanais et irakiens). De la France à la Chine en passant par l’Égypte ou le Kurdistan on traque les terroristes. Même les Talibans s’y sont mis comme nous l’apprend un rapport français du conseil de sécurité :
Tout en conservant des liens avec de nombreuses entités terroristes, les Talibans ont fait pression sur les États membres pour qu’ils les aident à lutter contre le terrorisme dans le cadre de leur combat contre l’État islamique d’Irak et du Levant - Province de Khorasan (ISIL-K), qu’ils considèrent comme leur principal rival. (2023)
Les États ne reprennent pas juste la réthorique de la War on Terror mais aussi ses logiques et ses armes. Aidées par la paralysie du conseil de sécurité, les ambitions régionales s’affirment en niant les États et les insitutions internationales. L’anti-terrorisme permet à l’Azebaïdjan et à la Turquie de faire main basse sur des portions de territoire de leurs voisins. Le génocide à Gaza et le ravage du Liban sont menés dans le même cadre. Pour Sheytaniahou, qui s’exprime comme Bush en 2001, l’ONU est une “farce”, la distinction civile/militaire n’existe pas, pas plus que le concept d’État souverain. La région doit donc être redessinée.

Les promoteurs israéliens lorgnent déjà sur la bande de Gaza et le Sud Liban. Pour y arriver tous les moyens sont bons. Tsahal fait exploser simultanément les bipeurs des “membres” du Hezbollah en espérant que l’explosion sidère les civils à proximité, ou plus simplement qu’elle ne les tue. Autrement dit, elle reprend le principe de l’attentat-suicide, qui était jusqu’à présent dénoncé comme une “violence aveugle”, et donc inacceptable. Même méthode, même principe : vous n’êtes en sécurité nulle part. Israël n’a pas attendu les américains pour massacrer des civils mais la War on Terror en fait des cibles légitimes, voire privilégiées. Il ne s’agit pas juste de frapper les civils pour mettre une pression par ricochet sur un ennemi qui se cache. L’enjeu de l’anti-terrorisme est précisément la population civile. Elle n’est, selon le prisme paranoïaque du renseignement, rien d’autre qu’un ensemble de menaces réelles ou possibles. Il faut donc surveiller, contrôler et éliminer. Traumatiser, mutiler et tuer sont autant de façons de soumettre la population civile à une emprise, de diffuser la peur et la paranoïa. Dans le cas d’Israël, logique anti-terroriste et logique génocidaire se renforcent.
A contrario, il n’y a plus que les derniers perdants de l’ordre international pour encore brandir le droit. La mission iranienne à l’ONU justifie le tir de missiles en affirmant qu’il s’agit d’une “réponse légale, rationnelle et légitime de l’Iran aux actes terroristes du régime sioniste” Avant cela, Nasrallah affirmait déjà qu’Israël avait outrepassé toutes les règles d’engagement avec les frappes sur la banlieue Sud de Beyrouth. Suite à l’assassinat de ce dernier, le Hamas dénonçait un “acte terroriste lâche”. D’un côté, les “terroristes” cherchent à être reconnus comme des acteurs politiques légitimes par un système international en lambeau. D’un autre, un État reconnu par ce même système lui dénie toute légitimité et recourt à des méthodes relevant de la définition même du terrorisme établie par l’ONU. Le retournement prêterait à sourire si ses conséquences ne s’avéraient si tragiques.
Ironie de l’histoire, le mode de guerre subjectiviste sert à contester la domination américaine. La Chine reprend la main sur Hong-Kong avec la HK national security law basée sur la logique anti-terroriste. Les milices pro-Iran se sont imposées en Irak par le biais de la lutte contre l’État Islamique. La Russie mène une “opération spéciale” en Ukraine et utilise les lois anti-terroristes pour museler la contestation interne. Il ne faut pas s’y tromper, qu’elles soient menées avec des moyens archaïques (barils d’explosifs jetés depuis un hélicoptère en Syrie) ou des hautes-technologies (smartbombs israéliennes), par des régimes “démocratiques” ou “autoritaires”, contre des groupes militaires, des États ou des peuples, les guerres contemporaines sont menées dans le cadre de la War on Terror. En 2001, la diffusion de l’anti-terrorisme devait permettre la stabilisation de l’hégémonie américaine et pacifier les marges récalcitrantes de l’Empire. Deux décennies plus tard, la War on Terror a bien été reprises par de nombreux États et groupes paramilitaires, mais elle sert à remettre en question la Pax Americana. Avec sa généralisation, c’est la possibilité de guerres sans fin, sans lieu et sans limite qui s’est généralisée. La “montée aux extrêmes” se déploie selon une logique mimétique, les belligérants s’inspirant les uns des autres. Il faut être un journaliste d’Arte pour affirmer que les états-majors des pays libéraux n’ont pas le cerveau câblé pareil que celui de leurs homologues des “Empires”. On imagine facilement la fascination des généraux israéliens devant les ruines d’Alep, et celle des russes devant les bombardements de Mossoul par les avions de la coalition. Les guerres sont des laboratoires à ciel ouvert, scrutés par les experts militaires qui espèrent en sortir avec un coup d’avance pour le prochain conflit. Ils en sortent généralement avec un temps de retard. Il y a 10 ans on parlait de cyberguerres et de soldats-augmentés. Aujourd’hui on creuse des tranchées dans les bases militaires pour s’entrainer à un scénario à l’ukrainienne…
Une reconfiguration de l’Empire à travers l’écologie de guerre
La multiplication des conflits marque-t-elle le début d’un effondrement de l’Empire ? L’ouverture d’une période de chaos après plusieurs années d’ordre néolibéral ? Rien n’est moins sûr. En 2001, Tiqqun affirmait que l’Empire était une “sorte de domination qui ne se reconnaît pas de Dehors […] L’Empire n’exclut rien, substantiellement, il exclut seulement que quoi que ce soit se présente à lui comme autre, se dérobe à l’équivalence générale.” Domination qui s’exerce principalement par la “ruse” anti-terroriste.
Les horreurs contemporaines sont le signe de la radicalisation de cette ruse et d’une reconfiguration de l’Empire - qui n’a que faire des concepts d’État, de droit international ou de démocratie. L’Empire se maintient par la neutralisation du politique. La géopolitique n’est ainsi pas incompatible avec la dépolitisation, bien au contraire. En Syrie, en Libye, au Liban, en Irak, les dynamiques révolutionnaires ont été rattrapées par la géopolitique, de la rhétorique campiste à la capture de la question révolutionnaire par la guerre. L’Empire s’accommodera donc sans problème d’une Pax Sinica, Russia, Irania, aussi bien que de conflits intenses, multiples et permanents.
Les plus cyniques s’imaginent déjà pouvoir tirer profit de la dernière option. Les guerres constituent une réponse au double problème de la stagnation économique : une croissance limitée dans un monde fini. La destruction permet la création de valeur et d’aucuns voient même dans les conflits en cours la possibilité de réaliser la transition écologique. En Europe et aux États-Unis, l’affrontement avec la Russie est appréhendé à travers “l’écologie de guerre” :
Un paradigme général qui inaugure un nouveau discours de mobilisation idéologique et économique (…) Sa caractéristique centrale est que les principes de l’écologie politique sont intégrés dans une logique de confrontation au sein de laquelle l’ennemi est à la fois la source de la déstabilisation géopolitique et le détenteur de la ressource toxique.
(Charbonnier, p. 280)La transition écologique devient donc un impératif stratégique pour les puissances occidentales. Elle doit leur permettre de sortir de la dépendance à la Russie pour élever le niveau de confrontation. La pathétique campagne des verts au Parlement européen : « Isolate Putin, insulate your home », ne doit pas faire oublier le sérieux du projet. En 2020, Ursula von der Leyen déclarait :
Pendant cette guerre, nous avons considérablement […] affaibli l’emprise de la Russie sur notre économie et notre continent. Nous avons fait trois choses, comme vous vous en souvenez : La première était la réduction de la demande. […] Et bien sûr, la troisième étape est la plus importante. Il s’agit d’investissements massifs dans les énergies renouvelables. Nous avons REPowerEU sur la table. Les énergies renouvelables […] nous rendent indépendants. Cette année, nous déploierons des énergies renouvelables équivalant à environ 8 milliards de mètres cubes. [Elles] sont donc notre assurance énergétique pour l’avenir.
Parallèlement, le Green New Deal de l’administration Biden est pensé comme un moyen d’accéder à la souveraineté énergétique et se double de politiques protectionnistes pour s’émanciper de la Chine.
L’idée a déjà trouvé des apôtres au sein de la galaxie écologiste. Non content de l’avoir théorisée, le latourien P. Charbonnier espère qu’elle permettra d’enfin surmonter les écueils du mouvement écolo. Après l’échec de l’approche scientifique, après l’échec des mobilisations liant écologie et justice sociale, l’écologie de guerre devrait permettre aux militants de se doter d’une théorie du pouvoir (en opposant un bloc de la transition à un bloc de la non-transition), de sortir de la naïveté et d’agir réellement sur les sociétés… en participant à l’effort de guerre : “la planète, autrement dit, a besoin d’une stratégie de défense et d’un groupe d’acteurs résolus à l’appliquer.” Non content d’encourager le mouvement écolo à renoncer à son héritage anti-militariste, les apôtres de l’écologie de guerre lui offrent une théorie soluble dans la gouvernance néolibérale. Il y est question de “résilience”, d‘“empowerment”, de “capabilités” et d‘“ingénieurie sociale” afin qu’elle se déploie dans le quotidien. Et tout est finalement sacrifié sur l’autel de l’écologie, comme l’admet une consœur de Charbonnier :
Que « la régulation volontariste des schémas de consommation industriels et domestiques » à des fins de sobriété énergétique s’opère au nom de l’atténuation (raison climatique), de la souveraineté (raison économique) ou de la guerre (raison géostratégique) n’a au fond que peu d’importance, si l’on considère que le résultat l’emporte sur les registres de justification.
(Magali Reghezza-Zitt)Évidemment, tout cela au nom du Bien, de l’humanité, de la planète, de la paix ou encore de l’égalité et de la justice sociale. La gauche s’y retrouvera sûrement… pas nous.
-
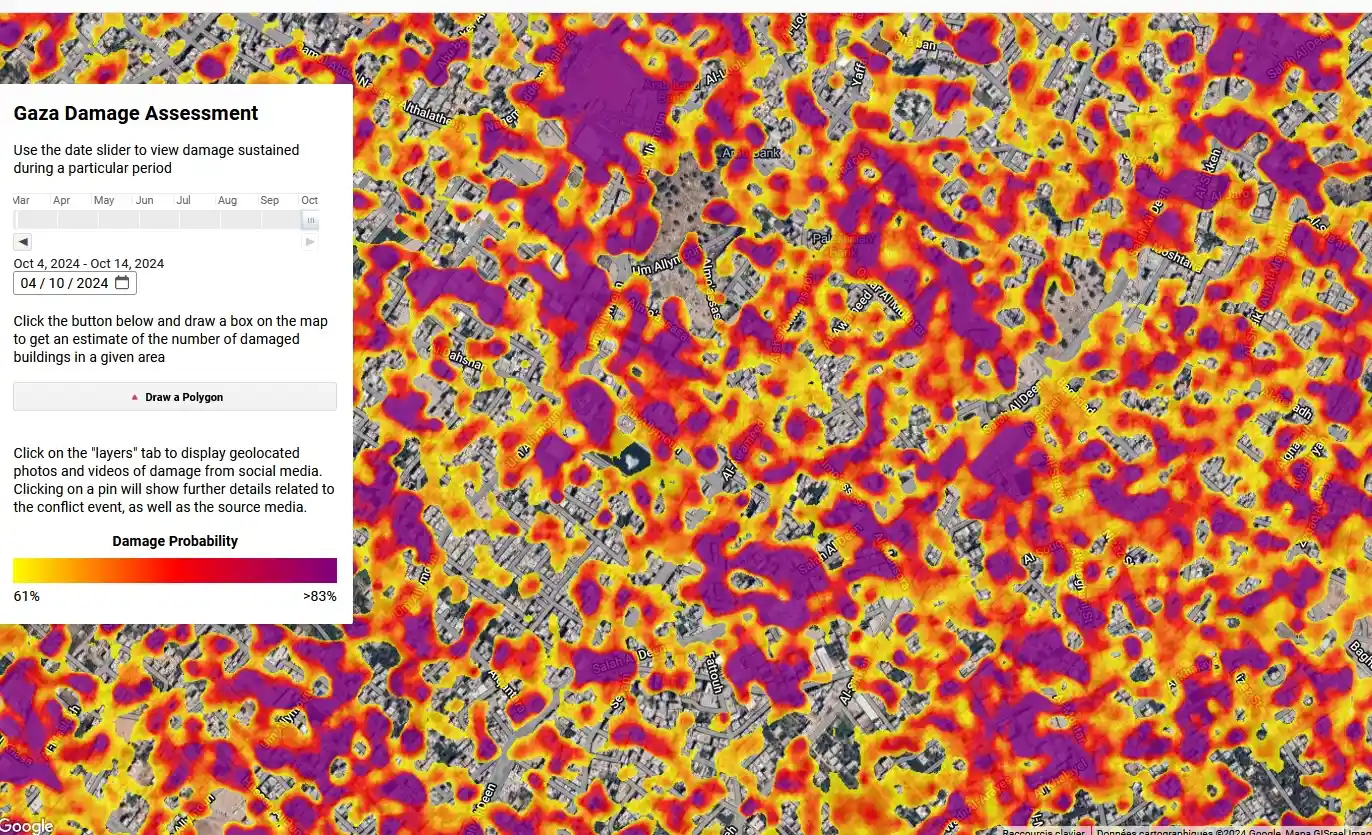
Guerre totale
Guerres totales ou guerre sans finI hail it as an example of sublime and poetic justice that those who have loosed these horrors upon mankind will now in their homes and persons feel the shattering strokes of just retribution.
(Winston Churchill, discours radiophonique du 10 mai 1942, anticipant les bombardements à venir de Dresde, Cologne, Hamburg, Berlin, Tokyo, Hiroshima et Nagasaki)La guerre, parait-il, est revenue aux oreilles des Occidentaux. Il fallut pour cela quelque chose de plus bruyant, de plus proche, de plus familier. Il fallut l’Ukraine, l’identification européenne, un peuple finalement susceptible d’empathie. Il fallut que ce soit un peu plus blanc, en somme.
Pourtant la guerre, dans son fracassant « retour », ne nous a jamais quitté. Ni après 1945, ni après 1991 d’ailleurs. Tout au plus, on la délocalisa, on prétendit la tenir à distance des âmes. Retenue, organisée aux confins du monde civilisé, monde consacré, en paix, et pourtant en sursis. Monde garanti au prix d’un ordre sanglant, dont les horreurs ne devaient frapper, lointainement, dans le murmure indiscernable de l’Histoire, que quelques barbares. Aussi, que les États-Unis se firent - comme le veut l’expression - « gendarmes du monde », que l’empire de la démocratie libérale distribua les « dividendes de la paix », ou que la mondialisation de l’économie de marché dût susciter une non moindre mondialisation de la pacification : la guerre continua de se faire, au nom d’une certaine tranquillité. L’ordre ne fut jamais cette fameuse paix, clame-t-on aujourd’hui au plus haut de la doctrine militaire française, mais une (re)définition des raisons de faire la guerre,
Entre les années 60 et 90, on passa des « conflits détournés » (les théâtres extérieurs de l’affrontement US-soviétique) aux opérations du maintien de la paix (interventionnisme extensif, subjectivé depuis les intérêts particuliers, d’abord occidentaux). Des opérations du maintien de la paix, on passa aux luttes d’influence, barbouzeries, opérations spéciales, sabotages et dénis d’accès. Il fut également question de guerres asymétriques et de guerres irrégulières. On nous présenta des ennemis constitués en deçà du seuil de l’État, contre qui – justifia-t-on - tout était permis. La guerre s’étendit, et assuma des moyens plus « modernes » : contre-insurrection, cyberguerre, désinformation, et autres « pratiques non-conventionnelles ». On conclut que la guerre, ce grand fourre-tout, était devenue « hybride ». Avant de finalement revenir sans maquillage sur la scène de l’Europe. Autant dire qu’au fait de disparaître, elle s’était plutôt employée à tout contaminer, s’éloignant largement d’un idéal-type classique ou « contrôlé ». « L ‘hybridité » déjà, au moins à partir de 2005 et de la présence américaine en Irak, marquait l’assomption d’un échappement, d’un débordement des limites, faisant de la logique de guerre un fait accélératif et viral. Là où se mêle finalement, en bout de chemin, militaire, politique, sécuritaire et civil.
Pourtant, et pourtant, il fallut donc l’Ukraine pour réveiller une forme d’intérêt, une certaine inquiétude. S’ajouta le 7 octobre, et l’attaque du Hamas sur Israël. Ébranlement. Puis on se mit à parler, un peu partout (c’est à dire ici), d’un « monde en guerre(s) ». On fit mine de se réveiller au milieu des cadavres, d’un futur devenu d’un coup si effrayant, d’un Occident assiégé. Menaces nucléaires, logiques génocidaires subitement évidentes, aplatissement géographique des conflits, clairons de la mobilisation, économie voir écologie de guerre même : un tourbillon commença à faire signe. Indiquant que la simpliste rhétorique de l’ère anti-terroriste, où un axe du Bien poursuivrait de vilains fanatiques planqués dans des tunnels au milieu du désert, ne racontait plus rien. La guerre allait tout engloutir, elle arrivait de partout. Jusqu’à se demander si elle n’était pas enfin, et comme d’autres l’avaient depuis longtemps prédit, devenue totale.
La « guerre totale », donc, n’est pas idée nouvelle. Ce fut d’abord au sortir d’une Première Guerre mondiale que deux hommes ne se connaissant pas, mais ayant en partage l’ignominie (Léon Daudet, de la jeune Action Française et le maréchal Ludendorff, primo-militant du mouvement nazi), se tournèrent vers ce qu’ils avaient vécu, vers cette première guerre absolument industrielle, et qui dévora tout, pour la qualifier de totale. Ils virent là, avec effroi, la consumation de sociétés toutes entières, que seul pouvait permettre le couplage d’appareils étatiques et productifs modernes. Seuls à même de marquer un seuil décisif dans la capacité de mobilisation, mobilisation intégrale qui vit fusionner armée et peuple. Guerre de masse donc, engrangée par la combinaison de la conscription universelle (requise des citoyens de par le contrat démocratique) et de sa mise en œuvre administrative, par le recrutement effectif des troupes (possible seulement par l’appareil administratif moderne). Jacques Guibert pourtant, anti-démocrate averti lui aussi, fin stratège et précurseur de Jomini et Clausewitz, avait annoncé dès le XVIIIe siècle les conséquences néfastes de la constitution d’armées populaires : aux peuples en armes, des guerres illimitées.
Ainsi 14-18 devait marquer une explosion de toutes les digues – géographiques, temporelles, économiques, mentales – à l’exercice de la guerre. Une société – enfin intégrale pourrait-on dire – transmutée par la réquisition et la mise au travail, à la fois industrielle, technologique et financière. Conversion radicale, unitaire, d’une économie - sociale et productive – du civil vers le militaire : innover, armer, produire, dans la seule logique du conflit. L’organisation des sexes même s’en trouva bouleversée, pas moins que celle des esprits, travaillés continuellement par les censures et les propagandes. Le massacre, lui aussi, fut industriel (ce qui pour le coup ne fut pas tout à fait nouveau – que l’on pense par exemple aux guerres de colonisation). Mais cette fois y disparut pour de bon le héros militaire, figure quelque peu romantique de l’historiographie de la guerre en Europe : non sans déclencher quelques réactions éplorées d’ailleurs (voir du côté de chez Schmitt ou Junger par exemple). Héros faisant place donc au soldat inconnu, sacrifié, défiguré, celui des guerres totales. On parlait alors, avec un certain tremblement nostalgique dans la voix, de la guerre comme d’une machine (image qui obséderait par la suite tout le siècle), et dont les hommes fourniraient le carburant.
La notion tomba quelque peu dans l’oubli. Tout juste quelques historiens - John U. Nef au détour des années 50, Jean-Yves Guiomar en 2004 - s’intéressèrent au basculement des guerres de l’Ancien Régime, réputées limitées, à celles de la Révolution et de l’Empire, qui devaient l’être moins. Et c’est un américain, David Bell - notamment à partir de son intérêt pour les événements précédant le 1789 français - qui proposa d’arracher la guerre totale (que Clausewitz aurait appelé “absolue”) à ses premières définitions, afin de la rendre à une description pleinement politique. Bell en fait ainsi non pas une forme finie et circonscrite (un état fixe), mais une mécanique latente, une force d’attraction. Une “ligne de fuite” mauvaise, pourrait-on dire. « Totale » désignant alors moins un stade réel – quantifiable - d’une guerre effective, qu’une tendance. Celle qui viserait la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles, afin de détruire absolument son ennemi. Objectifs infinis, toujours incomplets. Aussi la guerre rendue comme totale est dispositif de sens : poussée vers un engagement toujours approfondi, vers une mobilisation toujours étendue. Idéale, mythe même, elle exclut dans la capture de ce qui l’environne (sociétés, économies, populations) toute frontière. Goebbels lui-même n’avait-il pas demandé aux nazis rassemblés au Palais des Sports de Berlin en 1943 : « Voulez-vous une guerre totale ? ».
La totalité serait alors l’horizon mauvais de chaque guerre. Mais comment identifier a minima un certain point de bascule ? Par quel critère avons nous basculé au-delà des normes de la guerre honorable de l’Ancien Empire ?
Je suggère que si l’idéal de la guerre totale ne peut se réaliser, sauf dans quelques cas exceptionnels, la poursuite de cet idéal par des états belligérants peut mener néanmoins à une radicalisation irrésistible et incontrôlable de la guerre, une course à l’abîme qu’il est presque impossible d’arrêter jusqu’à ce que l’une des parties s’effondre. Cette radicalisation est mise en marche par la politique : par la détermination des autorités civiles de se battre jusqu’au bout et par la diabolisation de l’ennemi – sa transformation dans les représentations en menace existentielle et inhumaine qui doit être détruite –. En outre, les guerres totales sont vues par ceux qui y sont engagés comme une rupture historique, voire apocalyptique, et non pas comme un élément ordinaire de l’ordre social. Donc domine la rhétorique de « la lutte finale » ou de « la guerre qui mettra fin à toutes les guerres » .
Récapitulons : détermination (stratégique) de l’autorité étatique en guerre à rendre celle-ci totale, impossibilité de concevoir des buts de guerres intermédiaires et en deçà d’une annihilation radicale de l’ennemi, en conséquence fabrique de ce même ennemi comme figure du mal absolu (menace existentielle – lutte à mort - et en cela inhumaine – déshumanisée). A cela rajoutez la tendance inertielle de la guerre à tout entraîner dans son propre cours, et à se continuer pour elle-même, et vous aurez la guerre totale. Les guerres de l’Empire et de la Révolution pour commencer, qui occupèrent donc bien des historiens. Puis les deux Grandes Guerres du XXe siècle. Et enfin nous dirions : la guerre contre le terrorisme (matrice incontournable du contemporain). Comment expliquer sinon qu’Israël puisse faire exploser tout ce qui bouge au Proche-Orient (comme le faisaient ailleurs – il n’y a pas si longtemps – les États-Unis ou la Coalition internationale) ? Ou que Poutine puisse envahir l’Ukraine pour la purger de ses nazis (eux-mêmes assignés désormais à combattre “pour la vie”) ? Et qu’Al-Assad puisse faire disparaître l’intégralité du peuple syrien, terroriste ou non ? Comment, sinon par une hérédité de la méthode de la guerre totale ? Guerre sans bornes, décidée comme sans bornes. Guerre de l’ennemi absolu, à qui l’on ne doit que la mort, et qui autorise tous les moyens. Guerre essentialisée, et qui nie à son rival substance politique comme humanité. Guerre contre le principe même du politique, en dernier ressort, et en cela conforme à notre époque. Guerre hégémonique, imposée par la morale et la nécessité. Guerre enfin sans fond, et qui ne terminera jamais. « On ne négocie pas avec les terroristes » : tout avait recommencé par là.
On pourrait objecter une interprétation quantitative de l’horreur. Dire que c’est le chiffre qui fait critère, et réserver les mots “totale”, “absolue”, “extrême”, aux guerres estimées les plus sanglantes (mais depuis quel point de vue ?). Lecture subjectiviste. Compter les morts, les obus, les lignes de crédits, les mois ou les années, les membres coupés, les syndromes post-traumatiques même. On comprendrait vite que comme en toutes choses la logique comptable - a fortiori quant il s’agit de mesurer la souffrance - a quelque chose de dégoutant. Les bombardements sur Paris de 1918 n’ont fait “que” 267 morts officiels, mais 800 000 déplacés y laissèrent une partie de leurs vies (on demanderait alors : qu’est ce qu’une vie perdue ?). 15 000 hommes ont suffi pour assurer – sur le peuple insurgé des Hereros – le premier génocide documenté du XXe siècle (quels moyens faut-il pour annihiler un monde ?). Les chiffres disent si peu, et les effets de comparaison produisent en la matière un goût particulièrement douteux. Il s’agit alors d’insister : la guerre est totale par un changement d’essence, et non de seuil. C’est donc au niveau des volontés qu’il faut regarder. Ainsi fut absolue et implacable celle de Churchill lorsqu’il annonça la vengeance à venir des Alliés sur leurs ennemis coalisés. Dès 14-18, ce n’est pas simplement le nombre de bombardements qui change, c’est la conception stratégique que l’on s’en fait. Il s’agit à partir de là d’atteindre massivement et durablement les populations civiles, ainsi que leurs milieux de vie (les villes, principalement). Cette intuition – gagner sur le militaire en terrorisant les populations – a eu la postérité qu’on lui connaît. Évidemment bien au delà de la figure commode et gouvernementale du “terroriste”, dont les États ont depuis longtemps adopté les méthodes (depuis la “stratégie de la tension” dans l’Italie des années 70, jusqu’à l’explosion des bipers libanais par les services israéliens).
Aussi, et pour en revenir à notre historien étasunien, il s’agit de décoller aujourd’hui cette description de la guerre totale de son contexte d’émergence (la Première Guerre mondiale donc). Moins que l’industrie – qui fut tant vilipendée par les critiques précoces de la déshumanisation du social -, c’est d’abord l’État qui agit comme architecte. Seul à même de rassembler les capacités administratives utiles à la mobilisation de toute une société, de ses concitoyens, de ses ressources, et sur une large échelle géographique. Seul en mesure d’établir la conscription (enjeu s’il en est du présent conflit russo-ukrainien), de piloter l’approvisionnement en armes et munitions, ainsi que leur acheminement, et ainsi de suite. Seul à même de tout planifier au final. Car si l’horreur se marrie si bien à la technologie, elle ne l’a pourtant pas attendue pour se faire une place dans l’Histoire. Quant à la guerre d’extermination ultime – guerre nucléaire -, il faudrait finalement bien peu de moyens et de mobilisation pour aujourd’hui la mettre en œuvre (appuyer sur le bouton). La guerre totale – s’il fallait la cerner - est bien fait politique, et non fait matériel.
Aux guerres totales, celles dont le XVIIIe siècle consacrerait donc l’avènement, précédèrent les “guerres de dentelles”. Ces dernières furent un temps, dit-on, un modèle de la guerre limitée. Où, alignées en rang d’oignons, tenus par une discipline militaire impitoyable, les armées de métier se canardaient à tour de rôle, jusqu’à que plus personne ne reste debout, ou qu’on décide de se retirer. Les nations, alors considérées comme bridées par leurs crédits en soldat professionnels, poursuivait la bataille décisive, celle qui au plus tôt mettrait un terme à cette ennuyeuse dépense. Bien avant cela encore, on inventa la “guerre juste”. Héritée par l’Occident des Romains, et qui perdurera sous la forme du droit canonique au Moyen-Âge. Saint Thomas d’Aquin en coucha la plus célèbre formule : auctoritas principis (seule la puissance publique décide de la guerre), causa justa (selon une cause juste), intentio recta (avec des buts clairs, éclairant le bien commun). Ces principes subsistèrent jusqu’à l’ère moderne, et fondèrent le droit international à la guerre. Droit à la guerre, mais également droit dans la guerre, puis droit après la guerre (car Saint Thomas avait tout prévu). Aujourd’hui cela devait donner à peu près ceci : en plus d’une certaine “légalité” au déclenchement de la guerre, les deux parties devaient s’assurer de la proportionnalité des moyens ainsi que de la protection de la population civile (et des prisonniers). Les traités de paix, actes contractuels, sonneraient enfin la fin de partie.
A lire de tels modèles, on pourrait aujourd’hui ricaner - si les conséquences n’étaient pas si graves. Pourtant cet idéal chrétien doit encore animer, parait-il, cette chose aujourd’hui bien morte, utopie en son temps, qu’est le droit international. Selon lui, les guerres se seraient faites dignement, dans un certain ordre, en bon père de famille. En tenant la limite entre buts armés et buts politiques, entre guerre et paix, entre lieu d’affrontement et lieu civil, entre combattants et non-combattants. Cela exista-t-il simplement un jour ? Clausewitz lui-même parlait de “guerre réelle”, pour dire que la guerre ne répond jamais à aucune modélisation : que toutes se fracassent sur leur actualisation historique. Et il faut bien quelques ingénus généraux pour prétendre aujourd’hui que la gentille guerre - à jamais perdue, et à jamais trouvée - a simplement été dévoyée là par quelque ennemi peu scrupuleux, là par les lois de la nécessité. Une chose est sûre néanmoins - à cela tous les commentaires (militaires, politiques, civils) s’accordent : celle-ci a rarement semblé si lointaine chimère.
La généalogie des conflits contemporains présente au contraire le visage d’un brouillage toujours plus accru des limites théoriques à la guerre. Chacune des barrières - parmi celles que l’on vient d’énumérer - est à tous les coups et méthodiquement transcendée. Les raisons n’ont pas manqué. Ainsi à la guerre des peuples succéda la guerre nationale-biologique (les Aryens contre le reste du monde). À l’insurgé moderne – ennemi non-conventionnel, ennemi sans droit - on fit correspondre le terroriste - figure par essence du Mal. Les États eux-mêmes devinrent au besoin “voyous”, pour autoriser tout traitement ailleurs déraisonnable. La guerre prit au final, assez ironiquement du reste, un aspect de plus en plus religieux. À chaque fois de plus en plus inquestionnable, à chaque fois de plus en plus illimité, à chaque fois de moins en moins politique. Ainsi peut encore résonner aujourd’hui la rhétorique post-11 septembre de “l’Axe du Mal”, flanquée de son grotesque millénarisme. En 2001, la partition manichéenne visait l’Iran, l’Irak et la Corée du Nord. Aujourd’hui, on y inclut la Russie et la Chine. Tout est différent, sauf la façon de fabriquer l’antagoniste (le Grand Méchant des contes) : d’ailleurs, chacun (dont les adversaires d’hier) [a désormais en la matière adopté les attendus de la “war on terror”, échappée aux américains] (./3). Les guerres ainsi fabriquées restent sans fin, guerres possibles en tous lieux (à la fois exotiques – loin là-bas vers l’Est – et domestiques – la porte à côté). Elles inquiètent les civils, car l’ennemi est partout : les “collateral damages” de la guerre “chirurgicale” des drones, comme ce parent d’élève suspect portant l’habit traditionnel (ou quelques fois, créant la surprise, ce bon citoyen traversant brutalement le miroir au détour d’un attentat.) Et comme tout ennemi de la Nation est désormais terroriste (jusqu’à ses plus inoffensifs contestataires), et qu’on peut parier qu’elle n’a pas fini de s’en faire - des ennemis -, on a raison de penser que de telles guerres ne s’arrêteront jamais.
Ainsi, de la modernité à la post-modernité, la guerre fut libérée de ses chaînes. Des entraves à son libre développement. Pour batifoler désormais en liberté. C’est ce qu’annonçaient les circonvolutions terminologiques de l’après 1945, où l’on peina à nous expliquer pourquoi au lieu de disparaître (ce qu’on nous avait pourtant dit) la guerre devait à l’inverse s’étendre. On expliqua que la guerre se faisait ailleurs (conflits détournés). On raconta ensuite que guerre et paix étaient savamment intriqués (opérations de maintien de la paix). Ou qu’il n’y avait pas de moyens interdits (guerre hybride). Puis que ça n’allait jamais finir (guerre sans fin, ou guerre permanente). A la notion de paix d’ailleurs, censée décrire le climat normal des sociétés, on finit par substituer celle de continuum. Continuum dans les opérations militaires d’abord (voir La guerre probable, du général Vincent Desportes) : la guerre “classique”, et sa partition guerre / paix, étant mortes (ce qui justifie d’intervenir à peu près tout le temps). “Continuum de sécurité” plus récemment, impliquant une militarisation de la conception du travail des forces de sécurité intérieures, mais aussi de la sécurité privée. Pas seulement une technologisation du maintien de l’ordre mais une façon d’intégrer dans la guerre globale jusqu’au vigile. Ainsi les dernières tendances gouvernementales prévoient de demander aux policiers municipaux de participer à… la lutte contre le terrorisme. Le dernier terme à la mode est enfin maintenant celui de “sécurité globale”. C’est dire que l’état de guerre permanent est consacré jusqu’au niveau le plus institutionnel.
L’anti-terrorisme joua donc un temps, on le croyait, comme mode de guerre : en coulisses. Maintenant, on sait qu’il a atteint valeur paradigmatique. Et qu’à force de déborder, il définit aujourd’hui la logique du fait guerrier dans son ensemble. Ce penchant à l’illimitation, au floutage des catégories qui auraient dû permettre d’endiguer la guerre, semble désormais avoir valeur universelle. Elle se fait depuis quelque temps toujours au service de la vie, au nom du Bien, et nous dit-on jusqu’à la mort. Comme si les guerres ne devaient plus s’arrêter, pour devenir toujours totales. La traque (des rebelles) se changea en peuplicide. Il ne fut plus seulement question de supprimer quelques poches séditieuses, mais de rayer de la carte des populations entièrement menaçantes. Quitte à raser tout leur milieu de vie au passage. Ce qui se passe depuis 2011 en Syrie devait annoncer la couleur. Une extermination. La même logique est aujourd’hui à l’œuvre en Palestine, à frais renouvelés. Les européens, quant à eux, constatèrent que l’utopie des guerres chirurgicales avait fait long feu. Et que la « bonne vieille guerre » – d’attrition, celle des chars et des bombardements incessants – leur revenait en pleine face. Aussi, une certaine musique de la mobilisation revient aujourd’hui à toutes les sauces. Pour encenser l’engagement et la résilience du peuple ukrainien, pour les faire héros. Pour parler (beaucoup) d’économie de guerre, ou encore d’écologie (il fallait porter des cols roulés pour consommer moins de gaz russe). En somme, c’est la place des populations – dans un monde dessiné comme belliqueux - qui semble aujourd’hui se reposer. Victimes directes, cibles, éléments de participation, comptables ou de conquête ; et non plus spectateur distant, voire ignorant (promesse pourtant qu’on avait fait à l’homme démocratique du présent). Chacun doit maintenant se mettre plus ou moins à la guerre - on peut en faire l’hypothèse - nouveau visage apocalyptique d’un monde déjà frappé d’effondrement.
Ainsi la guerre fait à nouveau système. Et elle a un appétit d’ogre. Reste à savoir si elle se confirmera comme mode de gouvernement, comme façon de tenir des sujets dans son marécage, comme gouvernementalité. Si elle dédoublera le discours de la fin et de la lutte à mort avec celui de l’implosion planétaire. Si elle entraînera ce qu’il faut de dynamique, de récits, d’ambiance, pour figer les populations dans un nouveau piège. Si un continuum d’affolement, de chantages, de menaces orchestrées, jusqu’au crime final, permettra d’enserrer chacun dans le temps lisse et paranoïaque de la sécurité. Si la mobilisation marchera : pour les chanceux d’abord raffinée, morale, « citoyenne », de soutien. Jusqu’à la résolution, où les corps nationaux s’entrechoqueront, au terme d’un dernier conflit mondial, ou d’un siège du monde occidental par les naufragés de l’effondrement. La guerre est une toile tendue, totale elle restera maître du temps.
-

La nouvelle guerre froide ?
Convergence technologique et capitalismes politiquesOn entend le « retour de la guerre », et on se demande « laquelle ». La thèse de la régression, qui nécessite d’oblitérer la guerre au terrorisme (cf. [Article 2] (./2)), nous renvoie à l’étape précédente, celle donc de la Guerre Froide (et son risque de guerre totale, cf. [Article 1] (./1)). L’actualité belliqueuse étant plutôt brûlante, il faut simplement entendre ici le retour à un grand affrontement entre « blocs ». Reste à savoir de qui il s’agit. On croit comprendre qu’ils mettent en scène les États-Unis et la Russie (c’est original), et par extension l’Occident versus l’axe Russie-Chine-Iran (la 4e guerre mondiale selon les idéologues iraniens). La Guerre Froide englobait un affrontement idéologique. Qu’est-ce qui unie ces prétendus blocs renouvelés, et au nom de quoi entendraient-ils nous pousser vers la mort ? On voit brandie la question des valeurs (voire de la civilisation) - démocratie vs prospérité, liberté vs morale. C’est sûrement un vecteur de mobilisation (qu’il reste à mesurer), mais ça ne cache pas la vérité de la guerre. Balayons pareillement l’hypothèse d’un choc global entre régimes politiques (la démocratie contre la dictature) - ou sinon dans quels camps sont Trump et Modi ? Reste une explication, plus matérialiste, celle d’une scission dans la mondialisation capitaliste - se toiseraient capitalismes d’Etat et libéralisme. Essayons de la déployer. Cela pourrait bien nous amener à remettre en cause la partition elle-même.
1. Schisme
Il n’est pas difficile de se figurer à quoi ressemble un « camp néolibéral », avec son idéal du marché, ses prétentions globalistes, et sa volonté de protéger l’économie de la politique (par la politique elle-même). C’est la version du capitalisme contre laquelle s’était levé le mouvement altermondialiste. Contre laquelle prétendent aussi s’opposer les leaders populistes d’aujourd’hui. Mais que serait son « opposé », ce qui aurait résisté à la chute du Mur et à la mise au pas reagano-thatchérienne, enfin au plein déploiement de la rationalité néolibérale sous étendard progressiste (si l’on veut lui donner des visages, disons ceux de Clinton, puis Blair et Schröder) ? À quoi peut ressembler ce prétendu ennemi quand de toute manière le capitalisme règne, comme jamais, sur l’ensemble de la planète ? On pariera qu’il est l’enfant monstrueux de ce processus de colonisation.
Le cas du Monténégro peut être éclairant. Milo Đukanović y est au pouvoir depuis 1991, alternant les postes de Premier Ministre et de Président. C’est un ancien communiste (pour ce que ça voulait dire dans les années 80), rallié à Milošević. C’est un admirateur de Thatcher, et l’une de ses premières mesures fut de nationaliser puis privatiser les coopératives ouvrières, de même que les anciens chantiers navals yougoslaves. À la différence de Thatcher, Djukanoviċ et sa famille sont devenus les personnes les plus riches du pays, dans lequel le ruissellement semble clairement contrôlé. Ici les investissements dans l’économie (légale ou illégale d’ailleurs) qui alimentent ce clientélisme sont aussi ouverts à l’Ouest : la mafia napolitaine y participe, mais aussi des hommes d’affaires occidentaux (comme Bernard Arnault). Il en est de même politiquement puisque Milošević ayant été blacklisté, c’est Djukanoviċ qui garda des canaux ouverts avec les administrations Clinton et Blair. Il finira d’ailleurs par faire intégrer le Monténégro à l’Otan et tâta la possibilité d’une adhésion à l’UE, ce qui impliquait de montrer patte blanche en matière de lutte contre les discriminations (jusqu’à l’organisation par le gouvernement d’une Pride).
L’exemple du Monténégro montre une modalité du néolibéralisme qui est autoritaire (ce qui n’est guère surprenant), mais aussi antiglobaliste, et à un certain point contre le marché. Par certains aspects il peut rappeler la Hongrie, où le pouvoir, qui garde la main sur les domaines stratégiques, a permis l’accumulation primitive d’une nouvelle élite, le tout au nom du nationalisme et avec les méthodes du néolibéralisme. Ici l’entreprise est plus ouvertement encore clientéliste et surtout rapace. Pour Branko Milanović, économiste serbo-américain anciennement chercheur à la Banque Mondiale :
Le parti au pouvoir [au Monténégro] est simplement une entreprise de vol organisé qui, pour survivre et prospérer, doit prétendre qu’il défend certaines « valeurs » et, surtout, doit continuer à procurer des bénéfices financiers à ceux qui le soutiennent. […] Les hommes du sommet […] sont plus que toute autre chose les arbitres du processus de partage de l’argent entre les différentes factions. [De la même manière] c’est précisément ainsi que Poutine maintient son pouvoir : […] comme un indispensable arbitre.
(Branko Milanović)La thèse de Milanović, pour la résumer rapidement, c’est que l’hégémonie du capitalisme au niveau mondial a entraîné un schisme. Ainsi aurait émergé un « capitalisme politique » dans les anciens pays communistes, notamment ceux pour lesquels le socialisme a « fonctionné » d’un point de vue économique. Il en identifie trois piliers : une bureaucratie efficiente dont le devoir est de parvenir à un taux de croissance élevé ; l’absence d’un État de droit contraignant ; un État guidé par les intérêts nationaux capable de contrôler le secteur privé. Un modèle décliné notamment à Singapour, au Vietnam, en Birmanie, en Éthiopie, en Malaisie, au Laos, en Tanzanie, au Rwanda.
2. Capitalisme politique
Dans Économie et Société, Max Weber distingue trois types de capitalisme : traditionnel, rationnel, politique. Le second, celui qui est à priori actuel, correspond à ce qu’il décrit dans L’éthique protestante . C’est le capitalisme américain, pour faire simple (distinction institutionnelle entre politique et économie, système de la promesse - la monnaie, et moteurs endogènes de croissance - ce n’est pas de la piraterie). Le « capitalisme politique » conditionne quant à lui l’obtention de profits au développement d’activités prédatrices, souvent par (ou avec) le pouvoir politique. L’opposition entre les deux n’est pas stricte et ils peuvent se trouver associés. Dans le développement des banques modernes par exemple : « l’origine de la plupart d’entre elles est due à des opérations commerciales intimement liées à la politique et à la guerre. »
On le comprend, au capitalisme politique correspond une faible institutionnalisation et la domination de quelques individus sur l’ensemble de la société. Si on voulait retrouver son expression primitive ce serait la forme patrimoniale de l’exercice du pouvoir (le sultanisme) puis la construction d’États prébendiers qui contrôlent l’accès aux ressources. Mais le capitalisme politique sait aussi s’agencer de manière plus complexe, comme dans le cas de l’impérialisme romain. Le capitalisme antique était belliciste et dans le cas de Rome articulé autour de deux mécanismes guerriers distincts, « un mécanisme colonial basé sur la paysannerie, un mécanisme impérial basé sur le capitalisme. » Le moteur de cet impérialisme, c’est la volonté des marchands et des esclavagistes, ses moyens sont ceux de la cité.
Le capitalisme y vivait en fin de compte du seul politique ; il n’était économique qu’indirectement, si l’on peut dire : son élément, c’était les hauts et les bas de la cité, avec les aléas de la ferme d’État et des rapts d’hommes et (spécialement à Rome) de terres.
(Weber)Ce capitalisme vivant uniquement du politique, les néo-weberiens en trouvent encore la trace aujourd’hui dans des situations comme celles du Liban ou de l’Iran. Dans le cas du premier, on n’a pas un système qui cherche à produire les conditions de sa propre croissance (le capitalisme rationnel), mais un agencement de réseaux essayant de capter et distribuer les profits (notamment ceux issus de l’explosion de la dette et des privatisations). Dans le cas iranien le guide suprême a, de droit, le monopole des biens publics (sans propriétaire), l’économie est structurée par des monopoles gérés par les Pasdarans (Gardiens de la révolution) et tout cela participe à l’équilibre politique.
Il serait idiot d’en déduire que l’Iran ou le Liban sont restés à un état antique du capitalisme. Au contraire, ils sont la preuve que celui-ci ne se répand pas uniquement par clonage, mais s’adapte. Le déploiement de ces nouvelles formes s’est faite dans un contexte de mondialisation, ce qui permet l’agencement de méthodes archaïques et très contemporaines - de la même manière que les mafias ont enfourché la finance.
3. Russie et guerre
Il persiste donc une forme de capitalisme à la fois contemporaine et pourtant éloignée de l’« esprit » qui a largement contribué à son expansion - c’est-à-dire « l’espoir d’un profit par l’exploitation des possibilités d’échange, c’est-à-dire sur des chances (formellement) pacifiques de profit. » (Weber) Il faut pourtant rappeler, dans le cas des capitalismes archaïques (aventuriers, de butin), comme du capitalisme impérial romain, le rôle manifeste de la guerre. Aujourd’hui où se situe-t-elle, et comment s’articule-t-elle à la quête du profit ?
Le sociologue ukrainien Volodymyr Ishchenko prend le risque d’utiliser la notion de capitalisme politique d’abord pour décrire le pouvoir en Russie et dans les anciennes républiques soviétiques, mais aussi pour expliquer la guerre en Ukraine.
Selon Ishchenko, la prédation du système oligarchique, arbitré par Poutine, rencontre des limites internes et incite donc à augmenter le « bassin d’extraction ». Cette expansion se heurte à deux obstacles. D’abord les « capitalistes politiques » locaux, qui en l’occurence en Ukraine ont échoué à élaborer un projet national. Mais surtout « l’alliance entre le capital transnational » et des classes moyennes qui sont de fait exclues du « capitalisme politique » et trouvent plus d’opportunités dans leurs liens avec l’Occident. Une telle alliance signifie (par exemple via les programmes anti-corruption, comme ceux qui ont suivi Maïdan) priver les capitalistes politiques « de leur principal avantage concurrentiel : les avantages sélectifs accordés par les États post-soviétiques ». La guerre est, donc selon Ishchenko, une bataille pour la survie non de la Russie, mais de son capitalisme politique, dont elle tente par ailleurs d’exporter le modèle aux élites du « Sud ».
Il y a évidemment dans cette analyse une tentation de tout ramener à des intérêts et conflits de classe. Ce qui reste intéressant c’est de voir, non pas comment la guerre participe à des dynamiques d’accumulation du capital (merci bien), mais plutôt comment celles-ci créent des appels d’air pour la guerre.
4. Chine et souplesse
Notre question initiale était celle de l’affrontement de blocs, et leur nature. Et on en arrive donc évidemment à la question de la Chine - autour de laquelle se tisseraient les alliances du nouvel « axe du Mal ».
La Chine offre, sans surprise, pour Branko Milanovic la confirmation de sa thèse d’un schisme au sein du capitalisme, puisqu’il y retrouve aisément les trois piliers de sa facette autoritaire. On y constate aussi l’émergence d’une « classe politico-capitaliste », qui s’est constituée au fur et à mesure de la transition vers l’ « économie socialiste de marché » (réalisée prudemment, « en tâtonnant pierre à pierre »). Celle-ci, comme le souligne Cédric Durand, a notamment été favorisée par la multiplicité des régimes de propriété (privée, publique, mixte, communale, étrangère). Bien entendu la puissance du PCC place l’économie sous la coupe du politique et le parti garde un droit de veto sur les décisions essentielles des entreprises numériques. Et d’ailleurs « les premiers moments de l’accumulation du capital [sont toujours, en Chine,] politiques ». Mais ce qui singularise la Chine par rapport aux autres capitalismes politiques, c’est son caractère décentralisé. C’est ce qu’il faut voir dans l’essor des « entreprises municipales et de village » [TVE] qui a accompagné la modernisation chinoise des années 80 (passée de 28 millions à 135 millions). Ces entreprises sont une forme de propriété communale, mais dont les décisions sont influencés à divers échelons : privé, public, parti, « l’indétermination des droits de propriété laisse toute latitude au Parti de resserrer ou relâcher la bride aux acteurs privés quand il le décide. »
Iran, Russie, et maintenant Chine, l’axe des capitalismes politiques : le piège semble se refermer sur nous, et nous contraindre à rejouer la partition que l’on entend partout.
5. Amérique et prédation
Puisque l’on parle de blocs, iI nous reste à questionner l’état du capitalisme occidental, et son fameux libéralisme méritocratique. On se souvient que le néolibéralisme est pourtant un interventionnisme. Que l’industrie de la tech, principal moteur de la croissance américaine, est un secteur subventionné, voire dirigé, que ses monopoles sont tolérés (le fameux anti-trust à la sauce de Chicago). Que la méritocratie est dans le caniveau, que l’élite est consanguine, que le capital se concentre, que l’influence de la richesse sur la vie politique américaine a atteint des niveaux inédits.
L’une des principales caractéristiques de ce qu’on a décrit comme capitalisme politique est, outre la dépendance à l’Etat, l’importance des mécanismes de prédation. Or ces mécanismes, James K. Galbraith (qui fut conseiller de Yannis Varoufakis) les décrivait déjà aux USA, avant même 2008 :
« Aujourd’hui, le trait principal du capitalisme américain n’est ni la concurrence pacifique, ni la lutte des classes, ni l’utopie d’une classe moyenne inclusive. Au contraire, la prédation est devenue la caractéristique dominante - un système dans lequel les riches en sont venus à se régaler de systèmes en décomposition construits pour la classe moyenne. La classe prédatrice n’est pas l’ensemble des riches [mais elle est] la force dirigeante. Et ses agents contrôlent entièrement le gouvernement sous lequel nous vivons. »
De même, Robert Brenner, figure américaine du marxisme, a décrit les renflouements financiers post-covid comme une « escalade du pillage ». Et en a conclu que l’on vit « la rencontre entre le déclin économique qui s’aggrave et la prédation politique qui s’intensifie. » Mais cette critique existe en réalité depuis les années 60, pour faire le bilan notamment du New Deal. Pour Gabriel Kolko (historien affilié à la nouvelle gauche) les grands patrons ont, au fond, soutenu la réglementation gouvernementale pour anéantir la concurrence. Une critique qui était relayée d’ailleurs par Murray Rothbard, l’idéologue des libertariens :
« Pour Gabriel Kolko, l’ennemi a toujours été ce que Max Weber a appelé le “capitalisme politique”, c’est-à-dire “l’accumulation de capitaux privés et de fortunes via le butin lié à la politique [booty connected with politics]. […] Le travail historique de Kolko, The Triumph of Conservatism, est une tentative de lier les politiques de l’ère progressiste de Théodore Roosevelt à l’État de sécurité nationale laissé derrière dans le sillage de la présidence de son cousin Franklin. […] Le « progressisme national » auquel Kolko s’attaque était, selon ses propres termes, « la défense du monde des affaires contre le ferment démocratique qui était en train de naître dans les États ». Ayant grandi dans les années 50 et 60, Kolko a vu de ses propres yeux la destruction des « choses permanentes » [permanent things] résultant de la fusion de Washington D.C. et de Wall Street. »
La critique libertarienne se poursuit aujourd’hui, faisant le constat que deux idées phares du mouvement conservateur américain deviennent de plus en plus incompatibles : la croyance dans l’économie de marché d’un côté, et le fait que celle-ci soit « encrassée » par un « capitalisme de connivence » (les brevets, les aides publiques, les rentes de situation) qui avantage certains « intérêts organisés », de l’autre.
Ainsi les critères du « capitalisme politique », notion qui semblait qualifier une forme quelque peu dévoyée de capitalisme, dans des pays mal désoviétisés, ont semblé pertinent pour décrire la politique économique américaine et ce à différents moments de ces cent dernières années. On peut même parier qu’en décentrant un peu le regard (vers la « périphérie »), marxistes et libertariens auraient certainement pu se trouver des affinités plus tôt.
Une fois acté le renforcement de ce crony capitalism occidental, la partition entre blocs fondée sur les formes de capitalisme (autoritaire vs méritocratie) se révèle d’un coup moins opérante. Plutôt que celle d’un schisme, on pourrait tenter l’hypothèse inverse, celle d’une convergence. Qu’on observerait notamment dans l’illimitation (c’est ce que l’on décrit dans notre premier article), les moyens (c’est ce que l’on décrit dans le second) et la fonction de la guerre.
6. Sécurité nationale sans frontière
Plus encore que la place des élites et la connivence entre gouvernement et industriels, ce qui affaiblit la fable libérale aux États-Unis, c’est plus sûrement la façon dont l’économie est adossée à la puissance militaire. À l’extérieur de ses frontières évidemment, mais à l’intérieur aussi. Cela s’illustre par le poids du complexe militaro-industriel sur la recherche et les universités, l’argent injecté dans l’économie par la département de la Défense ou tout simplement sa capacité à orienter toute une part de l’économie.
Cela fait partie de l’histoire des États-Unis. L’idée d’une base (industrielle) de défense par exemple (qui comprend notamment les fameuses chaînes d’approvisionnement) existait (comme idée) depuis la guerre d’indépendance, et fut mise en oeuvre pendant la seconde guerre mondiale. Le poids de la sécurité nationale sur l’économie américaine est cependant redevenu particulièrement flagrant ces dernières années : l’embargo sur Huawei, les pressions sur Nvidia, le Chips Act, l’organisation de « chaînes d’approvisionnement résiliantes », ou plus simplement cette affirmation d’Eric Schmidt (qui est l’incarnation de tout ce que l’on vient de décrire : ex-PDG de Google, conseiller du Pentagone, proche de l’administration Obama, créateur d’un fonds d’investissement pour l’IA militaire) : « le leadership mondial dans les technologies émergentes est autant un impératif économique qu’un impératif de sécurité nationale ».
Le néolibéralisme mourant aura vu naître à la fois une élite anti-globaliste (l’élite pro-Trump), anti-démocratique et obsédée par la Chine, des firmes qui entendent outrepasser les marchés (les GAFAMs), des dirigeants d’entreprise ouvertement sécessionnistes (Peter Thiel), et d’autre part des repentis du néo-libéralisme progressiste qui justifient le dirigisme économique au nom de la sécurité nationale (l’entourage de Biden).
Dans le même temps que dit Xi Jinping ?
Nous devons prendre d’assaut les fortifications de la recherche et du développement. [Nous] devons concentrer les forces les plus puissantes pour agir ensemble, composer des brigades de choc et des forces spéciales pour prendre d’assaut les cols [stratégiques].
Il ne parle pas ici de stratégie militaire mais bien d’acquisition et de développement technologiques. Selon Xi, la plus grande menace pour la Chine est sa dépendance à l’Occident pour les infrastructures numériques. Pour lui, reprendre la main sur le développement d’Internet est un enjeu de « sécurité nationale » :
La technologie de base d’Internet est la plus grande « porte vitale », et le fait qu’elle soit contrôlée par d’autres est notre plus grand danger caché. […] Nous devons contrôler l’initiative du développement d’Internet dans notre pays, garantir sa sécurité avec la sécurité nationale.
La sécurité nationale n’est ni un pur argument fallacieux à des fins commerciales, ni vraiment une mise sous tutelle militaire de l’économie. La guerre des semi-conducteurs est bien sûr une guerre commerciale, mais qui a effectivement à voir avec le perfectionnement des systèmes de guidages de missiles, une guerre qui est aussi due à l’inflation de la marine chinoise, à la prévision d’une “grande explication” autour de Taïwan d’ici la fin de la décennie, et à la peur du bond technologique que pourrait produire l’IA. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden, ne dit pas autre chose que Xi Jinping, dans son discours devant le Special Competitive Studies Project, créé justement par Eric Schmidt pour penser les enjeux technologiques de la compétition avec la Chine. Il réaffirme que « la préservation de notre avance dans les sciences et les technologies ne constitue ni un simple « enjeu domestique », ni un « enjeu de sécurité nationale », mais bien les deux à la fois. »
En 2007, Alan Greenspan, alors président de la Réserve fédérale des États-Unis, actait la victoire du marché sur la politique : « les décisions politiques aux USAs ont largement été remplacées par les forces du marché mondial » et « cela ne fait guère de différence de savoir qui sera le prochain président [des États-Unis] ». Mais dans la même phrase il ajoutait : « la sécurité nationale mise à part », décrivant ainsi cette soumission mutuelle de la politique et de l’économie. La sécurité nationale et son expansion ne concernent pas uniquement l’affrontement Chine-USA. L’Allemagne a fini elle-aussi par se doter d’une stratégie de sécurité nationale, afin notamment d’« assurer notre chauffage », d’« avoir des smartphones qui fonctionnent » et de « protéger les ressources naturelles dont toute vie dépend ». En Angleterre, selon le secrétaire d’État à l’énergie et à la stratégie industrielle, ce sont les politiques climatiques qui devraient être intégrées au cadre de la sécurité nationale.
8. La grande convergence technologique
Ironiquement dans la doxa (néo)libérale qui suit la Perestroïka et la chute du Mur, si convergence il doit y avoir entre grandes puissances, ce sera d’abord sur le terrain de la libéralisation de l’économie, condition première à la démocratie. C’est encore cette idée qui accompagne l’entrée de la Chine dans l’OMC en 2001 : “un geste historique pour la prospérité de l’Amérique, les réformes en Chine et la paix dans le monde” (Bill Clinton, prophétique). Une entrée qui correspond d’ailleurs à sa « connexion » à l’Internet, qui devait aussi être un vecteur de liberté individuelle (Clinton, toujours visionnaire, à propos de la Chine et de la liberté d’expression en ligne : « Bonne chance. [La censure d’Internet], c’est un peu comme tenter de punaiser de la gelée sur un mur.»)
Derrière la « guerre des puces » il y a bien entendu un affrontement pour l’hégémonie économique et militaire. Mais il y a dans le même temps une convergence de vues sur le numérique - à commencer par son usage dual (civil-militaire). Le moment où Clinton opposait la liberté garantie d’Internet au désir de contrôle chinois semble loin derrière nous. Jake Sullivan peut d’ailleurs ouvertement regretter la « complaisance » et « l’ouverture » américaine aux « débuts de l’ère Internet ». Les géants américains d’internet ont fait du contrôle, et non de la liberté, la clef de leur business model. L’usage d’internet (et de l’internet des objets), on le sait bien, est désormais intégralement tracé, et ce n’est pas le PCC qui a mis cela en place. La Chine n’a pas imposé à l’Occident sa vision d’une société harmonieuse produite sur le contrôle - ensemble d’agencements, d’incitations, de fines conduites des conduites humaines. « Je pense que la plupart des gens ne veulent pas que Google réponde à leurs questions. Ils veulent que Google leur dise ce qu’ils devraient faire ensuite » prédisait Eric Schmidt quand il était encore PDG.
On a tendance à opposer, quand on pense à la façon de gouverner les hommes, autoritarisme et laisser-faire. Ainsi le néolibéralisme, même s’il est particulièrement interventionniste et violent dans sa défense du marché, viserait finalement une forme légère et désincarnée de contrainte. À contrario, la Chine aurait réussi la libéralisation de l’économie en conservant une forte emprise sur les individus, une forme encore disciplinaire de pouvoir.
Quand le dissident chinois Xu Zhangrun nous dit, pour décrire le pouvoir de Xi Jinping : « Nous avons une forme évolutive de tyrannie militaire sous-tendue par une idéologie “légiste-fasciste-stalinienne “ » on entend le renouvellement de cet autoritarisme fort, vertical, interventionniste. Il faut pourtant regarder d’un peu plus près le premier de ces trois pôles : la source légiste chinoise traditionnelle, pour voir qu’elle vise, par l’excès et la cruauté certes, un ordre immanent. C’est ce qu’avait noté Jean Levi à son propos : elle « impose aux hommes des conduites inconscientes », « pour être loi de nature, la loi de la société doit être intériorisée, se faire coutume » :
En greffant la loi sur les instincts, les légistes en viennent à fondre totalement les institutions dans la nature, ou plus exactement dans son principe — le Dao. Elles s’hypostasient en concrétions de l’ordre du monde. À l’instar du Dao, la Loi est universelle dans son étendue, générale dans son application et inéluctable dans son cours. Elle se charge ainsi de toutes les propriétés d’un principe immanent.
« Le Prince gouverne ses peuples par le seul ressort de leurs passions », la voie du maître : faire un joyau du retrait. Ainsi chez Han Fei:
Le Dao est origine de toute chose, critère de tout jugement. […] Vide, inactif, [le Prince] attend : les noms se nomment, les choses se donnent ; vide, il connaît le trop-plein (Shi) des émotions (Ging) ; inactif, il est le régulateur de l’action.
Invisible, le Prince embrasse le non-agir, et ainsi règne l’ordre absolu, de haut en bas :
Chaque chose a une place, tout objet un usage.
Tout est là où il se doit.
De haut en bas, le non agir.Bienvenue en 2024. Il n’y a de nouvelle guerre froide - entre donc à la fois des alliances, des valeurs, des façons de faire du profit, des intérêts de classe divergents - que du point de vue de l’élite. Depuis en bas, on note plutôt une effroyable convergence, d’intérêts comme de moyens. Et un chaos qui a tout l’air d’un ordre :
Que le coq veille sur la nuit
Que le chat attrape les rats
Chacun à son emploi
Et le maître est sans émoi.
